
BOSSUET
Les origines
Un bel article de M. Louis Madelin, dans l’Écho de Paris, sur les sources du génie de Bossuet. Notre confrère observe ce « magnifique Bourguignon », pur fruit du terroir qui donne le vin généux et des hommes forts :
Les Bossuet sont originaires de Seurre, sur la Saône. C’étaient des rayeurs — fabricants de roues — devenus des drapiers au cours du quinzième siècle. Au commencement du seizième, par cette belle ascension lente, mais sûre des familles de l’ancienne France, ils sont devenus bourgeois notables, puis bourgeois anoblis, et enfin, de bourgeois de petite ville on les voit au milieu du siècle, devenir avocats, puis magistrats au Parlement de Dijon.
Ils y apportent des qualités qui se résument en un mot : la force. Sur le vieux banc de bois que, pendant trois siècles, les Bossuet, de Seurre, ont eu le privilège d’occuper à l’église, on voyait sculpté un, énorme cep de vigne tout noueux et, au-dessous on lisait cette devise où, à la mode de l’époque, souriait un jeu de mots : « Bois bossu est bon. »
Le grand-père était conseiller à Dijon. Dans cette province réunie depuis un siècle à la couronne, les Bossuet ont toujours représenté le loyalisme :

Le conseiller Jacques Bossuet, alors que Dijon était entre les mains de la Ligue, n’entendit pas un instant se laisser entraîner dans la sédiition. Il distingua, dans le trouble des consciences, la voie droite, se donna à l’héritier légitime ne fût-ce que parce que l’étranger soutenait contre lui la Ligue et, entraî ant ses collègues, alla constituer à Semur un Parlement tout au Béarnais. Après le triomphe du grand Restaurateur, Jacques devint maire — vicomte majeur — de Dijon. La famille avait conquis la première place par la clairvoyance, la fermeté de son chef et cet instinct national qui lui avait fait trouver où était la vraie France. Ce vieillard fut le parrain du futur précepteur du Dauphin de France.
Bénigne Bossuet, son fils, tenait de lui. Son union avec Marguerite Mouchet n’avait fait que fortifier le vieux cep. Le père de celle-ci, Claude Mouchet, avait, comme Jacques Bossuet, embrassé contre l’anarchie la cause du roi sauveur, avec une telle ardeur que cet avocat, troquant la toge pour les armes, était allé se battre à Arques, derrière le panache blanc du Béarnais.
De ce milieu parlementaire est sorti Bossuet. Dans son enfance, il avait entendu parler de l’époque de troubles où la France, divisée par des querelles que favorisait l’étranger, roulait, à l’abîme. C’est le roi Henri qui l’a sauvée, et la famille lui garde une reconnaissance qui se transmet. Quand Bossuet louera « le sang de saint Louis » et plus particulièrement le grand roi « destiné par Dieu à ses grands ouvrages », ce n’est pas courtisanerie com me l’a prétendu Voltaire, mais loyalisme ardent hérité de ses aïeux. Et quand il s’asseoira pour la première fois en face de son élève, le dauphin, il entendra, bien qu’il vient payer une dette à jamais imprescriptible à l’arrière petit-fils du roi Henri.
En même temps que ce loyalisme, Bossuet avait reçu la discipline classique. Du grec, du latin à haute dose, et l’histoire de l’antiquité enseignée sous l’angle de l’héroïsme et du stoïcisme. On a jeté bas tout cela, depuis, mais ce régime était en pleine vigueur au collège de Dijon :
« Ce que j’ai appris de style, écrira Bossuet; je le tiens des livres latins et un peu des grecs. » Et tous en eussent dit autant, un Descartes, un Pascal, un Corneille. En fait, nos esprits latins ont besoin de cette culture antique, comme nos corps de Français ont besoin de pain pétri avec le froment de nos plaines. En tout cas, les résultats obtenus plaident pour le régime. L’instruction, qui a formé les grands esprits des siècles classiques se défend suffisamment en s’en parant. À seize ans, un Jacques-Bénigne Bossuet est, de par son éducation, apte à être très vite à la hauteur des plus grandes choses.
C’est encore à Dijon que pour la première fois il les a entrevues :
Les Condé sont maintenant gouverneur de la Bourgogne, le jeune duc d’Enghien — le futur vainqueur de Rocroi — vient gouverner, sa province, éclatant de jeunesse et déjà de génie. Il montre aux Dijonnais, au cours de fêtes superbes, la nouvelle France. Une génération — celle de Richelieu — ayant rétabli l’ordre, une autre apparaît qui fera reprendre à la France sa marche vers la fortune et la gloire. Le duc d’Enghien déjà incarne cette génération. Il s’attacha aux Bossuet, les convia à ses fêtes, fut reçu chez eux. Le jeune Jacques-Bénigne, qui avait étudié l’héroïsme dans Plutarque, connut là un héros bien supérieur, — il devait un jour, très âgé, le proclamer dans sa plus belle oraison funèbre, — comme tant de nos héros, aux modèles antiques. C’est encore à Dijon qu’à travers Louis de Bourbon, duc d’Enghien, Jacques-Bénigne eut la première impression de la grandeur et je dirai de l’épopée française.
Bossuet et la censure allemande

Aussi son génie fut-il essentiellement français, et c’est sans doute un des motifs pour lesquels Bossuet a eu pendant la guerre les honneurs de la censure allemande. Nous empruntons cette anecdote à la Bibliographie de la France, journal général de l’imprimerie et de la librairie, numéro du 3 juin. Le quatrième volume des Œuvres oratoires avait été imprimé en 1915 par la maison belge Desclée. Lorsqu’elle envoya, à la kommandantur de Thielt les épreuves du Sermon sur l’ambition, celles-ci lui revinrent avec la mention : second point (16 lignes- n’est pas admis à l’impression. » Une note du général-major von Ereddrich signifiait aux éditeurs d’attendre « la signature de la paix pour achever l’impression. » Ce n’est que le 19 juillet 1916 qu’on obtint la levée de l’interdiction. Voici quel était le passage censuré :
SECOND POINT
« Cette noble idée de puissance est bien éloignée de celle que se forment dans leurs esprits les puissants du monde. Car, comme c’est le naturel du genre humain d’être plus sensible au mal qu’au bien, aussi les grands s’imaginent que leur puissance éclate bien plus par des ruines que par des bienfaits ; de là les guerres, de là les carnages, de là les entreprises hautaines de ces ravageurs de provinces que nous appelons conquérants. Ces braves, ces triomphateurs, avec tous leurs magnifiques éloges, ne sont sur la terre que pour troubler la paix du monde par leur ambition démesurée ; aussi Dieu ne nous les envoie-t-il que dans sa fureur. Leurs victoires font le deuil et le désespoir des veuves et des orphelins : ils triomphent de la ruine des nations et de la désolation publique ; et c’est par là qu’ils font paraître leur toute-puissance. »
Les Allemands avaient vu là une flétrissure de leurs crimes !
S’étaient-ils beaucoup trompés ?
Ajoutons que les éditeurs se sont donné le plaisir de reproduire les ratures et les explications de la kommandantur allemande. On aimera à retrouver ces documents au tome II des Œuvres oratoires.
La censure du « bekannte »
M. Paul Souday se montre encore plus sévère que la kommandantur de Thielt. Si l’on en croyait le critique du Temps, ce n’est pas seulement seize lignes, c’est toute l’œuvre de Bossuet qu’il faudrait mettre au rancart. Voyez comment il en parle : « On ne peut pas dire que ce soit ennuyeux », mais les thèmes sont périmés « et sa façon de les traiter est encore plus archaïque. » On éprouve, à lire Bossuet, une impression de dépaysement : « Et puis, il y a le style. N’exagérons rien. Bossuet n’est pas le plus grand prosateur de notre littérature ni même de son temps. » Pas de trouvailles générales, pas d’esprit, peu de véritable émotion !…

Bref, Bossuet, comme penseur et critique, « n’existe plus. » Son traditionalisme et son idéisme ont fait de lui « un ennemi de la critique, de la philologie, de la philosophie spéculative, de la science st des lettres même jusqu’à un certain point. » Et voici son principal crime : il regardait la Monarchie comme le meilleur des gouvernements. « Toute la propagande néo-monarchiste d’aujourd’hui, sort textuellement de la Politique tirée de l’Écriture sainte. » Conclusion : « non, vraiment, nous n’avons plus rien à prendre dans Bossuet, que des leçons de bien dire. Il est même si différent de nous, tellement distancé par l’esprit moderne, qu’il en devient inoffensif. »
O Bekannte la Gazette de Francfort sera contente de toi. Mais n’est-il pas piteux que de telles sottises aient paru dans un journal où beaucoup d’étrangers se renseignent sur les tendances de la pensée française ? On voudrait, pour l’honneur de notre pays, que ce numéro du Temps, daté du 9 juin 1921, ne passât pas les frontières. Quelle idée auront de nous nos amis, alliés et neutres en voyant le plus grand journal de la République dénigrer bassement une des gloires de la patrie et de la catholicité ?
R. Havard de la Montagne
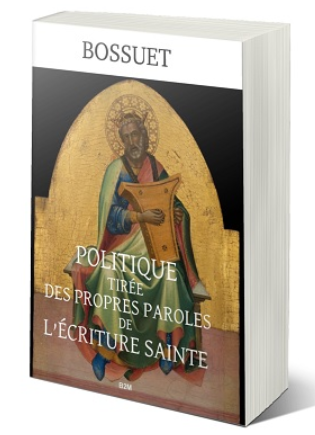
Nombre de pages : 556
Prix (frais de port inclus) : 31 €
Commander ou se renseigner à l’adresse ci-après : commande.b2m_edition@laposte.net











