
Visage du communisme : une rencontre avec la terreur ordinaire

Un après-midi au début de l’été 1975. Je rendais visite à mon ancienne patronne du Centre d’anthropologie, une femme extraordinaire pour laquelle j’avais beaucoup d’amitié. Je me souviens qu’elle me parlait de ses lointaines années d’étude. Soudain, un coup de sonnette interrompit la conversation. Mon amie alla ouvrir et revint, très embarrassée, accompagnée d’un couple. La femme portait une robe au décor fleuri de couleurs criardes. L’homme avait le visage congestionné et le regard stupide de l’ivrogne chronique.
Les premières phrases qui furent échangées m’éclairèrent : comme tant d’autres, mon amie avait eu à subir, au début du régime communiste, la présence de ces gens dans sa maison, accepter la cohabitation forcée avec eux.
La femme était bavarde et décousue. Son mari se contentait de participer à la discussion par des grognements confus, des sortes de ricanements dont le sens demeurait obscur. Une seule fois seulement il sortit de son état de lenteur mentale avec une vivacité aussi brusque qu’inattendue. S’adressant à mon ami, il dit :
« Ah, camarade ! Le vieux temps… Nous avions beaucoup de travail. Beaucoup… Nous devions briser les ennemis. »
Il prononça ces derniers mots d’une manière étrange – je crois pouvoir dire qu’il y avait chez lui, en ces moments, le reste d’une ferveur qui ne pouvait s’éteindre.
Ils s’en allèrent peu de temps après cette inquiétante déclaration. Et, enfin, mon amie m’expliqua.
En effet, une des chambres de sa maison ayant été réquisitionnée, l’administration avait imposé ce couple, avec lequel tous les espaces communs étaient partagés. L’homme était enquêteur à la Securitate – ce qui était l’euphémisme pour tortionnaire. Il ne « travaillait » que la nuit. Rentré à l’aube, il se couchait et, sans doute, me disait mon amie avec un frisson d’horreur, il devait faire des cauchemars puisqu’il criait beaucoup dans son sommeil. L’après-midi, quand il se réveillait, il commençait à boire et il n’arrêtait que le soir, quand une voiture venait le chercher pour le conduire qui sait vers quel sous-sol monstrueux.
Voilà cinquante ans que cette scène a eu lieu et l’entaille qu’elle a ouverte dans ma mémoire n’a toujours pas réussi à se fermer. Je sais, d’ailleurs, que cela n’arrivera jamais. « Nous avions beaucoup de travail » disait ce personnage hideux, et il en était sans doute fier. Fier parce que c’était le Parti qui l’avait installé à cette place, le Parti qui avait mis entre ses mains les instruments de supplice, le Parti qui lui offrait cette chair qu’il devait déchiqueter et transformer en hurlements. Fier parce qu’il servait ce Parti qui lui faisait confiance.
Il employait ses nuits à « briser les ennemis », et cela était devenu son abject destin. Comment ne pas penser que ces ennemis que le Parti lui commandait de briser avaient été arrachés à mon monde ? Ils pouvaient être de ma famille, ils pouvaient être des amis de mes parents ou de mes grands-parents.
Oui, je compris avec le temps que c’était bien de la ferveur ce que j’avais déchiffré dans les paroles de ce criminel – la ferveur de celui qui vit avec la conviction d’avoir accompli la tâche qui lui a été confiée, d’avoir, à sa manière, participé à la glorieuse révolution.
Oui, un après-midi au début de l’été 1975, il m’a été donné de rencontrer un tortionnaire, de croiser son regard vide, de regarder ses mains, d’entendre sa voix éraillée, de comprendre tout ce que cela pouvait signifier. Depuis, j’essaie parfois d’imaginer comment était sa vie, comment était la vie de cette femme qui, naturellement, savait tout et qui partageait l’écho de ses rêves sanglants. Je ne parviens pas malgré tous les efforts que fait mon imagination. En revanche, un terrible malaise se répand dans mon corps – nausée et honte d’appartenir à la même espèce que cet être immonde et les milliers d’autres comme lui. Hommes et femmes, car dans les prisons pour femmes, c’était des femmes qui torturaient, et elles étaient d’une cruauté inouïe. Un malaise hanté par le sordide vertigineux de ces existences – serait-il possible, décent de parler de vies ? –, de ces lieux où le « travail » des uns était la douleur et la mort d’autres. Le sordide incrusté dans les yeux avec lesquels ces créatures regardaient le monde, dans leur mémoire qui, probablement, les conservait en secret comme des souvenirs chers.
Comment pourrais-je oublier cet individu ? Pourquoi l’oublierais-je ? Mon passé eût été, sans doute, incomplet sans cette sinistre rencontre. ■ RADU PORTOCALA
Ce superbe récit est paru le 10 mai sur la page FB de son auteur.
Radu Portocala est écrivain et journaliste, spécialisé notamment en Relations Internationales.
Dernière publication…
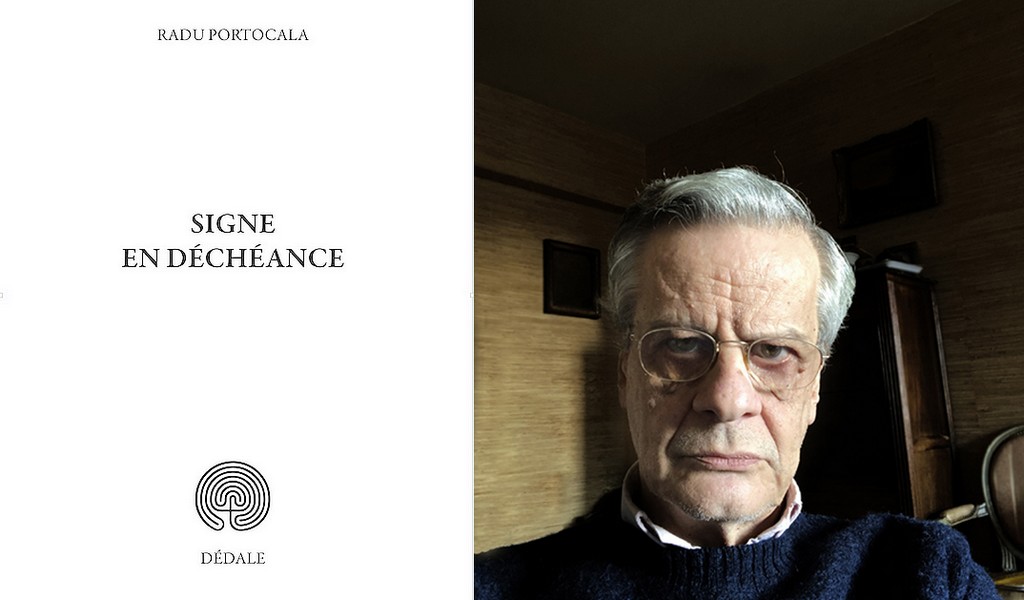












+
Pour M. Radu Portocala
de la part d’un frère des écoles chrétiennes, au Burkina Faso.
J’ai sur mon bureau de ma cellule ce crucifix, horizon quotidien.
Jean Lenôtre est un de mes oncles maternels.
f. Philippe
(comment vous joindre la photos ?)