
Aleteia s’inquiète, à juste titre, de l’avenir du français au Vatican et dans l’Eglise. Une inquiétude qui n’est que le reflet de notre déclin. Pour contrecerrer dans l’Eglise l’effecement du français, les Africains seront sans-doute fort utiles. A l’échelle du monde et en France même, ce sera une autre affaire. Sans un sursaut de son peuple d’origine, l’avenir de notre langue sera à terme bien évidemment compromis. Cette chronique est parue le 20 mai. Son auteur, déjà cité dans JSF, mérite d’être connu et suivi. JSF
Par Xavier Patier.
En théorie langue diplomatique du Saint-Siège, le français disparaît des usages dans les couloirs du Vatican. Est-il si anodin pour un chrétien d’oublier le français ? se demande l’écrivain Xavier Patier. Même si la langue française tend à s’appauvrir, elle porte une spiritualité qui ne peut vieillir.
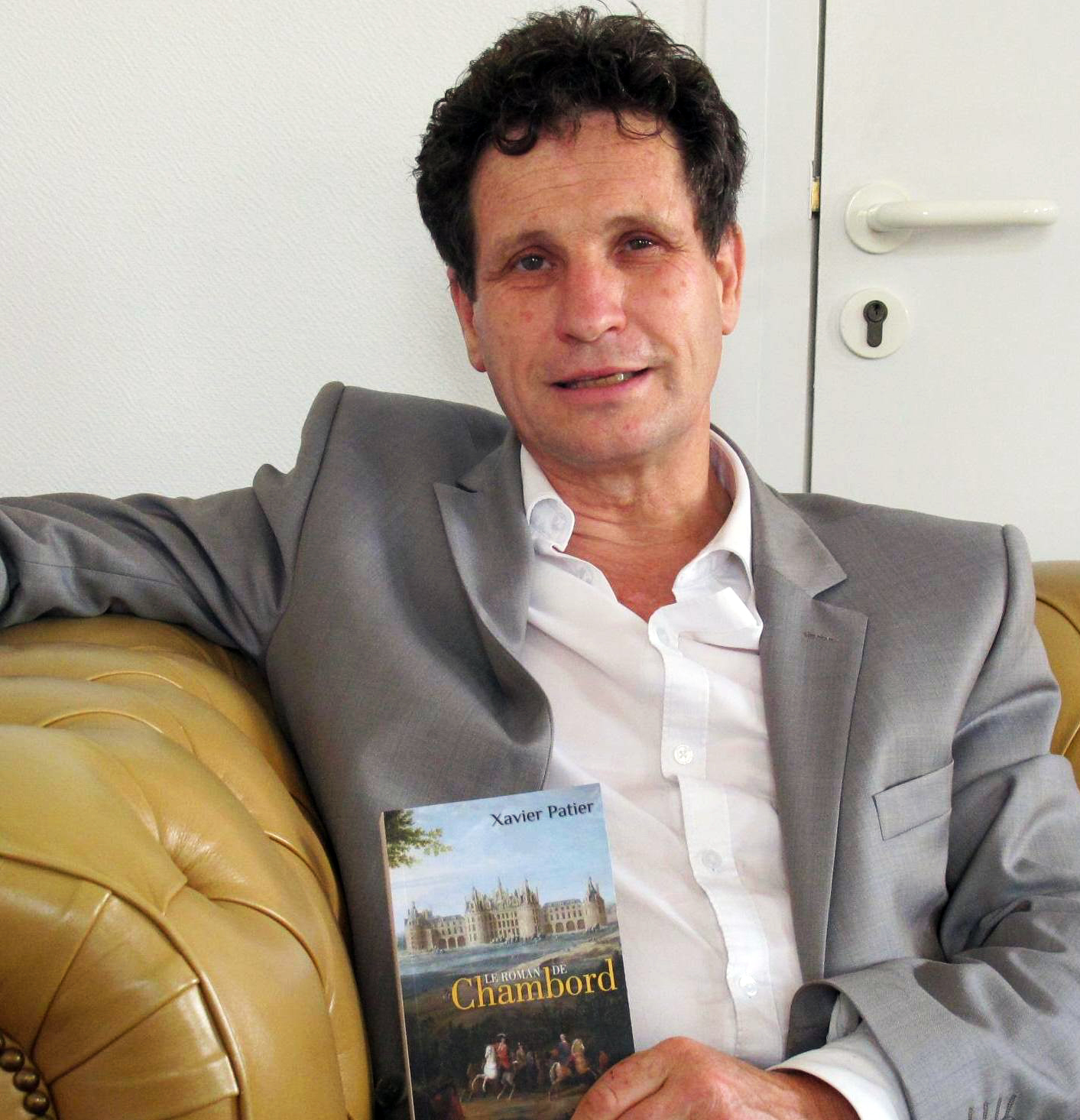
On pourrait considérer comme accessoire le fait que nos deux derniers papes, à la différence de leurs prédécesseurs, ne sont point francophones. Du point de vue de la foi chrétienne, la question de la langue est certes secondaire, sans quoi nous dirions le Notre Père en araméen comme les musulmans s’échinent à lire leur prophète en arabe coranique. Mais est-il si anodin pour un chrétien d’oublier le français ?
Quand les papes lisaient en français dans le texte
Pour nous, catholiques ordinaires qui portons dans nos cœurs, comme un trésor, une langue compliquée et limpide, une mémoire ambitieuse et tragique, une géographie ornée des noms de la foule de saints qui ont signé nos églises et nos paysages, l’effacement de la langue est un défi spirituel. L’Église romaine était un des derniers bastions de la francophonie. Elle ne l’est plus. Nous n’en finissons pas de voir s’écrire l’histoire du monde depuis le banc de touche, nous qui avions l’habitude de la jouer au milieu du terrain. On ne comprend même plus comment raisonne l’arbitre.
Lorsqu’un homme ne peut plus atteindre à l’universel en s’exprimant d’une manière qui lui est propre, dans sa langue maternelle, il est comme déchu. Il ne parle plus : il communique encore, mais sans la poésie. L’ange Gabriel ne s’est pas adressé à Jeanne en Anglais. François de Salle, Blaise Pascal, Thérèse de Lisieux ont reçu et exprimé Dieu avec des mots français. Ils n’auraient pas diffusé la même spiritualité dans une autre langue. Ni Péguy, ni Claudel. Si Marie a parlé à Bernadette Soubirous en béarnais, son message est devenu universel quand la bergère de Lourdes l’a exprimé en français. Grégoire XVI a commenté en français son encyclique Mirari vos de 1832 ; en français, Léon XIII a écrit son encyclique Au milieu de sollicitudes. En français, ce grand pape a parlé à la petite Thérèse de Lisieux venu le voir à Rome ; en français, il a écrit ses poèmes. Paul VI lisait Mauriac directement dans le texte et Jean Paul II André Frossard, à qui il demanda une méditation sur la Passion. Benoît XVI lisait Maritain sans recourir à une traduction. C’était hier.
En théorie, la langue diplomatique du Vatican
Aujourd’hui, le français reste en théorie la langue diplomatique du Vatican, État enregistré comme francophone auprès des Organisations internationales. Mais c’est une curiosité. Malgré la montée des Églises d’Afrique sub-sahariennes, la langue de Molière s’effondre dans l’usage pratique de la Curie. Le pape François avait coutume d’y exprimer son courroux en espagnol. On lui répondait en italien ou en anglais. Le pape Léon XIV s’exprimera sans doute en italien, ou alors en anglais ou en espagnol.
Exit le Français. Exit. Et le latin, justement ? Sa disparition à Rome — hormis dans la liturgie — fait que le Latin n’est plus seulement une langue morte : il est une langue perdue. Ma génération aura été la dernière en France à apprendre à l’école un peu de latin. C’était une ascèse. À la différence d’une langue vivante, le latin ne peut pas se comprendre intuitivement. Il faut pour le saisir analyser tous les détails de tous les mots, connaître les déclinaisons, se plonger dans une mortification intellectuelle à rebours de tout ce que nous offre aujourd’hui l’immédiateté numérique. Le latin est une langue logique conçue pour être gravée dans le marbre : il lui faut être bref. Tout dire avec très peu de mots : Ira furor brevis est, comme disait Horace.
La grande extinction de la langue
Le français d’aujourd’hui est devenu, avec Internet, exactement le contraire : un bavardage sans borne. Il est plus facile de taper sur un smartphone que de frapper du burin sur la pierre. La notion de ligne, de paragraphe, de page n’est plus une limite. Je suis chaque jour frappé de voir que la grande majorité des romans francophones qui sont publiés sont écrits sans la moindre concision, en langage oral, au temps présent. La littérature française, aidée par le malthusianisme verbal de l’Académie, avait longtemps freiné comme elle pouvait l’évolution spontanée de la langue parlée. Le français évoluait bien entendu, mais comme un fleuve paisible. Il prenait son temps.
À présent la littérature accélère l’évolution spontanée de l’oral. Et plus encore, elle contribue à sa fragmentation. Les francophones ne s’aiment plus les uns les autres. Il y a le langage des jeunes, le langage des banlieues, le langage des puissants, celui des rappeurs, celui des vieux. Les mots se font violents : l’écriture inclusive est voulue et reçue comme une agression. La biodiversité sémantique s’effondre. On se contente de huit cents mots. Les formes anglo-saxonnes sont invasives. Des formes disparaissent. Dans cette grande extinction de la langue, aussi violente que celle des espèces, l’ablatif absolu, le subjonctif, sont les premières victimes. Bientôt ce sera le tour du passé simple. « La marquise sortit à cinq heures », ce sera fini : à cinq heures, la meuf sort. Point final. Il faudra traduire Chateaubriand en bas-français pour le rendre intelligible aux nouvelles générations. Notre langue aura cessé d’être un outil au service de l’universel dans l’espace et le temps. Elle sera devenue un patois wokiste. Le français écrit sera pour de bon une langue morte, comme le latin, sans la liturgie. Il faut imaginer un monde que plus personne ne saura penser et admirer avec les mots de l’Histoire d’une âme. Ce sera un monde glacé.
Les jeux ne sont pas faits !
Dieu merci, les jeux ne sont pas encore faits. Il nous faut compter sur nos amis africains. Non seulement c’est entre leurs mains que se décide la ré-évangélisation de nos campagnes, mais c’est d’eux que dépendra le salut de la langue française dans le logiciel catholique. Comptons sur Dieu et comptons sur eux ! ■ XAVIER PATIER
Écrivain. Derniers ouvrages parus : Heureux les serviteurs (Cerf, 2017), Blaise Pascal, la nuit de l’extase (Cerf, 2014), Demain la France. Tombeaux de Mauriac, Michelet, De Gaulle (Cerf, 2020) et La confiance se fabrique-t-elle ? Essai sur la mort des élites républicaines (Cerf, 2023).












