
Une chronique qui se veut ironique – et l’est vraiment, fourmillant d’idées saugrenues et drôles. Parfois désopilantes. Moment de détente rafraîchissant dans le contexte politique sous tension. Une ironie parfois fondée sur des poncifs ou des options politiques sous-jacentes qui ne sont pas les nôtres, ou même y sont contraires. Même en un tel cas, Samuel Fitoussi rend compte de la situation avec esprit et intelligence des circonstances. Le lecteur de JSF en fera la critique si bon lui semble.
Par Samuel Fitoussi.
Cette chronique du lundi est parue dans Le Figaro du 30 juin. Elle ne manque pas à son ambition de drôlerie ironique et brillante reflétant, de fait, d’évidentes réalités et donc une actualité et chargée de sens. Discutable d’ailleurs… Bonne lecture !
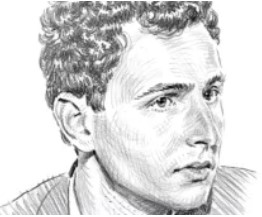
CHRONIQUE – Chaque semaine, notre chroniqueur pose son regard ironique sur l’actualité. Aujourd’hui, il imagine la première journée d’un jeune élève dans une école du futur entre refus d’une pédagogie verticale et stage d’autodéconstruction.
* Samuel Fitoussi vient de publier « Pourquoi les intellectuels se trompent » aux Éditions de l’Observatoire.
9 heures. C’est un grand jour pour Benoît, il entre en sixième à l’école publique de Grenoble. Parvenu dans la bulle de décentration éducative (la salle de classe), il s’installe à côté d’un apprenant avec lequel il a tissé des liens affectifs horizontaux. La référente de cycle (la professeur principale) fait l’appel. Pour rompre avec l’esthétique martiale du rang, de l’ordre, et de l’hitlérisme, le « présent » est remplacé par un bruit spontané (un hurlement, un soupir ou un cri de crapaud) de sorte à laisser s’exprimer l’état de présence intérieur du cognitant. Benoît choisit d’émettre un râle réservé, laissant habiter sa corporalité plurielle. Les élèves ont l’air d’apprécier l’exercice, la référente fait donc l’appel huit ou neuf fois.
10 heures. Benoît sort une trousse ; la professeur le regarde sévèrement. Les stylos et les papiers, associés à une pédagogie verticale, souvent traumatique, et toujours écologiquement irresponsable, n’ont plus leur place, explique-t-elle. À terme, l’idée sera de distribuer à chaque apprenant un MacBook (pour permettre une immersion fluide dans un océan de savoirs non hiérarchique), mais à cause du gouvernement ultralibéral qui choisit l’austérité plutôt que le bonheur de toutes et tous, l’Éducation nationale manque de budget. En attendant, chacun doit écouter attentivement tout ce qui est dit, non pas pour « retenir » (nous ne sommes plus au Moyen Âge), mais pour ressentir le savoir et le laisser infuser dans son champ mental profond.
La référente s’approche, s’accroupit (afin de ne pas exercer de domination posturale) et lui demande ce qui ne va pas
11 heures. La référente pédagogique demande à chacun de se présenter : nom, prénom, pronom, identité du parent 1 et du parent 2, limites sensibles à faire respecter dans l’espace partagé (facteurs potentiellement déclencheurs de désancrages intérieurs, précise-t-elle devant le regard d’incompréhension de Benoît). L’idée est de bâtir collectivement une charte des émotions mobilisables. Une apprenante reste muette. La référente s’approche, s’accroupit (afin de ne pas exercer de domination posturale) et lui demande ce qui ne va pas. L’élève (fille d’une sociologue) répond : « Vous avez demandé à chacun de se présenter, et non pas à chacun et chacune, je me suis sentie exclue. » La professeur pousse un cri de honte. Elle a passé tout l’été à suivre des formations d’inclusivité, tout cela pour invisibiliser une personne à utérus dès le premier jour ! Elle annonce aux élèves qu’elle part en stage d’autodéconstruction critique (elle se recroqueville dix minutes sous son bureau).
11 h 05. Laissés sans surveillance, plusieurs apprenants entrent en dissonance physique (une bagarre éclate). Le proviseur, alerté par le bruit, intervient et propose un temps de respiration collective. À votre âge, explique-t-il, les tensions intersubjectives sont normales ; il est sain d’explorer par le contact, les frontières de vos zones de tolérance kinésique. Ce qui est en revanche inacceptable, poursuit-il, c’est de vous être battus entre garçons, en non-conformité avec la dernière circulaire d’Élisabeth Borne concernant la parité de genre dans les joutes à résolution corporelle en milieu scolaire. Que cela ne se reproduise plus ; nous sommes en 2025, les mentalités doivent évoluer. « C’est vrai ça ! » hurle la professeur principale, depuis sous le bureau.
13 heures. Les cours sont suspendus en raison d’une grève enseignante contre le capitalisme.
Les dix mois suivants [seront consacrés] à l’enseignement de la colonisation française en Algérie, crime trop longtemps invisibilisé par l’Éducation nationale raciste
14 heures. La matrice apprenante retrouve sa stabilité processuelle ; Benoît fait la connaissance du professeur de maths. Pour éviter toute forme de violence épistémique, annonce celui-ci, il ne sera pas question de commencer la manipulation des invariants numériques avant que chacun ne se soit acclimaté sensoriellement au champ des potentialités éducatives.
15 heures. Benoît rencontre le professeur d’histoire, qui couvre rapidement (mais efficacement) tout le programme de l’année, de manière à pouvoir consacrer les dix mois suivants à l’enseignement de la colonisation française en Algérie, crime trop longtemps invisibilisé par l’Éducation nationale raciste.
17 heures. À la fin du cours, le professeur de français distribue un devoir maison : dix questions pour vérifier que les élèves ont correctement assimilé le programme de CM2. Il rédige les questions avec ChatGPT ; les apprenants y répondront avec ChatGPT.
18 heures. Les élèves sont réunis par la direction dans l’espace de décompression cognitive (la cour de récréation). Les trois prochains mois, leur annonce-t-on, seront balisés pour l’ouverture d’une nouvelle séquence d’éveil citoyen : l’élection des écodélégués. Benoît envisage de se présenter. À suivre…■ SAMUEL FITOUSSI
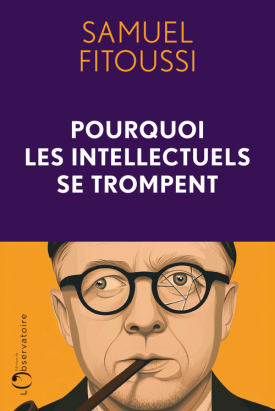
Samuel Fitoussi, « Pourquoi les intellectuels se trompent » aux Éditions de l’Observatoire.












