
« Todd a l’esprit décalé, insolent, libre, impertinent. Éminemment pertinent, donc ! »
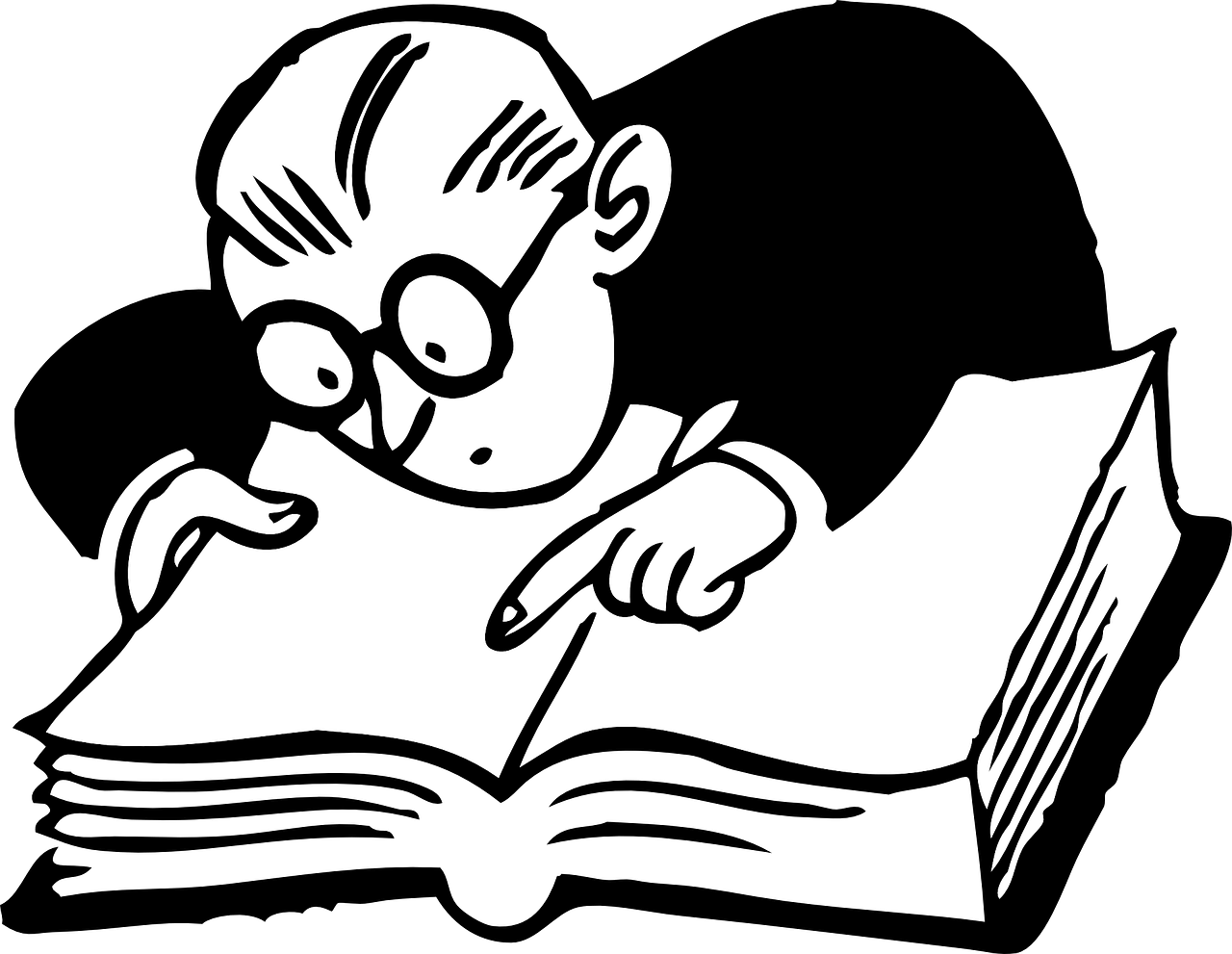
« Proxy », ce mot anglais devenu si fréquent, vient du latin « procuratio ». Nous avons nos procurations. Les Romains avaient des procurateurs. Le procurateur, c’est celui qui s’en lave les mains — de quoi ? Du sort de ceux dont il a la charge : innocent, peuple, pays, nation… Il est, à l’égard de ces derniers, exonéré de toute responsabilité, de par les ordres reçus, par exemple, d’une oligarchie impériale. Des mains toujours propres ? Impossible aujourd’hui. Totalement anachronique, vu l’état de notre droit !
Les « proxy », autrement dit, les procurateurs, sont-ils érotomaniaques ?
Todd n’exagère-t-il pas ? Veut-il nous faire penser aux proxénètes ? Ceux qui envoient leurs protégé(e)s à l’abattage. La proximité lexicale est frappante ; l’étymologie semble pourtant les séparer (latin « proxeneta »), mais l’anglais nous y ramène — et l’usage aussi.
À l’entrée « proxénète », le CNRTL (Centre national de ressources textuelles et lexicales) nous propose une curiosité :
« Proxo, subst. masc., abrév. de proxénète.
Moyennant un certain nombre de services, délations, pots-de-vin, coups de main électoraux, les proxos avaient été institués, par la République française, les fermiers généraux de la prostitution. »
(Le Nouvel Observateur, 28 juin 1980, p. 27, col. 3)
Et des exemples savoureux :
« C’est une abominable personne [la vieille] qui, toute pleine des souvenirs de sa trouble jeunesse, et forte de l’expérience des passions dont elle a été dévorée, assouvit maintenant, dans le rôle de proxénète où l’âge l’a réduite, le besoin de pollution qui lui reste au fond du cœur. » (Faral, Vie temps St Louis, 1942, p. 185)
Mais de quelle « vieille » s’agit-il ? ■ MARC VERGIER
Lire dans JSF











