
« On peut dire que la mise à l’écart des Européens dans les derniers développements de l’affaire d’Ukraine n’a pas été volée. Trump et Poutine leur vouent un immense mépris. Ils ont tout fait pour le mériter. » Roland HUREAUX.
Par Max-Erwann GASTINEAU.
Ce remarquable article est paru le 29 août dans Front Populaire. Il entre dans la logique de ceux qui voient dans les crises actuelles de « l’Occident » bien plus que des crises institutionnelles ou de régime, bien plus que des crises politiques (au sens trivial), économiques ou militaires, mais, plus profondément, des crises nationales, de société et, plus largement, de civilisation et de spiritualité. C’est à ce prisme de haute volée que cet article explique la politique russe. Politique n’étant pas prise ici dans son acception la plus restreinte et basse (« le gouvernement des choses », au sens saint-simonien et macroniste), mais dans son sens le plus élevé, qui tient à l’Histoire, à la transcendance et à la spiritualité. Pour notre auteur, la Russie — et Vladimir Poutine dans l’exercice du Pouvoir — relèverait éminemment de cette seconde acception. JSF
CONTRIBUTION / ANALYSE. Les vraies causes de la guerre russo-ukrainienne nous échappent parce que nous ne cherchons pas à comprendre l’autre, sa rationalité, les pesanteurs historiques et culturelles qui l’orientent. Dans cette analyse froide et informée, Max-Erwann Gastineau nous invite à réellement penser l’altérité en géopolitique.

Je me retrouve rarement dans ce que je lis depuis trois ans sur les causes de la guerre russo-ukrainienne et les objectifs poursuivis par Moscou… Une impression domine, celle de passer à côté de l’essentiel, à côté des « représentations », comme les appelait Yves Lacoste, figure de l’école géopolitique française ; de ces représentations dont les protagonistes font eux-mêmes étalage dans leurs propres textes et discours.
Mais d’abord, évoquons cette « impression ». On peut toujours affiner les choses, mais il existe en France deux grands courants se disputant l’interprétation des mutations façonnant l’ordre international : le courant occidentaliste / libéral / idéaliste et le courant réaliste / « gaullo-mitterrandien », dirait Védrine.
À partir de février 2022, date de l’invasion russe de l’Ukraine, le courant « occidentaliste », sur-représenté médiatiquement, a reproché aux « réalistes » leur russophilie. Ces derniers n’auraient pas vu ou voulu voir (par affinité avec l’idée de puissance et le cynisme qu’elle implique ou le conservatisme poutinien…) que la Russie n’aspirait qu’à une seule chose : « prendre sa revanche », « reconstruire son empire » au mépris du droit international, pierre angulaire de « l’ordre multilatéral bâti après-guerre ».
Je ne reviens pas sur ces arguments, qui m’apparaissent globalement infondés — à l’exception peut-être d’une dimension revancharde qui peut jouer face à l’expérience de l’humiliation vécue par la Russie au cœur des années 1990, consécutivement à l’éclatement du bloc soviétique et l’avènement d’une société anomique, dont l’état s’apparentait, sans effusion de sang, à celui d’un « pays vaincu par la guerre » (Krastev et Holmes, 2018). Mais gardons cette dimension « revancharde » pour plus tard.
Arrêtons-nous, pour l’heure, sur la russophilie prêtée aux réalistes (Védrine, Debray, Girard…) ; accusation dont l’origine tient au fait que ces derniers ont essayé depuis la chute du Mur et surtout l’année 2014, date des « événements de Maïdan », de faire au fond deux choses :
– 1/ comprendre les ressorts profonds de ce conflit, en pénétrant la rationalité russe – le monde n’étant pas divisée entre démocrates « modérés » mus par le droit et autoritaires « irrationnalistes » mus par la force, mais entre plusieurs rationalités aux ascendances psycho-historiques trop souvent négligées (comment en effet comprendre l’accent mis par les Européens sur les « valeurs » et le droit international sans remonter aux traumatismes du XXème siècle, la sincère peur des Polonais que leur inspire la Russie sans rencontrer l’histoire, l’ambition chinoise sans revenir au « siècle de l’humiliation » ? etc.) ;
– 2/ prévenir l’Europe d’une guerre qui ne manquerait pas d’advenir et d’atteindre à sa sécurité (territoriale, économique…) si la Russie devait se sentir menacée par l’avancée en Ukraine d’une alliance occidentale jugée hostile.
J’aimerais m’arrêter sur le 1/ (la « rationalité russe »), car il conditionne le 2/ et n’a pas fait l’objet d’une assez grande attention, au motif qu’il serait trop subjectif et donc indigne d’être pleinement intégré à notre réflexion. Comme si la subjectivité des acteurs en relations internationales n’était pas, de tout temps et en tout lieu, un ressort (géo)politique fondamental (Badie, 2023)…
La raison des Russes
Assumons donc cette approche subjectiviste centrée sur les raisons russes exprimées par les Russes eux-mêmes. Ces dernières sont nombreuses. Contentons-nous ici d’une raison sous-estimée, faute de connivence éthique et idéologique suffisante avec le contenu qu’elle recèle et les orientations géostratégiques qu’elle préface.
Deux jours après l’invasion de l’Ukraine, le 26 février 2022 (l’attaque ayant eu lieu le 24), l’agence de presse Ria Novosti (l’AFP russe) a publié un édito du chroniqueur Pyotr Akopov exprimant les causes et les effets attendus de cette guerre. Nous ne sommes pas obligés de prendre Akopov aux mots. Après tout, qui est-il dans la galaxie du Kremlin ? Reste que cette chronique a été publiée par l’agence de presse directement placée sous l’autorité du ministère de l’Information, ce qui signifie qu’elle a donc été finement ciselée, à tout le moins validée en haut lieu… en vue de proposer au monde une grille de lecture émanant du cœur même du réacteur ?
Dans sa chronique traduite par la Fondapol, Akopov affirme que la Russie a attaqué l’Ukraine au nom d’une grande cause et en vue d’atteindre deux grands objectifs. Je passe sur les seconds, abondamment commentés, rappelant notamment que l’un des buts de cette guerre est bien d’accélérer la recomposition géopolitique du monde, sa désoccidentalisation, de faire de la Russie la nation qui aura permis aux peuples issus de la « majorité mondiale » (le Sud global) de se libérer enfin de la tutelle morale et politique de l’Occident, de pays fatigués, en fin de cycle, en les renvoyant sur les rives circonscrites de l’Atlantique.
Ces « objectifs » sont intéressants à analyser. Ils sont vus comme le produit de mutations irréversibles, poussées par les vents de l’Histoire et dignes d’appeler l’Europe à s’émanciper du carcan anglo-américain. Mais je voudrais donc m’arrêter sur LA grande cause avancée par Akopov, tant elle s’éloigne de notre vision militaro et stato centrée et peut ainsi nous aider à sortir de réflexes analytiques surannés.
La cause avancée est, résumons les choses ainsi, moins sécuritaire au sens classique (sécurité militaire, territoriale) que sécuritaire au sens « sociétal » et civilisationnel (a) de ce terme, et in fine géostratégique (b).
– a) la sécurité sociétale et civilisationnelle
Le concept de « sécurité sociétale » a été développé par l’école de Copenhague au début des années 1990 et repris ensuite par Samuel Huntington. Les chercheurs de cette école en relations internationales avançaient que la conception classique de la sécurité (militaro-centrée) était dépassée. Un État peut être menacé de l’extérieur, par des forces s’amassant à ses frontières et le désignant comme ennemi. Mais il peut être aussi menacé de l’intérieur, par des mutations minant sa cohésion interne et le devenir de sa propre société.
La sécurité doit donc aussi s’entendre comme la capacité d’une société à « persister dans ses caractéristiques essentielles », à préserver son identité. Ainsi l’État est-il dans son rôle, affirme l’école de Copenhague, lorsqu’il vise cette sécurité non-militaire, en exerçant par exemple un plus grand contrôle sur l’immigration.
« Très bien, me direz-vous, mais quel rapport avec la Russie ? » J’y viens…
La Russie n’est pas un État-nation au sens que revêt historiquement ce terme en Europe. C’est un État-civilisation. Aussi est-ce à l’échelle de la civilisation dont il se réclame, à l’échelle du « monde russe » que cette notion de sécurité doit, dans ce cas précis, être reçue. Lisons Akopov himself ! :
« Vladimir Poutine a assumé, sans exagération aucune, une responsabilité historique en prenant la décision de ne pas laisser la question ukrainienne aux générations futures. En effet, la nécessité de régler le problème de l’Ukraine ne pouvait que demeurer la priorité de la Russie et ce pour deux raisons essentielles. Et la question de la sécurité nationale de la Russie, c’est-à-dire laisser l’Ukraine devenir une anti-Russie, n’est pas la raison la plus importante.
La raison principale est un éternel complexe des peuples divisés, un complexe d’humiliation nationale dû au fait que le foyer russe a d’abord perdu une partie de ses fondations (Kiev), et doit supporter l’idée de l’existence de deux États, de deux peuples. Continuer à vivre ainsi serait renoncer à notre histoire, soit en acceptant l’idée insensée que « seule l’Ukraine est la vraie Russie » ou en se rappelant, impuissants et en grinçant des dents, l’époque où « nous avons perdu l’Ukraine ». Au fil des décennies, la réunification de la Russie avec l’Ukraine, deviendrait de plus en plus difficile : le changement des codes, la dérussification des Russes vivant en Ukraine et la propagande antirusse parmi les Petits-Russes ukrainiens auraient pris de l’ampleur. Aussi, si l’Occident avait consolidé le contrôle géopolitique et militaire en Ukraine, le retour à la Russie serait devenu totalement impossible, puisque les Russes auraient dû affronter tout le bloc atlantique.
À présent, ce problème n’existe plus : l’Ukraine est revenue à la Russie. Ce retour ne signifie pas que l’Ukraine perdra son statut d’État. Simplement, elle sera transformée, réorganisée et rendue à son état originel en tant que partie intégrante du monde russe. » (1)
La Russie ne défendrait pas seulement sa sécurité comme tout État soucieux de préserver ses intérêts nationaux, l’intégrité de son territoire et sa souveraineté (par l’entretien d’une « sphère d’influence » à ses frontières), au moyen de la puissance (soit « la capacité d’une unité politique à imposer sa volonté aux autres unités », disait Aron). Elle se défendrait aussi en tant qu’État-civilisation, le seul à mon sens dans le monde à raisonner ainsi ; à l’exception peut-être de la Chine, mais dont les considérations civilisationnelles (retour à Confucius depuis les années 1980) ne sortent pas du cadre national, le « monde chinois » se confondant avec la Chine elle-même (qui inclut Taïwan, pour Pékin, rappelons-le…).
Selon la Russie, nous dit Akopov, laisser l’Ukraine, le berceau historique du « monde russe » partir, s’éloigner en s’occidentalisant aurait donc à jamais affaibli la conscience patriotique russe, l’unité, l’orgueil, la fierté russes. Ce qui nous amène au dernier point.
– b) considérations géostratégiques
Tout peuple pour surmonter l’avenir doit trouver dans son propre passé des raisons profondes de se concevoir comme digne de se défendre et de poursuivre des intérêts singuliers, sa quête d’indépendance, de grandeur, de souveraineté, d’unité… Dépourvu de ces ressources immatérielles, il perd en vigueur, la force, la détermination qui préface la réponse aux desseins d’autres forces, d’autres puissances, avant de se laisser cueillir…
Nous n’avons pas toujours été étrangers en France à ce genre de considérations. Pourquoi de Gaulle parlait-il de l’importance de voir les Français cultiver « l’orgueil de la France », sinon pour que la Résistance soit plus qu’un objet de commémoration : un esprit, un ethos, une philosophie d’action, une flamme entretenant dans la tête et le cœur de chacun les devoirs et les efforts qu’exige la quête d’indépendance sans laquelle la France cessera tout simplement d’être ?
La crise spirituelle de l’Europe
Raymond Aron parlait, lui, de « crise spirituelle », mais le concept reste gaullien. Chez le sociologue, cette crise décrivait l’état de sociétés européennes épuisées, dépourvues de grands projets (empire, indépendance, puissance…), ne trouvant plus en leur sein le carburant nécessaire aux ambitions collectives qui donnent au sentiment national l’horizon politique qu’il requiert pour ne pas dégénérer en frustration. La crise spirituelle de l’Europe était, pour Aron, la plus grande menace pesant sur nos démocraties. Car une autocratie peut se passer du consentement de ses citoyens ; pas une démocratie, dont l’unité et le consentement de ses citoyens à l’autorité du politique reposent sur un sentiment d’appartenance qui doit non seulement exister, être vigoureusement entretenu, mais qui, pour l’être, doit aussi pouvoir s’exprimer, se traduire à travers l’action et les résultats d’élites légitimes et responsables, incarnant l’ensemble national, le bien commun, l’intérêt général… Le « vrai citoyen », disait Aron, dans un propos parfaitement tocquevillien et anti-constantin (2), plus athénien que libéral, plus républicain que démocrate, ajouterait Debray, ne veut pas uniquement la « sécurité personnelle », « il veut aussi la grandeur de la nation ».
Ce qui nous ramène à l’histoire russe. Dès la prise de pouvoir de Vladimir Poutine en décembre 1999, il s’est agi de reconstruire l’État russe, de permettre à la Russie de reprendre le contrôle de ses destinées, en mettant fin au sortilège de l’imitation du vainqueur de la guerre froide (la démocratie libérale) qui la condamnait à n’être que la pâle copie d’un modèle occidental dont les titulaires garderaient droit d’évaluer la bonne transcription, comme un maître mesurant les progrès de son élève. Dit autrement, dès 1999, il s’est agi pour Moscou d’entrer dans « l’ère de l’affirmation », par la construction d’une voie spécifique, fondée sur ses propres présupposés civilisationnels (assumer l’existence d’un « monde russe ») et le recouvrement d’une puissance essentielle à sa sécurité, comme à la sécurité de tout État aspirant à peser dans les affaires du monde.
Mais la Russie y est-elle au final parvenue ? En partie oui, mais la question demeure. Car en ratant le grand objectif aux sources de cette guerre (renverser le pouvoir en place à Kiev pour y installer une élite russophile, réintégrant l’Ukraine au « monde russe »), Poutine n’a-t-il pas définitivement fait de l’Ukraine une anti-Russie, pas simplement sur le plan politique mais aussi sur le plan meta-politique, spirituel, sociétal ?
L’obtention de nouveaux territoires peuplés de russophones sera présentée comme un succès, la rançon d’une lutte fratricide face aux forces coalisées de l’« Occident collectif » et « décadent ». Mais ces conquêtes n’étaient pas l’objectif initialement poursuivi. Elles étaient un moyen, le prélude à une plus vaste recomposition, restaurant l’ordre russe au sein du « monde russe ». Akopov ne pourra pas dire le contraire… ■ MAX-ERWANN GASTINEAU
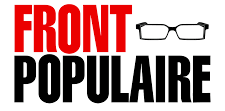












Article très intéressant. Mais si la reconquête de Kiev était le but premier de la Russie, s’engager dans la guerre avec 150000 combattants était un peu léger…
Qui nous dit que la reconquête de Kiev était le but premier de la Russie ? On peut en douter, vu le développement mondial et le basculement de l’ordre ancien US qui est en fait le résultat concret de cette opération ?