
« L’art de Tolkien, et le propos des auteurs, est de pénétrer la surface. Déceler les traces des routes romaines de l’Angleterre dans les pérégrinations de la Compagnie de l’Anneau »
Par Richard de Seze.
Tolkien entendait donner à l’Angleterre la mythologie qu’elle n’avait pas. Philologue reconnu pour ses travaux sur le vieil anglais, le vieux norois et le gallois médiéval, Tolkien a néanmoins baigné, comme tous ceux de son époque, dans la culture gréco-latine et chrétienne (c’était un catholique fervent). Comment cet héritage affleure-t-il dans cet immense légendaire qu’est son œuvre ?

L’enquête est passionnante. D’autant plus que Tolkien professait que l’un des puissants ressorts des littératures qu’il étudiait était cet effet de feuilletage qu’il a lui-même utilisé : le présent de la narration évoque un temps passé, et des temps plus anciens encore, chaque histoire n’étant qu’un palimpseste – devant être un palimpseste, du présent le plus certain jusqu’aux passés les plus mythiques, fondus dans le monde réel : Pippin décrivant les yeux d’un Ent, sorte d’arbre vivant, parle d’un « puits énorme, rempli d’une mémoire séculaire, d’une lente et longue pensée soutenue ; mais le présent étincelait à la surface : comme un chatoiement de soleil sur les feuilles d’un grand arbre, ou sur les rides d’un lac très profond. » L’art de Tolkien, et le propos des auteurs, est de pénétrer la surface. Déceler les traces des routes romaines de l’Angleterre dans les pérégrinations de la Compagnie de l’Anneau (très belle pages sur l’archéologie anglaise du début du XXe siècle), c’est en fait entamer un voyage intérieur dans les strates de la vie de Tolkien et, peu à peu, le légendaire tolkienien, la biographie de l’auteur, sa méthode historique, ses principes de composition littéraire et notre propre lecture rentrent en résonance : lire Tolkien en cherchant le substrat latin, en cherchant à distinguer prudemment ces couches enterrées et mêlées, c’est aussi se pencher sur notre propre capacité à déceler ce fond commun de civilisation chrétienne et gréco-latine, le voyage raconté est la figure de notre lecture.
Les deux auteurs, universitaires, dont une spécialiste de la réception de l’Antiquité grecque et latine à la Renaissance et dans la littérature contemporaine, effectuent un travail de fourmi dans l’analyse des lectures de Tolkien, dans la reconstruction du paysage intellectuel de la première moitié du XXe siècle. Elles font surgir une Méditerranée enfouie dans la Terre du Milieu et nous font toucher du doigt à quel point l’art de la description, chez Tolkien, est l’héritier de l’energeia antique, cet art de la « vive description » qui fait surgir « des choses que l’on pourrait vraiment voir » : Tolkien pratique « ce type particulier de réalisme poétique grâce auquel l’évocation d’un monde concret et familier, vivifié et éclairé de l’intérieur, laisse percevoir la présence d’un autre monde. » Quant à cette lumière intérieure qui éclaire tout, c’est la foi chrétienne de Tolkien, héritage si antique et si actuel.o ■ oRICHARD DE SEZE
Isabelle Pantin et Sandra Provini, Tolkien et la mémoire de l’antiquité. Les Belles Lettres, 2025, 384 p. 23,90 €
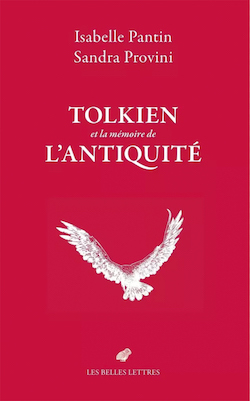
Article précédemment paru dans Politique magazine.













