
C’est à nouveau un très bel et fort intéressant article que nous donne Bérénice Levet. Nous suivons ses travaux depuis un certain nombre d’années et ne manquons pas d’écouter ses interventions en conférence, voire à la télévision. Elle a, au plus profond, ce qu’elle a elle-même nommé « le courage de la dissidence », en titre d’un de ses livres. Cette tribune est parue dans Le Figaro de ce mardi 28 octobre.
Par Bérénice Levet.
TRIBUNE – Obsédées par leur volonté de coller aux dogmes de l’époque, nos élites ont négligé les missions fondamentales dont ils ont la charge, déplore Bérénice Levet, philosophe et essayiste, exemples à l’appui.
Bérénice Levet, philosophe, essayiste, a publié Le Courage de la dissidence. L’esprit français contre le wokisme (Éditions de l’Observatoire) et « Le musée : conserver sans momifier », une communication à l’Académie des sciences politiques et morales, sous la présidence de Rémi Brague.

La responsabilité de Laurence des Cars est engagée assurément car, sauf à admettre que la notion de responsabilité n’ait plus aucun sens, s’il n’appartient pas au président-directeur d’une institution telle que celle du Louvre de répondre du bien, en l’occurrence du trésor des siècles, qui lui est confié, à qui reviendra-t-elle, cette responsabilité ? Et puis, si Laurence des Cars, au regard de l’état des lieux qu’elle avait établi en janvier 2025 et transmis à la ministre de la Culture, jugeait que les conditions n’étaient pas réunies pour qu’elle puisse remplir sa mission, alors il lui fallait démissionner – souvenons-nous de l’exemple du général Pierre de Villiers.
Mission, là est précisément le cœur de la question. Le plus grand flou enveloppe le sens que nos têtes pensantes attachent aux institutions culturelles en général, muséales en particulier. Le « malaise dans les musées » ne date pas d’aujourd’hui – le livre de Jean Clair qui porte ce titre, véritable cri d’alarme, date de 2007 -, mais il ne cesse de s’accroître. De la faillite des musées et de leurs responsables, le vol du Louvre n’est que le cruel révélateur. Les missions traditionnellement attachées au musée, protéger, conserver, acquérir, restaurer, garantir les conditions les meilleures pour la contemplation des œuvres, sont regardées comme archaïques, vieilleries d’un autre temps. L’heure est aux questions sociétales.
Qui postulerait à la direction d’un des établissements phares de la culture avec pour programme exclusif d’assurer ces missions suprêmes serait assuré d’être recalé. L’épine est donc bien moins celle de l’insuffisance du budget dévolu aux musées que celle de la tragédie et de l’infamie de nos oublis et de nos mépris, et d’abord de ceux du chef de l’État. Autrement dit, et pour le dire sans détour, la sécurité des œuvres est le cadet des soucis du président comme de ceux qu’il nomme.
Le mirage des déconstructeurs

Revenons en arrière, en 2021, lorsque Laurence des Cars fut l’heureuse élue du président Macron pour diriger le Musée du Louvre. Considérons les critères qui présidèrent à son choix. « Ce qui a beaucoup intéressé le président, expliquait alors un conseiller de l’Élysée, c’est que Laurence des Cars sente que les débats de société sont entrés dans les musées » et qu’elle soit déterminée à « accueillir la polyphonie du monde dans un musée en résonance avec les questions actuelles » – on goûtera le jargon ! Quant à Roselyne Bachelot, ministre de la Culture d’alors, elle se félicitait du choix d’une personnalité en qui elle plaçait toute sa confiance pour « écrire une nouvelle page de l’histoire du plus grand musée du monde ». « Le Louvre doit se réinventer », proclamait Roselyne Bachelot, sacrifiant à l’injonction des déconstructeurs en chef. De l’amour à la ville en passant donc par les musées, tout est à réinventer !
Invitée, au lendemain de sa nomination, à la matinale de France Inter, l’intéressée confirma « réfléchir à la manière dont le Louvre pouvait être pleinement contemporain », affichant sa volonté farouche de transformer cette grande et belle mais vieille institution en « chambre d’écho de la société », et ce afin d’amener la jeunesse dans ses murs. Et puis, en plus d’être une femme – la première à la tête du Louvre, s’enthousiasmeront en chœur les journalistes -, à son tableau de chasse Laurence des Cars pouvait accrocher un trophée sans précédent en France. En effet, en 2019, au Musée d’Orsay, qu’elle dirigea de 2017 à 2021, elle organisa l’exposition « Le modèle noir. De Géricault à Matisse ». Exposition significativement importée des États-Unis, avec Pap Ndiaye en commissaire scientifique de l’événement et Pascal Blanchard associé à l’ex-joueur de football recyclé dans l’antiracisme racialiste, Lilian Thuram. On conçoit aisément combien cet événement dut peser dans le choix du président.
Conviée par le journal Libération à évoquer les moments marquants de son parcours, celle qui entre-temps était devenue directrice du Louvre retint précisément cette manifestation. Elle dit la conscience vive qu’elle eut alors d’inaugurer une ère nouvelle : « “Le modèle noir” est le travail de thèse d’une chercheuse new-yorkaise (…). Lorsque cette exposition m’a été proposée, j’ai tout de suite eu l’intuition qu’elle serait autant un choc qu’une évidence. » Elle ne dissimula pas sa fierté d’avoir été pionnière dans l’intronisation d’une approche identitaire des œuvres d’art : « Le sujet était inspiré par le champ des black studies américaines. Les enjeux qu’il soulevait n’étaient pas ceux auxquels les musées, en France, étaient habitués. » Le loup wokiste des campus américains entrait dans la bergerie universaliste des institutions françaises. Conversion funeste, d’abord pour le visiteur : celui-ci depuis lors n’a plus d’âme, il n’a plus qu’une identité !
Dans les médias, la quasi-unanimité régna. Enfin, soupira-t-on, rendant hommage à Laurence des Cars, « la décolonisation des arts et du regard » pénétrait en France. Il n’y eut guère que Catherine Millet, la directrice d’Art Press, qui eut la hardiesse de briser ce grand concert d’unanimité en publiant un article, très argumenté : « L’idéologie au poste de commandement », raillant l’enfilage de perles auquel se ramenaient les propos du couple Blanchard-Thuram dans le catalogue et montrant l’abîme qui séparait ce que les œuvres montraient et les commentaires, délirants, qu’en proposait la fameuse universitaire américaine à l’origine de l’exposition.
Visitons à présent le Louvre sous la présidence de Mme des Cars. Je tiens à préciser que ce n’est pas de gaieté de cœur que je dresse ce procès-verbal. Le Louvre m’est cher, il n’est pas un mois sans que je ne m’y rende. À 16 ans, avec le Journal de Delacroix pour guide, j’apprenais à voir, à comprendre et à aimer les grandes œuvres du passé. Et aujourd’hui, je n’ai plus qu’une envie lorsque j’y entre, c’est de fuir.
La première exposition sous sa direction fut Les Choses. Une histoire de la nature morte dont le commissaire était Laurence Bertrand Dorléac. Un véritable fourre-tout, tout devenait nature morte et rien ne l’était.
La première exposition sous sa direction fut « Les choses. Une histoire de la nature morte », dont la commissaire était Laurence Bertrand Dorléac. Un véritable fourre-tout, tout devenait nature morte et rien ne l’était, le sujet véritable était la longue liste des causes à défendre, depuis l’animal jusqu’aux femmes, en passant par les végétaux et autres victimes de l’Occident. De surcroît, l’art contemporain envahissait et parasitait le parcours de l’exposition – ce qui fut mis à l’actif de Laurence des Cars, qui avait promis d’ouvrir le Louvre aux artistes vivants. L’exposition commençait en réalité dès le hall de la pyramide, la traversant de bout en bout – nul, autrement dit, qui entrait au Louvre n’y échapperait. Acte I des « natures mortes », une monumentale installation, Le Pilier des migrants disparus (en Méditerranée), consistant en un empilement de baluchons en tissus africains commandé par le Louvre – voilà à quoi est dépensé l’argent public – au plasticien camerounais Barthélémy Toguo – lequel confiait, sans vergogne, n’être jamais entré dans cette vénérable institution, faute de temps !
Poursuivons notre visite. Parcours off/yoga, multiplication des spectacles de danse dans les salles mêmes, ou encore, en 2024, sur fond de Jeux olympiques, « Et si la visite de musée devenait une discipline olympique ? », nous mettait-on au défi, nous invitant à venir « courir au Louvre sous la direction de Mehdi Kerkouche ». Tout cela au risque et péril des œuvres. Il y a encore quelques années, une des conférencières du Louvre se rassurait de voir pareilles velléités qui chatouillaient déjà la direction bridées par l’interdit d’exposer les œuvres à quelque menace que ce soit. La bride est désormais levée.
Un sursaut pour la sécurité des musées

Il est une autre pièce, crucifiante, à verser au dossier : le 13 mars 2018, au commencement de son premier mandat, Emmanuel Macron réunit à l’Élysée le gratin des présidents-directeurs des musées parisiens dont Jean-Luc Martinez pour le Louvre, déjà Laurence des Cars pour Orsay, Laurent Le Bon alors à la tête du Musée Picasso, et leur expose sa philosophie. Regardant la France comme une start-up nation, il entend les entraîner dans la grande marche en avant dont il a fait son programme et sa bannière : « Celles et ceux (sic) qui s’occupent des musées pourraient être considérés comme conservateurs, je veux croire le contraire. » On imagine le sourire de mépris en coin du président. Le mot est lâché : « conservateur », voici la plaie, l’obstacle, l’ennemi qu’il faut vaincre. Emmanuel Macron les exhorte donc à s’affranchir de cette mission – de toute évidence, le vol du butin du Louvre en offre le cruel témoignage, il a été entendu ! C’est d’ailleurs fort de cette volonté de mettre en mouvement le patrimoine historique de la France que, dès la fin 2017, le président décida, contre l’avis de tous les experts, fruit donc de son seul caprice, de faire voyager la tapisserie de Bayeux, comme, à n’en pas douter, de remplacer les vitraux de Viollet-le-Duc par ceux d’une Claire Tabouret connue pour son engagement en faveur de l’inclusivité et de la diversité et pour ses tableaux « exprimant la rigidité des codes sociaux et le désir d’identité » !
Il est une disposition avec laquelle nos élites ont tragiquement rompu : se tenir pour les obligés de ces choses belles, fragiles, périssables que nos ancêtres nous ont léguées, comptant sur nous pour en prendre soin et les continuer.
Le chef de l’État pouvait se rassurer : les personnalités présentes à ce déjeuner de l’Élysée partageaient pleinement ses vues. Témoins les propos de Laurent Le Bon, aujourd’hui à Pompidou, alors au Musée Picasso : « Le grand danger d’un musée monographique, observait-il, c’est de se transformer en un tombeau. » Insuffler la vie dans les musées est leur obsession. On ne peut rien comprendre à la politique des directeurs de musée, et donc à leur incurie, fatale ce 19 octobre, si l’on ne mesure pas le poids de cette hantise d’être regardés comme des gardiens de cimetière. Il est loin le Louvre de Vivant Denon, son premier et admirable directeur, nommé par Bonaparte premier consul. Le bicentenaire de sa mort passe, hélas, bien inaperçu. Et pourtant sa hauteur de vue serait une puissante ressource pour ses indignes héritiers.
Ce tableau rapidement esquissé montre à quel point il est une disposition avec laquelle nos élites ont tragiquement rompu : se tenir pour les obligées de ces choses belles, fragiles, périssables que nos ancêtres nous ont léguées, comptant sur nous pour en prendre soin et les continuer. Nous avons désappris à hériter, et les mots, que dis-je, la charge contre l’art d’hériter précisément est à la fois symptomatique – concentré chimiquement pur de la philosophie progressiste – et tragique – je pèse mes mots car c’est l’avenir de notre civilisation qui est en jeu. Comme le dit Victor Hugo, l’humanité commence avec le legs. Le poète observait en effet que ce n’est pas la demeure qui distingue l’homme de l’animal – lui aussi a un gîte -, « le premier champ dont l’homme hérite établit la différence ; la bête ne lègue pas sa tanière », écrit-il lumineusement. Pour Hannah Arendt, ce « de génération en génération », cette magnifique expression, est l’esprit même du peuple juif, peuple de la mémoire, du souvenir, de la continuité historique, et son don à l’humanité entière.
Peut-on escompter que le vol des bijoux de la Couronne entraîne un sursaut, dans les musées mais pas seulement, à l’école non moins notamment ? Avis en tout cas aux prochains candidats à la fonction suprême. Que le futur président de la République rompe avec les idoles de l’émancipation et recentre les responsables des institutions muséales sur leur seule prérogative de conservation. La déliaison, la désaffiliation n’ont aucune vertu. Quittons résolument l’obsession des droits, ceux-ci nous enkystent sur nous-mêmes, et donnons la préséance aux devoirs. Servir, n’est-ce pas la plus noble des prérogatives humaines ? En ces temps d’interrogation anxieuse sur le sens de l’existence, voilà qui a fière allure ! ■ BÉRÉNICE LEVET
JSF suit et reprend les publications et interventions de Bérénice Levet. Pour les retrouver cliquez ICI
À lire….
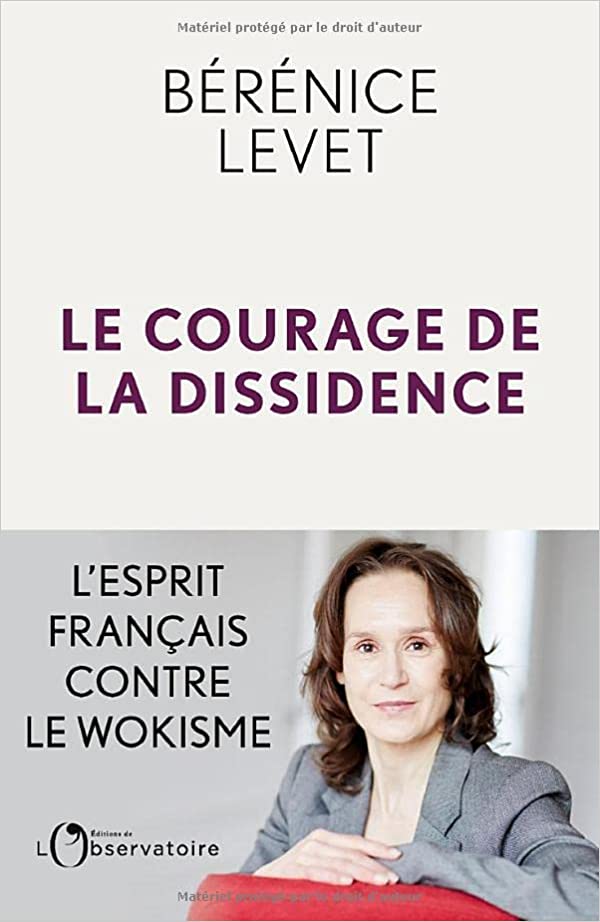
Le Courage de la dissidence: L’esprit français contre le wokisme18,00 €












Un article qui nous révèle l’étendue du mal, bien plus profond qu’on ne le croirait
Dans ce malheureux pays tout est gangrené…..