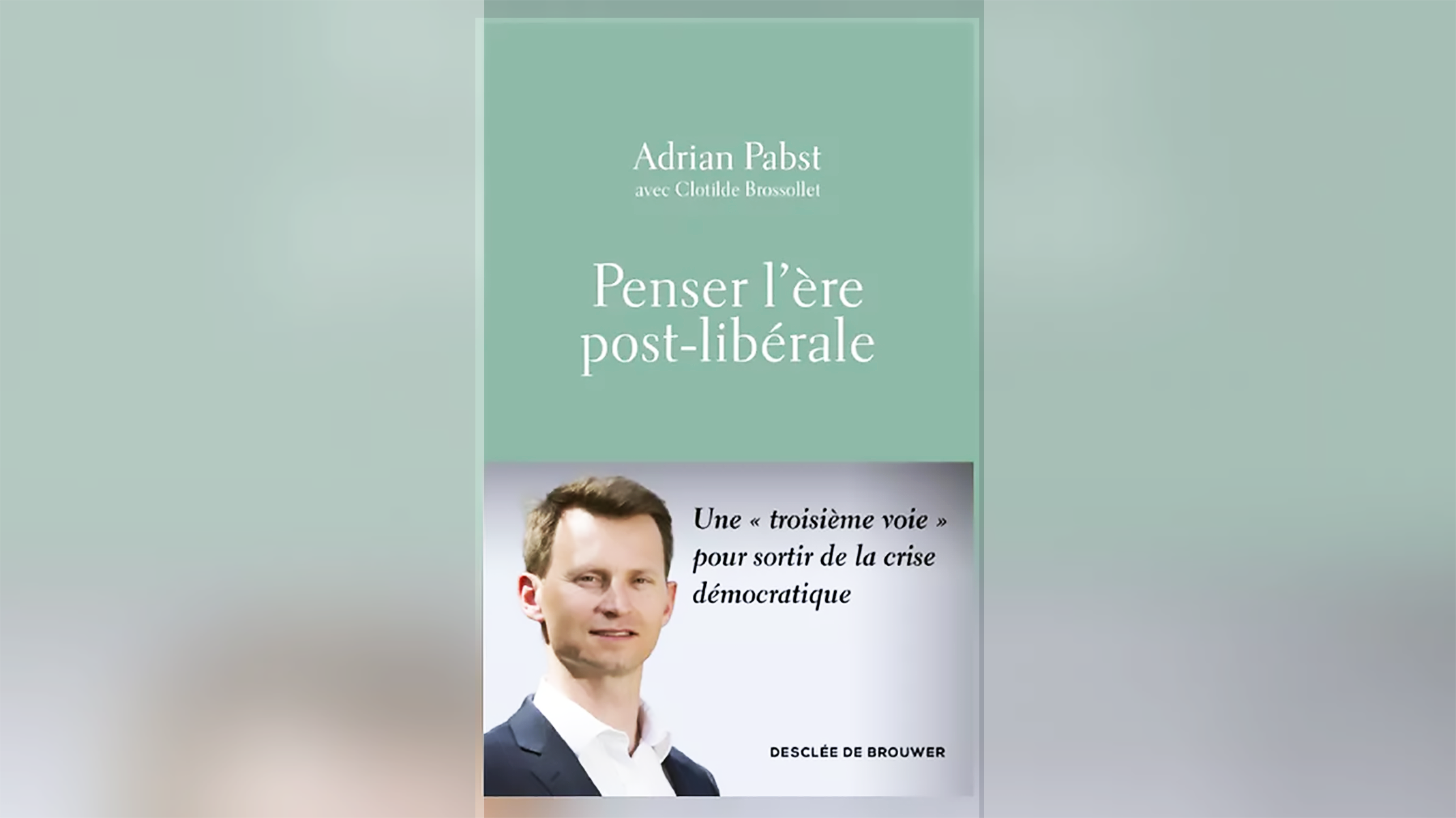
COMMENTAIRE – Cette chronique, fort intéressante, est parue le 6 de ce mois dans Le Figaro. La critique qu’elle formule du libéralisme, du consumérisme, du déracinement, de l’homme et de la société devenus sans qualité, ainsi que sa référence au christianisme et à la doctrine sociale de l’Église, sont de bon augure.
Fallait-il pour autant céder au goût immodéré de la symétrie, et renvoyer dos à dos les orientations mortifères justement dénoncées et la réaction des courants qui cherchent à en sortir, à retrouver l’ordre vrai des sociétés humaines et des personnes elles-mêmes, aujourd’hui empêchées — comme le disait Pierre Boutang — de vivre naturellement ?
Il est dommage de recourir à cette commodité, trop facile et trop banale. On souhaiterait mieux !
CHRONIQUE – Le nouveau livre du philosophe Adrian Pabst, Penser l’ère post-libérale, est une synthèse percutante d’un courant de pensée méconnu en France qui espère sauver le sens de la vie commune face aux impasses du modèle libéral.
Commençons par « l’antidépresseur ». D’après une étude de la Dress, 11 % des Français souffriraient d’un syndrome dépressif. Et le simple fait que l’antidépresseur soit évoqué comme un produit de consommation courante est symptomatique de la banalisation du mal-être. Michel Houellebecq, que cite Adrian Pabst, en impute volontiers la responsabilité au libéralisme : « Nous refusons l’idéologie libérale parce qu’elle est incapable de fournir un sens, écrit-il, une voie à la réconciliation de l’individu avec son semblable dans une communauté que l’on pourrait qualifier d’humaine. »
La personne humaine contre l’homo economicus
La dissolution des communautés humaines est un aspect central de la crise moderne. À force de sanctifier l’individu et ses droits, le paradigme libéral a fait fi de ses liens, dénoncent les post-libéraux. Empruntant au personnalisme d’Emmanuel Mounier, ils préfèrent la notion de personne, qui s’épanouit dans la relation à l’autre, à celle d’individu, monade isolée et autoréférentielle. Chercher un « amant » sur un site de rencontres extraconjugales touche en l’occurrence à la quintessence de la dissolution de la personne et de la communauté dans l’individu roi, caché et perdu derrière son anonymat.
S’arrêter ici reviendrait à faire abstraction de la question morale. Or la morale n’est pas un mot tabou pour le post-libéralisme. Le titre du précédent livre d’Adrian Pabst, coécrit avec le théologien anglican John Milbank, est éloquent : La Politique de la vertu (Desclée de Brouwer, 2018). Les post-libéraux reprochent au libéralisme d’avoir « signé la victoire du vice sur la vertu » et consacré « le triomphe de l’égoïsme, de l’avidité, du soupçon et de la coercition sur les bénéfices communs, la générosité, la confiance envers autrui et le pouvoir de persuasion ».
La pensée post-libérale s’engage à renouveler la notion de “libéral” dans son sens ancien de générosité, de tolérance et de civilitéAdrian Pabst
C’est ici moins le libéralisme économique qui est en cause que l’extension de sa rationalité à l’ensemble de la sphère sociale. « La pensée post-libérale s’engage à renouveler la notion de “libéral” dans son sens ancien de générosité, de tolérance et de civilité », précise l’auteur. Car, dans un monde où l’on considère la personne humaine comme un homo economicus qui optimise ses choix individuels au mépris de toute notion de bien commun, comment croire encore en la vertu ? Adrian Pabst et ses amis ne désespèrent pas. Ils plaident pour une « pratique renouvelée des vertus : les vertus classiques du courage, de la justice et de la prudence, mais aussi les vertus sociales, comme la fraternité, le devoir, la loyauté, l’humilité et l’honneur ».
L’ultralibéralisme, entre émancipation et contrôle coercitif
Ce programme peut paraître suranné : c’est le signe que les post-libéraux visent juste. Dans un monde sans Dieu, la vertu est has been. À force de persuader les hommes, depuis Thomas Hobbes et John Locke, qu’ils sont naturellement vicieux, ils ont fini par le croire. Nous avons adhéré sans forcément le savoir à une conception utilitariste de la politique, cru que gouverner des nations revenait à maximiser le bonheur de chacun des citoyens. Adrian Pabst refuse d’adhérer à cette conception : « Le politique n’est pas une science utilitaire dont le but serait de maximiser le bonheur du plus grand nombre, mais bien plutôt une pratique du jugement au service du bien commun et de l’eudaimonia (la quête du bonheur comme finalité de la vie humaine chez Aristote, NDLR). »
Derrière ce plaidoyer candide pour le bonheur de la cité se trouve une critique acérée des normes qui régissent nos sociétés. « Une grande partie du libéralisme du XXe siècle nie toute notion de bien en soi et transcendant, au bénéfice des droits individuels, diagnostique le professeur honoraire à l’université du Kent. Cela a pour effet de dépolitiser certaines questions fondamentales, comme celles de l’impact de la mondialisation et de l’immigration de masse sur la société, tout en confiant les décisions ultimes à des bureaucraties non élues, à des organismes para-étatiques ou aux tribunaux. »
Tout ce qui est injuste doit être légalement proscrit et, à l’inverse, tout ce qui n’est pas proscrit doit être non seulement permis mais aussi considéré comme objectivement souhaitableAdrian Pabst
Adrian Pabst observe finement que « l’ultralibéralisme a comme conséquence une oscillation quasi hystérique entre émancipation et contrôle coercitif ». On sanctuarise de nouveaux droits individuels et, dans le même temps, on dépêche par exemple des policiers chez des citoyens britanniques ayant eu le malheur de tweeter des propos jugés « offensants ». Cette double dialectique s’explique selon l’auteur par un présupposé de la théorie libérale : « Tout ce qui est injuste doit être légalement proscrit et, à l’inverse, tout ce qui n’est pas proscrit doit être non seulement permis mais aussi considéré comme objectivement souhaitable. » Conséquence : « La liberté légale se métastase en despotisme juridique. » Pabst souscrit en ce sens aux analyses de Marcel Gauchet, pour qui « le libéralisme met la démocratie en crise ». Il observe que les peuples occidentaux ne considèrent plus la démocratie comme « capable de résoudre les principaux problèmes justement parce qu’elle ne représente ni la majorité ni la vertu républicaine ». Le principe majoritaire se heurte aux droits individuels, et la politique est réduite à s’emparer de questions techniques qui paramètrent la coexistence des citoyens.
Face à cette impasse, que faire ? Inspiré par le catholicisme social, le philosophe se place sous les auspices de Léon XIII : « À qui veut régénérer une société quelconque en décadence, on prescrit avec raison de la ramener à ses origines » (Rerum novarum). Adrian Pabst appelle de ses vœux une « troisième voie » pour sortir du « clivage mortifère pour la démocratie entre ultralibéralisme progressiste et populisme démagogique, tous deux aux tendances autoritaires ». Car, dans la guerre des préfixes, le post-libéralisme s’oppose à la fois au néolibéralisme et à l’illibéralisme. Politiquement, des Britanniques comme Maurice Glasman incarnent ces idées. Fondateur du Blue Labour et membre de la Chambre des lords, il confiait cet été au Figaro Magazine son admiration pour le général de Gaulle et le gaullisme social. Il plaidait aussi pour une politique à l’échelle de la paroisse. Car c’est aussi cela, le post-libéralisme : faire de la politique à hauteur d’homme, comprendre que, la solidarité, ce n’est pas seulement cotiser pour la Sécu, mais donner un coup de main à son voisin, le croiser à la messe ou au conseil municipal, jouer au foot avec lui. Quelque chose qui s’approche de l’amour du prochain. ■ MARTIN BERNIER













Guerre des préfixes, jungle des « ismes ». Il faut bien justifier son statut d’intellectuel jargonnant. Remettre de la morale et de l’humanité dans l’énorme édifice tcchnocratique ? Qui en refuserait l’idée ? Mais la recension de M. Bernier échoue à me donner envie de lire le livre de M. Pabst. Que n’a-t-il simplement présenté un exemple de solution d’un cas réel dans le respect des principes proposés !
Dans le commentaire initial il est question d’un renvoi dos à dos. malgré plusieurs lectures, je n’ai pas trouvé le dos de l’adversaire.
Bien d’accord avec Marc Vergier, et j’en rajoute même deux ou trois couches : je parlerai de «l’inflation», pour parler comme ces analystes au byzantinisme peu querelleur mais assez cuistre, inflation des sempiternellement mêmes tournures, incurablement démocratistes, républicanistes, libéralistes et, donc, insupportablement inutiles. Cela sent le soufre du «peuple, par le peuple, pour le peuple», comme si cela pouvait avoir le moindre sens hiérarchique ! Or, c’est ce sens-là qui fait diaboliquement défaut dans à peu près toutes les cervelles qui croient avoir reçu le don de penser pour les autre. Eh bien non ! Il y a déclinaison politique de la bouche jusqu’au pied : les orants sont nés de la bouche de Dieu ; les guerriers, de Ses bras ; les bourgeois-paysans, de Ses jambes ; les serfs de Ses pieds. Les universitaires ne sont pas prévus, ni les journalistes – ce sont des superflus –, tandis que les poètes et artistes appartiennent préférentiellement à la caste des guerriers, mais peuvent aussi servir chacune des castes qui est la leur et où ils occupent une place, en quelque sorte, privilégiée. Les «orants» ayant pour fonction la «prière», bien sûr, mais aussi le haut enseignement.
Tant que chacun de nous n’occupera pas la place socio-culturelle qui est la sienne, l’anarchie fera peser sa tyrannie sur tous – dans son «Paradis perdu», Milton désigne Satan comme étant «le grand anarque», du moins est-ce dans ces termes que Chateaubriand a traduit en français…