
Trente ans de djihad et d’expériences politiques désastreuses ont convaincu le cœur des sociétés d’Égypte et du Maghreb de sa nocivité. Il n’en reste pas moins que d’aucuns, à Alger comme à Damas, ne seraient pas mécontents que la France renoue avec la guerre civile religieuse, à laquelle ils ont amèrement goûté.
Par Pierre Vermeren.

Cette tribune est parue dans Le Figaro du 22.11. Nous n’y ajouterons pas de commentaire superflu. Sauf qu’on croyait, dans la seconde moitié du siècle dernier, à l’effacement proche et certain du religieux du cœur des sociétés humaines. Cette opinion, faite en réalité de l’orgueil moderniste, a eu le sort que l’on sait. Et cet article de haute volée, comme généralement ceux de Pierre Vermeren, nous en donne des illustrations inquiétantes et proches. Elles sont déjà notre aujourd’hui et portent d’assez noires perspectives pour les décennies à venir. À la charge des générations montantes. JSF
TRIBUNE – L’esprit de suffisance et l’aveuglement de nos dirigeants, qui refusent aussi bien de prendre en compte les réalités économiques et culturelles que de faire appel au peuple, rappellent notamment la crise qui a fini par emporter l’Ancien Régime sous Louis XVI, analyse l’historien.
Normalien et agrégé d’histoire, spécialiste du Maghreb, Pierre Vermeren est l’auteur de nombreux ouvrages salués par la critique. Il a notamment publié Dissidents du Maghreb. Depuis les indépendances (Belin, 2018), Déni français. Notre histoire secrète des relations franco-arabes (Albin Michel, 2019) et Histoire de l’Algérie contemporaine (Nouveau Monde Éditions, 2022).

Les propos médiatiques convenus sur le monde arabe et ses nations amies de la France ne nous aident pas à comprendre leurs enjeux internes, ni ce qui se joue sur place. Quatre entraves font obstacle à notre compréhension : l’ignorance générale de nos élites sur ces régions, aggravée par un mélange de culpabilité et de bons sentiments ; les ingérences étrangères des États arabes, directes ou indirectes (par agents stipendiés) qui faussent le regard pour des intérêts politiques, affairistes ou idéologiques ; les représentations propulsées par la sphère omniprésente des islamistes, qui ont compris l’ignorance et la disponibilité de nos concitoyens, et qui usent des réseaux sociaux pour leur faire accepter les positions les plus incompatibles avec notre civilisation (sur les femmes en premier lieu) ; enfin, les « complices du mal » « made in France », si bien décrits par Omar Youssef Souleimane, qui démontre de manière chirurgicale la manière dont la cause arabe – palestinienne en l’occurrence – est instrumentalisée pour servir un projet révolutionnaire français aux antipodes des valeurs qu’il proclame – car, pour la cause, allié objectif et stratégique des pires régimes dictatoriaux et théocratiques de la planète.
Des créateurs arabes comme les romanciers algériens Boualem Sansal (Le Village de l’Allemand ; 2084 : la fin du monde) et Kamel Daoud (Houris), des cinéastes, comme le suédo-égyptien Tarik Saleh (Le Caire confidentiel, La Conspiration du Caire et Les Aigles de la République), ou des essayistes comme le Syrien Omar Youssef Souleimane (Les Complices du mal) nous permettent de faire fi de ces pare-feu, et d’accéder directement aux maux, aux terreurs et aux imaginaires qui travaillent les sociétés arabes et berbères de Méditerranée.
La « trilogie du Caire » de Saleh (clin d’œil à la trilogie du Caire de Naguib Mahfouz) n’y va pas par quatre chemins : elle cible les trois maux qui asphyxient la région et y empêche toute éclosion démocratique : la corruption – mère de tous les maux – ; l’islamisme – mère des hypocrisies, comme l’a révélé le bref passage au pouvoir des Frères musulmans – ; et la dictature, qui tient l’ensemble, à la fois cause et conséquence. Elle est en effet le cocon de la corruption, la cause de l’islamisme – car elle jette le peuple dans la quête d’une morale sociale –, et son antidote, elle seule étant capable d’« écraser l’infâme ».
Sansal cible les mêmes maux que Saleh, mais dans des fictions appliquées à l’Algérie.
Les Européens endormis
Tarik Saleh semble fasciné par les chefs politiques des Mukhabarat – services de renseignements et police politique confondus –, ces deus ex machina sélectionnés parmi les cadres les plus intelligents et les plus cyniques des régimes arabes. L’Iran de Qassem Soleimani fonctionnait d’ailleurs à l’identique. Pour eux tout est possible, puisque leur action ne se heurte à aucune limite morale, humaine ou financière, pour servir l’État, son dictateur, ses affidés et leurs intérêts. Dans La Conspiration du Caire, l’efficacité et la ruse des Mukhabarat, prennent le visage du colonel Ibrahim de la Sécurité d’État – Amn Ed-Daoula –, chargé d’éviter l’élection d’un cheikh islamiste à la tête d’el-Azhar. Il révèle – au prix du sang – la supériorité intellectuelle de l’État sur l’islam institutionnel. Dans Les Aigles de la République (Noussour el-Joumhoureya), le Dr Mansour – le chef aux yeux d’aigle de la Sécurité d’État –, déjoue sans scrupule un complot noué par le ministre de la Défense et ses « aigles » autoproclamés. L’intrigue permet au cinéaste de dévoiler les mécanismes grotesques – vus dans son regard – d’une dictature en terre arabe, en ce qu’elle porte aux nues le dictateur et son œuvre, au prix de coups tordus et de tous les mensonges, au milieu de courtisans dans un décor de carton-pâte. Au risque de la vie des citoyens ou de leurs proches s’ils contreviennent à la loi imposée du silence.
Si Tarik Saleh nous donne à voir ce spectacle, c’est qu’il est Suédois de nationalité, qu’il est un réalisateur financé en Europe, et qu’il peut tourner ses films à Casablanca et à Istanbul. La perspective d’une première projection au Caire y avait affolé tous les censeurs de service, auxquels il rend la monnaie de leur pièce dans son dernier opus. Une telle mise en scène des pouvoirs dictatoriaux est exceptionnelle, tant sont rares les conditions qui la permettent. Nul risque de voir de telles images en Europe sur les pouvoirs amis du Maghreb ou… de Syrie. Mais romans et essais prennent la main, ce qui vaut à leurs auteurs l’injure et la prison (Sansal), l’exil et des poursuites pénales (Daoud) ou des menaces de morts (Souleimane).
Sansal cible les mêmes maux que Saleh, mais dans des fictions appliquées à l’Algérie. Il questionne en particulier la manière de qualifier et de traiter l’islamisme pour le combattre : « Nous avons construit des outils pour dénoncer le soviétisme et le nazisme, mais on peine à analyser le phénomène de l’islamisme, alors qu’il n’est pas si différent. » Ayant comparé sans ambiguïté, dans Le Village de l’Allemand ou le Journal des frères Schiller (2008), le nazisme et l’islamisme à travers leur emprise et leur barbarie, il use du romanesque pour susciter la prise de conscience de ses lecteurs français. Il voudrait leur épargner de revivre, sous une forme ou sous une autre, la tragédie algérienne des années 1990, tant la machine totalitaire en marche est intacte.
Son évocation de la « décennie noire » en Algérie (la tragédie de la guerre civile des années 1992-2001) y a déjà fait interdire son livre. Mais comment convaincre les Européens endormis, voire subjugués par l’altérité, de la réalité de ce totalitarisme aussi vieux que ses prédécesseurs, qui hait comme eux l’individualisme démocratique blasé, et cette joie de vivre à laquelle aspirent la plupart des habitants de l’Afrique du Nord ? Trente ans de djihad et d’expériences politiques désastreuses ont convaincu le cœur des sociétés d’Égypte et du Maghreb de sa nocivité. Il n’en reste pas moins que d’aucuns, à Alger comme à Damas, ne seraient pas mécontents que la France renoue avec la guerre civile religieuse, à laquelle ils ont amèrement goûté.
Une tragédie sans nom
Or l’indifférence passive des Français et des Européens agit à la manière d’un édredon. Même la nuit de cristal à bas bruit que vivent les Juifs d’Europe de l’Ouest depuis deux ans – et qui restera en France le marqueur de ces tristes années – ne parvient pas à les réveiller ; même dans ce pays parmi les plus philosémites du monde. La vague antisémite qui s’est levée contre les Juifs d’Europe le jour même du pogrom/razzia du 7 octobre 2023 indique que les mécanismes de la haine ne demandaient qu’à être activés, avant même la tragédie de ces deux ans. Comment une élue de France au Parlement Européen peut-elle, en 2025, commenter une vidéo devant des millions de personnes, où l’on voit des miliciens du Hamas abattre de dos à la kalachnikov des « traîtres » palestiniens, agenouillés et les yeux bandés – quelques jours après le cessez-le-feu –, « Un après l’autre », dit-elle dans une approbation glaciale ? La scène laisse sans voix. De même en est-il de cette personne, toujours inconnue, qui a fait applaudir par un amphithéâtre d’étudiants dans une université française, le pogrom/razzia du 7 octobre 2023, avec une voix mécanique et glaçante : « Nous y étions prêts », dévoilant ainsi cette mécanique de la haine assassine décrite par Sansal.
Dans son roman sans concession ni apitoiements, Daoud explore les tréfonds de l’âme algérienne écartelée entre la conjonction des peurs de Dieu, de l’État et des barbus.
Dans un registre complémentaire qui fait écho à Sansal, Kamel Daoud a décidé, dans Houris, de reprendre de manière poétique et romancée, mais aussi crue et sans tabous, le passif de la guerre civile algérienne, cette fois du côté des victimes de la tragédie sans nom. En effet, cette décennie noire est plus que jamais interdite d’évocation, d’archives et d’histoire dans son propre pays ; par conséquent, cette « guerre invisible » (Stora) l’est demeurée tout autant dans le reste du monde, faute d’historiens et de juges. La licence poétique de Daoud n’a pas abusé la censure. La police politique s’est saisie de son cas avec célérité, pour instruire son procès et provoquer l’exil de l’écrivain.
Dans ce roman sans concession ni apitoiements, Daoud explore les tréfonds de l’âme algérienne écartelée entre la conjonction des peurs de Dieu, de l’État et des barbus. L’errance parcourt les routes de l’Oranie jusqu’aux monts de l’Ouarsenis, dans la remémoration d’un massacre de masse inspiré de faits réels – situé dans le roman le 31 décembre 1999, à Had Chekala –, d’êtres brisés et moralement lacérés. L’errance est moins physique que spirituelle. Les narratrices nous ouvrent les replis de leur âme et de leurs angoisses face à une société travaillée par ses démons. Rarement, on a si profondément et dans un tel corps à corps exploré les méandres de la douleur, dévoilé le cheminement de l’intime, éclairé avec crudité les souffrances d’êtres blessés, ballottés et hantés par les croyances, les démons, les peurs, les péchés et les interdits – ceux de Dieu et ceux du qu’en-dira-t-on. Le diable est d’abord dans les mots. Pour le critique littéraire en ligne du Carep (Centre arabe de recherche et d’études politiques de Paris, où s’est tenu un récent colloque sur la Palestine), manifestement chargé de discréditer le roman, Daoud y manifeste « son » approche « réactionnaire » et « culturaliste ». Ce mot-clé du dénigrement, chez les initiés des sciences sociales, signifie que le djihad évoqué au cœur de la société algérienne n’aurait en réalité aucun lien avec le contexte culturel islamique de l’Algérie.
« Les complices du mal »
Enfin, Souleimane, jeune homme de grand courage, porte le combat politique sur le sol de France, treize ans après son arrivée dans ce pays dont il a adopté avec une passion manifeste les mœurs, la langue et les idéaux civilisationnels. Effrayé par le spectacle qu’il a observé un an durant dans le militantisme de l’extrême gauche « islamismophile », Souleimane offre un récit saisissant. LFI et ses alliés se nourrissent, par tiers-mondisme et désormais par antisémitisme, des projections mythifiées de la révolution islamique et du Hamas, vu comme une avant-garde combattante, pour alimenter leur haine de l’Occident. Leur agenda révolutionnaire, en rupture avec l’histoire politique qui lui a donné corps, est en symbiose avec le fréro-salafisme et ses parrains étrangers. Les antifascistes de profession sont devenus « les complices du mal », à rebours d’un monde arabe où « l’extrême droite » islamiste est l’ennemie jurée des gauches. Mais son récit n’en reste pas là.
Après la chute de Bachar el-Assad en décembre 2024, Souleimane est rentré pour quelque temps dans son pays et dans sa ville d’Homs. S’il a bien perçu la conquête des libertés retrouvées dans les rues et sur les places de la ville de sa jeunesse, il a aussi observé la montée des barbus qui paradaient dans les rues, menaçant des minorités terrorisées, et traquant les libertés suivant les interdits que forge l’islam politique. Alors que le chef djihadiste de la guerre civile, devenu président costumé de l’État syrien, serre la main des puissants du monde, de Poutine à Trump, celui-ci sera-t-il le réconciliateur de la Syrie, comme l’espèrent nos dirigeants, ou l’arbre qui cache la forêt des haines et des revanches cruelles, comme le craignent tant de Syriens ? Déjà, beaucoup s’enfuient de Syrie ou tentent de le faire, tandis que l’immense diaspora circonspecte – 20 % de la population – tarde à rentrer au pays. Nul ne connaît l’avenir, mais on est prévenu.o ■ o PIERRE VERMEREN
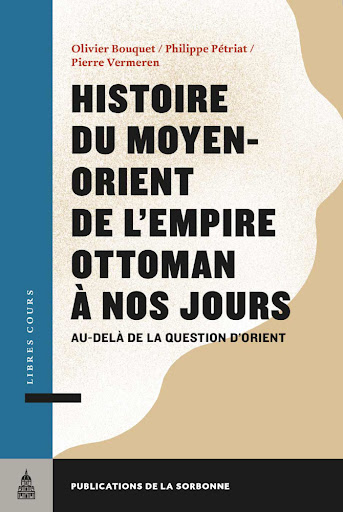












Ne pas mourir pour Kiev comme hier pour Dantzig. Là aussi la provocation était à l’oeuvre.