
À l’occasion, au mitan du XIXe siècle, de la parution des Prophètes du passé de Barbey d’Aurevilly, essai qui contient notamment un hommage à la grande figure contre-révolutionnaire Louis de Bonald, cet immense critique littéraire qu’était Charles-Augustin Sainte-Beuve signa un article-fleuve pour le Constitutionnel du 18 août 1851 où il présenta l’essentiel de sa vie et de sa pensée.
Retrouvez-le toute cette semaine, découpé en six parties.
Tout le monde, ou du moins une grande moitié du monde, dit tous les jours que la société est au bord de l’abîme, qu’elle s’en va périr avec la propriété ; avec la famille, avec toutes ses institutions angulaires et fondamentales, qu’on est en face de la barbarie pure. Ce cri d’alarme, qui échappe aujourd’hui aux modérés mêmes et aux satisfaits d’hier, reporte naturellement le souvenir vers les hommes qui ont poussé ce même cri il y a cinquante ans, qui n’ont cessé de le proférer jusqu’à leur dernier soupir, et qui, dans notre jeunesse, nous semblaient des vieillards augustes et moroses, de lamentables augures. Avaient-ils donc raison contre toutes nos hardies idées d’alors, contre nos jeunes espérances ? et leur donnerons-nous raison à notre tour ? Ce n’est point la question que je vais traiter ; assez d’autres la traitent sans moi. Mais je profiterai d’une publication récente, où un écrivain d’une plume brillante et vaillante, M. Barbey d’Aurevilly prend hautement le parti de ceux qu’il appelle les Prophètes du Passé, et nous retrace, à côté de la grande figure e Joseph de Maistre, la figure ingénieuse, et forte de Bonald, pour dire mon mot sur ce dernier, et pour assigner les principaux traits de sa manière.
C’est de ce même M. de Bonald que M. de Lamartine, après l’avoir chanté en poète dans sa jeunesse, vient de donner un portrait tout aimable et adouci à la fin du second tome de son Histoire de la Restauration. Voilà, ce me semble, des occasions et des appuis pour qui veut aborder l’étude d’un caractère. Qu’on veuille être tranquille d’ailleurs : je n’ajouterai pas un mot à ce que je crois vrai sur ce penseur supérieur et respectable.
Le vicomte de Bonald, que nous avons vu mourir le 23 novembre 1840, âgé de quatre- vingt-six ans accomplis, était né le 2 octobre 1754 à Milhau, dans le Rouergue. Il sortait d’une de ces vieilles familles provinciales qui avaient servi à la fois avec honneur dans les parlemens et dans les armées. Il vint faire ses études dans une pension à Paris, puis à Juilly chez les Oratoriens. Il ne prit de cette éducation que la partie fructueuse et solide, et ce qui s’y mêlait déjà de philosophique et de libre ne l’atteignit pas. Il sortit de là pour être mousquetaire, assista aux derniers momens de Louis XV, reçut un jour au passage un regard charmant de la jeune et nouvelle reine Marie-Antoinette : il paraît que ce furent là les plus vifs souvenirs de ce jeune mousquetaire au cœur simple, à la figure noble et pleine de candeur. M. de Bonald échappa entièrement par ses mœurs à la corruption du XVIIIe siècle. Rentré dans ses foyers à vingt- deux ans lors de la suppression du corps des mousquetaires (1776), il se maria et vécut de la vie de ses pères. Il fut maire de Milhau, sa ville natale, depuis le 6 juin 1785 jusqu’au 23 juillet 1790, date à laquelle il fut nommé à Rhodez membre de l’Assemblée du Département. Mais il donna bientôt sa démission de cette dernière place, et il crut de son honneur d’émigrer. Toutes ces circonstances de la vie de M. Bonald sont racontées avec simplicité, et avec un sentiment très vif de religion domestique, dans une Notice écrite par l’un de ses fils, M. Henri de Bonald.
M. de Bonald avait donc bien près de quarante ans, et il n’avait pas songé à écrire ni à devenir auteur. Les grands événemens dont il était témoin et en partie victime dégagèrent en lui la pensée forte et un peu difficile, et ce fut aux coups redoublés de l’orage qu’il sentit qu’il avait des vérités à exprimer. Après le licenciement de l’armée des Princes, redevenant homme de famille, il vint se fixer à Heidelberg et se consacra à l’éducation de ses deux fils aînés, qu’il avait emmenés avec lui. Au milieu de ces soins tout paternels, il composa son premier écrit, qui contient déjà tous les autres, et qu’il fit imprimer à Constance par des prêtres émigrés qui y avaient établi une imprimerie française : THÉORIE DU POUVOIR POLITIQUE ET RELIGIEUX DANS LA SOCIÉTÉ CIVILE, démontrée par le raisonnement et par l’histoire, par M. de B…., gentilhomme français, 1796. C’est le titre exact. M. de Bonald avait pris pour épigraphe cette phrase de Rousseau dans le Contrat Social : « Si le Législateur, se trompant dans son objet, établit un principe différent de celui qui naît de la nature des choses, l’État ne cessera d’être agité jusqu’à ce que ce principe soit détruit ou changé, et que l’invincible Nature ait repris son empire. » — M. de Bonald se réservait de prouver qu’ici la Nature n’était autre chose, que la société même la plus étroitement liée et plus forte, la religion et la monarchie.
Ce livre de Bonald appartenait à cette littérature française du temps du Directoire et extérieure à la France, qui se signala par de mémorables écrits et des protestations élevées contre les productions du dedans : cette littérature extérieure produisait de son côté, à Neuchâtel, en Suisse, les Considérations de Joseph de Maistre sur la Révolution française, 1796 ; à Constance, le livre de Bonald ; à Hambourg, la Correspondance politique de Mallet du Pan en cette même année 1796, et le Spectateur du Nord, brillamment rédigé par Rivarol, l’abbé de Pradt, l’abbé Louis, etc. ; à Londres, l’Essai sur les Révolutions de Chateaubriand, 1797. On voit que la pensée plus ou moins restauratrice, refoulée par le triomphe de l’idée philosophique et révolutionnaire, réagissait à son tour et faisait chaîne autour de la France. Le livre de Bonald, introduit en France et expédié de Constance à Paris, fut en grande partie saisi et mis au pilon par ordre du Gouvernement : il n’eut donc pas d’effet et fut alors comme non avenu. Mis même en circulation et livré à la publicité, il n’aurait pu avoir d’ailleurs aucune influence, à cause de sa forme obscure, difficile et dogmatique. Ce sont de ces ouvrages qui ne s’ont faits que pour être médités et extraits par quelques-uns. ■ (À suivre)

Pierre Boutang trouvait qu’« une espèce de perfection guerrière » caractérise l’essai de Charles Maurras Trois idées politiques, qui fut composé en 1898 et légèrement augmenté en 1912.
Dans ce volume c’est l’esprit grec dans toute sa pureté, sa splendeur, sa perfection, qui s’exprime ; une citation d’Anaxagore sur le « Noûs », l’Intelligence, ne vient pas figurer par hasard.

Si Maurras décida de traiter de trois idées, celle de Chateaubriand, puis celle de Michelet, et enfin celle de Sainte-Beuve, c’est qu’il s’attache à la démarche épistémologique grecque du ternaire, que l’on retrouve dans les règles de la rhétorique (ethos, logos, pathos), ou de la formulation d’un raisonnement (thèse/antithèse/synthèse ou les articulations d’un syllogisme : prémisses majeures et mineures dont on tire une conclusion), qui au fond découlent du grand principe d’identité entre le bien, le vrai et du beau, du principe que l’Un se réalise dans le Trois.
Cet ouvrage est le discours de la méthode maurrassien, où il développe son idée d’« empirisme organisateur » et expose son intention profonde : regrouper Le Play et Taine, Comte et Bonald, soit deux écoles a priori antagoniques, le positivisme et les contre-révolutionnaires.
Maurras rejette autant ceux pour qui l’âge d’or se situe uniquement dans le passé – Chateaubriand – que ceux qui ne le voient que dans le futur – Michelet –, érigeant le maître de la critique littéraire Sainte-Beuve en antidote de ces deux apories, celui qui marche sur ces deux jambes, quand l’un marche sur quatre et l’autre sur trois, pour reprendre l’énigme du Sphinx. ■
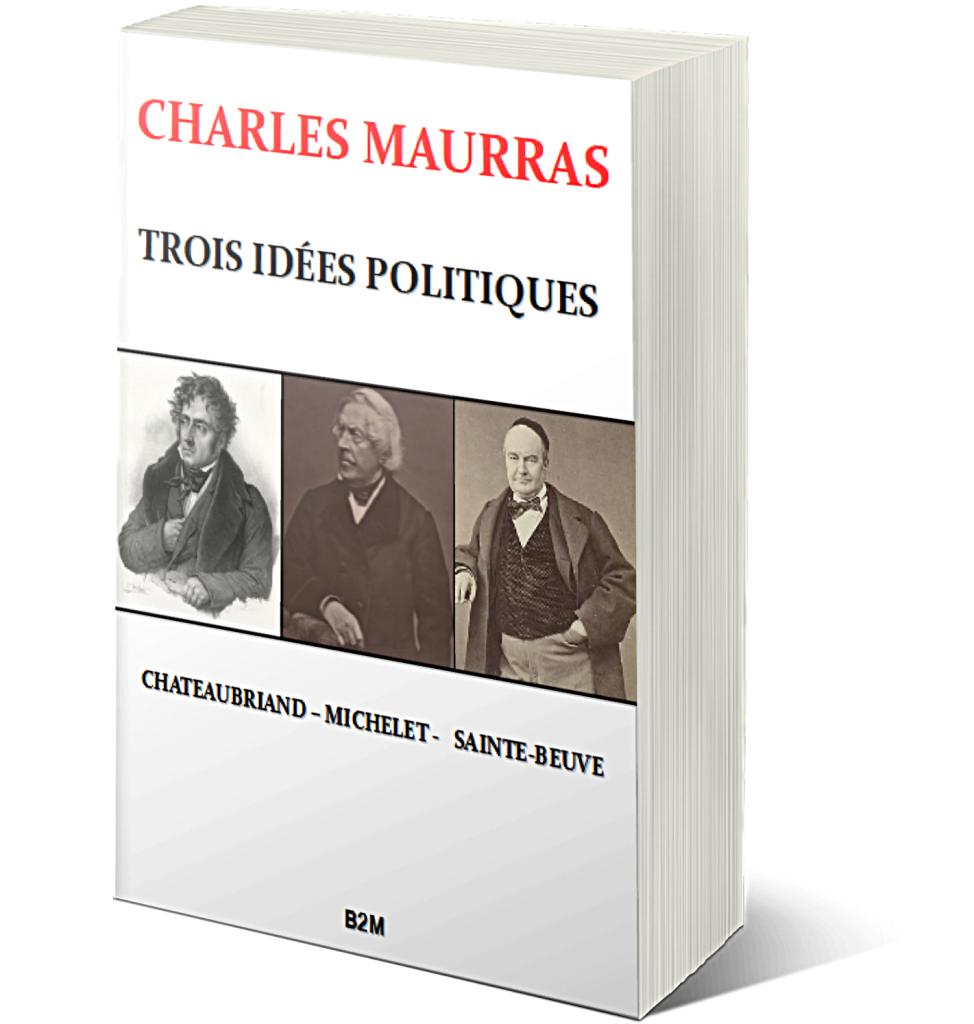
Nombre de pages : 92
Prix (frais de port inclus) : 21 €
Commander ou se renseigner à l’adresse ci-après : commande.b2m_edition@laposte.net ou Belle de Mai Éditions











