
Cette chronique est parue dans Le Figaro d’hier, 20 décembre. Nous nous abstiendrons de la commenter. Elle va au-delà — sans pour autant l’exclure — de la religion identitaire sur laquelle Éric Zemmour met aujourd’hui principalement l’accent et qu’il considère comme l’un des substrats de son action politique. Mathieu Bock-Côté met plutôt en évidence le besoin convergent d’une véritable transcendance, tant pour la personne humaine que pour la société, pour la Cité elle-même. Il explore cette grande question dans toutes ses dimensions. Inutile d’en dire davantage. JE SUIS FRANÇAIS
Par Mathieu Bock-Côté.
CHRONIQUE – Les polémiques suscitées chaque année par l’installation et l’interdiction de crèches nous font perdre de vue que la religion populaire est peut-être plus forte qu’on ne le croit.

Dans cette histoire sans fin qu’est la guerre contre Noël, qui se fixe cette année sur l’histoire des crèches qu’on pourrait ou non exposer en mairie, chaque camp se croit appelé à renouveler ses arguments. Les partisans de Noël, appelons-les ainsi, expliquent que cette fête s’est depuis longtemps affranchie de ses origines, qu’elle est moins cultuelle que culturelle. Qu’elle ne serait même plus religieuse. Même la crèche relèverait d’une tradition populaire n’ayant plus grand-chose à voir avec le christianisme, sauf de manière résiduelle. On pourrait alors l’installer sans gêne, même dans la joie. Elle rajouterait une touche de folklore à notre quotidien fade, encombré de produits jetables sans âme. C’est ainsi qu’ils répondent aux croisés laïcs et aux militants diversitaires, les premiers s’indignant de voir une trace religieuse dans la vie publique, les seconds jugeant encore pire que la religion historique de l’Europe prédomine symboliquement en Europe.
Mais la question surgit inévitablement : une tradition coupée de sa source ne risque-t-elle pas, à terme, de s’assécher, de n’être plus qu’un rituel sans vie, un décor animé posé dans une société qui n’y comprend plus rien ? Et une civilisation qui se décrète absolument étrangère au fait religieux en est-elle encore une ? Le marxisme a voulu convaincre que la religion était l’opium du peuple, une vague compensation spirituelle offerte à l’homme pour lui faire accepter la misère de sa vie sur terre. C’est oublier ici que l’homme est un animal religieux tout autant qu’il est un animal politique, et que depuis la nuit des temps, il scrute le cosmos à la recherche d’un visage, d’un signe, qui viendrait en quelque sorte donner un sens à son passage ici-bas. Les philosophes ont longtemps cherché les preuves logiques de l’existence de Dieu, mais il est plus courant de le chercher par la prière, qui appartient aux pratiques originelles de l’humanité. Mais l’homme contemporain sait-il encore prier ?
La religion, si on veut aborder la chose de haut, repose sur le mystère de la naissance et le scandale de la mort. L’homme, jeté en ce monde, ne se résout pas à n’être dans l’univers qu’un fait divers biologique. Il ne comprend pas trop ce qu’il y fait, et préfère la plupart du temps ne pas trop y penser. Vivre suffit, et l’existence, pour peu qu’on ne soit pas trop mal configuré psychiquement, est une grâce. Mais la quête de la transcendance toujours revient le hanter. Alors il veut croire. Et puisqu’il ne croit pas seul dans son coin, puisqu’il ne s’invente pas dans l’intimité de son foyer une religion individuelle, il en vient à croire, de près ou de loin, à la religion des siens. Certes, il ne croit pas toujours, mais quand il croit à quelque chose, c’est à cela. Cette religion vient avec des rituels, des codes, un imaginaire. Elle structure le rapport à l’absolu d’une civilisation, dans le temps, et si de tout temps, on trouve des incroyants, qui s’amusent ou s’exaspèrent des porteurs d’amulettes et autres adorateurs de colifichets et reliques, on trouve en même temps des incroyants qui, à la veille de leur dernier souffle, aimeraient croire quand même.
Une culture est faite de rituels, une religion aussi, et d’ailleurs, les deux viennent ensemble. Mais la modernité, qui est une religion nouvelle, celle de l’homme qui se divinise, qui voudrait faire de lui-même son propre créateur, et qui est animée par une mystique de l’autoengendrement, tolère bien mal, par définition, le fait religieux traditionnel qui verticalise le sacré et rappelle à l’homme son inachèvement. Qu’en faire, dans la mesure où elle ne peut pas le liquider intégralement ? Elle veut le désencastrer socialement pour en faire une simple croyance privée. La modernité croit trouver une réponse en privatisant intégralement la question des fins dernières. Chacun croira ce qu’il veut. Mais cette religion réduite à une forme de spiritualité désincarnée, loin de culminer dans une foi épurée, rationnellement travaillée, se décompose la plupart du temps en amas de croyances bizarres, relevant de la superstition primaire.
Mais la religion populaire est peut-être plus forte qu’on ne le croit, et dès lors que la culture se christianise, quand décembre revient, la tentation de la foi surgit. Arrive Noël. Ses rituels touchent les cœurs les plus secs, ses chants réveillent non seulement les souvenirs d’enfance, mais ceux des générations antérieures, auxquelles, tôt ou tard, l’homme veut se raccrocher, pour hériter de la meilleure part du monde de son père, et la transmettre à son fils. Le récit d’un Dieu fait homme, prenant le visage de l’innocence d’un nouveau-né, dans un coin du monde qui attendait depuis toujours le messie l’interpelle, le touche, lui arrache peut-être même une larme, en lui donnant envie d’aller à la messe de minuit, et de prier pour la première fois depuis des années. o ■ o MATHIEU BOCK-CÖTÉ
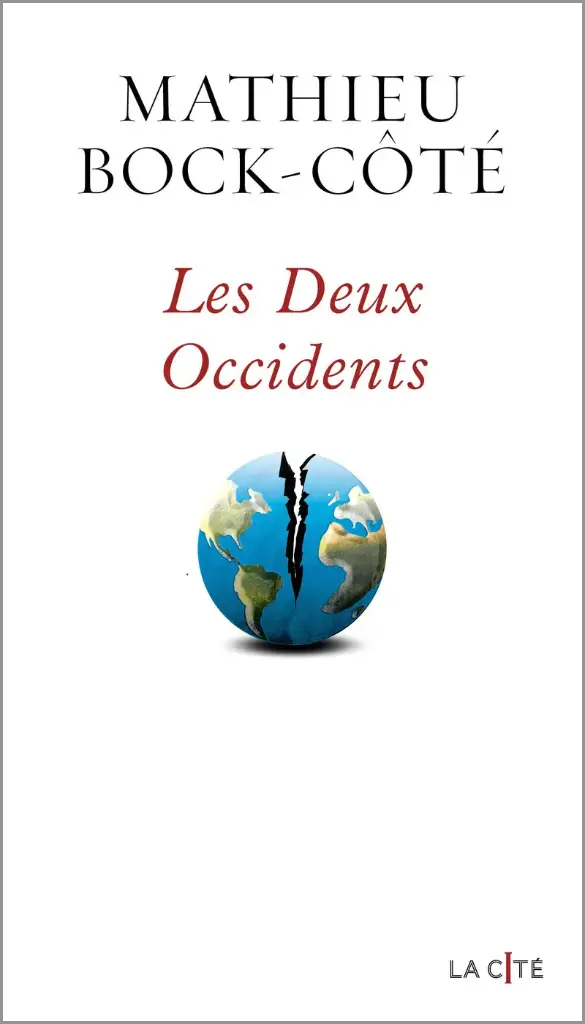
Les Deux Occidents, Mathieu Bock-Côté, La Cité, 288 p., 22 €. sdp











