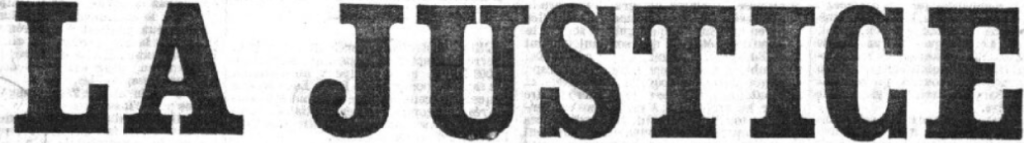
Bel-Ami de Guy de Maupassant sexiste ? C’est un procès qui lui est de plus en plus fait. Procès venu de la presse de gauche : « Maupassant est misogyne parce que, sorti des prouesses de son sexe, il a finalement peur des femmes », écrivait Le Monde dans un article-recension (du 20 novembre 2003, intitulé « Maupassant et son double ») d’une biographie qui lui avait consacrée la docteur ès lettres Nadine Satiat. Rappelons-nous que les médias de gauche lui portaient un regard bien plus bienveillant lors de sa publication, en 1885, chez l’éditeur Victor Havard.
Le journal de George Clemenceau et Camille Pelletan La Justice, était dithyrambique. Le compte-rendu qui fut composé par le critique littéraire Sutter Laumann fut publié le 3 août 1885 :
C’est un coin de la vie parisienne que M. de Maupassant a dépeint, avec plus de brutalité que d’expérience, dans ce livre de Bel-Ami, où l’on voit grouiller les sales êtres de ce monde des « faiseurs » — hommes de bourse véreux, gens de lettres tarés, journalistes vendus, exploiteurs de scandales, maquignons et proxénètes — vermine qui ronge le corps social comme les poux rongent la tête des enfants mal soignés. Et il n’a pas eu grand’peine pour trouver ses types ; seul l’embarras du choix a pu le gêner. Dans ce milieu infect, les sujets ne manquent pas ; la collection de gredins de toute espèce est si complète, si variée, que l’on n’a qu’à prendre au hasard, dans le tas. Ce n’est pas une maigre glane que le romancier peut faire, mais une ample moisson.
Le plaisant est que certains critiques ont eu la naïveté de reprocher à M. de Maupassant d’avoir fait de son principal « héros » un journaliste, et que l’auteur de Bel-Ami a eu la bonté de se disculper dans une lettre publiée il y a quelque temps.
— Quoi ! s’écriaient ces confrères, jaloux de l’honneur de la profession, ne pouviez-vous faire de cet ignoble personnage de Duroy autre chose qu’on publiciste ? Ne pouviez vous lui donner un autre métier ? Où avez-vous rencontré jamais semblable crapule parmi ceux qui distribuent quotidiennement la manne de l’esprit au public ?
Et M. de Maupassant de répondre en substance :
— Duroy n’est pas un véritable journaliste ; c’est un misérable quelconque, ambitieux, jouisseur qui devient journaliste par occasion, par raccroc, et qui est très satisfait de l’être parce qu’il sait bien que le journalisme peut mener à tout, avec un tantinet d’habileté et infiniment peu de scrupules.
Eh bien, voici ce que nous aurions répondu, nous, sans barguigner, en mettant, les points sur les i, à ces très susceptibles confrères qui croient, ou feignent de croire, que le journalisme n’est peuplé que d’honorables écrivains ayant l’âme plus blanche que la blanche hermine et pouvant dire, sans crainte de s’attirer un cruel démenti :
Le ciel n’est pas plus pur que la fond de mon cœur.

Duroy est bel et bien un journaliste. Ce n’est pas un mythe inventé à plaisir ; il existe, en chair et en os, à pas mal d’exemplaires. Chaque jour nous en coudoyons plusieurs sur les boulevards, de la porte Saint-Denis à la Madeleine. Les exigences du métier, de la vie elle-même, — il n’y a que des millionnaires qui pourraient se réfugier dans la fameuse « tour d’ivoire », usent toutes les fiertés, nous contraignent aux plus écœurantes promiscuités : Maintes fois, des Duroy se sont assis à notre table dans ces cafés où se réunissent les gens de la basse et de la haute littérature — reporters et chroniqueurs, romanciers et poètes — et nous avons choqué notre verre contre le leur. Bien mieux : nous avons échangé des poignées de main, quitte à nous laver après, et l’on s’est traité de cher confrère, quand notre intimité, parfois toute superficielle, il est vrai, n’est pas allée jusqu’au tutoiement. Souvent entre nous, ne nous est-il pas arrivé de conter quelqu’une de ces histoires immondes faite de boue et de larmes, quelquefois de sang, qui circulent à petit bruit sur le compte de ces malfaiteurs de lettres, comme monnaie courante de la conversation et qui finissent par éclater au grand jour de la correctionnelle ou de la cour d’assises !
À quoi bon dire non et pourquoi cacher ces turpitudes ? Ne pourrions-nous, si nous ne craignions pas quelque énorme scandale, des procès où la preuve ne peut être fournie, dire crûment ce que nous savons, citer des noms ? Mais à quoi bon ! ce serait un nettoyage incessant à faire ; un coup de balai en appellerait cent, et pour un Duroy démasqué violemment, combien d’autres continueraient tranquilles leur jolie indusdrie! Or c’est déjà une satisfaction sans prix de faire gesticuler de temps à autre un de ces drôles dans quelque bon roman. Pourquoi se priverait-on de cette joie ? Pour l’honneur de la profession ? Est-ce qu’un proverbe ne dit pas : Chaque métier fournit son monde, ce qui, en bon français, signifie qu’il y a des coquins par-tout. Quelle singulière et excessive prétention de vouloir qu’il n’y en ait pas dans le nôtre ! Vraiment, il serait défendu à un romancier de croquer une canaille parce que cette canaille appartient à la presse ou aux lettres, et il lui serait permis de peindre un bandit quelconque à la condition que ce bandit ne soit qu’un banquier, un négociant, un avocat ou un marchand des quatre-saisons. Mais toutes les corporations seraient en droit de protester et il n’y aurait plus aucune liberté pour l’écrivain.
Certes il y a d’honnêtes littérateurs et de propres journalistes, de même qu’il y a de probes commerçants — et c’est encore la majorité, par bonheur. Ceux-là travaillent ferme et restent toujours les simples spectateurs des tragi-comédies infâmes que quelques uns jouent sous leurs yeux. Mais nous pouvons avouer, sans compromettre en rien notre honneur — puisqu’il est avéré que la bassesse de caractère est indépendante de la profession exercée par l’individu — que parmi nous il y a de parfaits ruffians sans foi ni loi, et que les plus minces peccadilles qu’on leur puisse reprocher sont de changer l’opinion comme de chemise, de plagier, de piller sans pudeur le voisin et de faire, sous couleur d’analyse physiologique, de la pornographie à outrance, parce que ça se vend bien.
M. de Maupassant a pris son Duroy où il lui a plu de le prendre ; il a eu raison. Il a reculé en essayant d’atténuer la portée de son acte ; il a eu tort.
Mas il faut tout dire, on sent trop que l’auteur de Bel Ami a voulu faire de son pantin le type du journaliste, guidé par cette maille qu’on a, depuis quelques années, de vouloir incarner une classe, une profession dans un individu ; et voilà l’absurde, Duroy, cet être ignare, sans intelligence véritable, incapable d’écrire, n’est pas « le journaliste », c’est un journaliste, comme il en existe pas mal, mais non comme ils sont tous. Et si nous voyons à la tête de quelques journaux des rastaquouères sans éducation et incapables de tracer dix lignes sans faire dix fautes d’orthographe, ce n’est pas comme écrivains qu’ils sont arrivés à ce résultat, mais comme administrateurs, brasseurs d’affaires. Journalistes, jamais ! marchands de papier, à la bonne heure ! C’est un rude métier que le nôtre, et si l’intrigue, la rouerie, le savoir-faire y tiennent parfois lieu de vrai savoir, il faut, pour y faire sa trouée, beaucoup de talent joint à une peu commune énergie, qualités inconnues à Duroy. Et parmi les peu estimables écrivains dont nous parlions à l’instant ce ne sont pas généralement les mazettes qui réussissent ; la plupart possèdent un joli brin de plume, les mal doués végètent, à moins qu’ils ne se lancent dans le reportage, et encore ! Quant à ceux qui travaillent dans le bas feuilleton, pour les petits journaux, si la valeur de leurs écrits ne correspond pas à la quantité, ils ont à piocher dur, ce qui est rout à fait contraire aux goûts de Bel-ami.
Passons au roman.
Un mélange de force et de faiblesse, d’exactitude et d’invraisemblance, de faits pris sur le vif, d’intrigues inventées à plaisir , de personnages empruntés à la vie réelle, bleu campés, agissant et parlant selon leur tempérament, leur caractère, leur éducation ; et d’autres créés de toutes pièces, c’est-à-dire mal équilibrés, d’un dessin peu arrêté, aux actes contradictoires ; enfin un milieu changeant, tantôt vrai, tantôt artificiel et de pure convention. Tel est le bilan de ce roman, exécuté dans un style sobre — trop sobre peut-être — roman qui n’en est pas moins amusant, intéressant et d’agréable lecture.
Une courte analyse en démontrera, du reste, mieux que toute dissertation ne le ferait, les défauts et les qualités.

Georges Duroy est un beau garçon de vingt-sept à vingt-huit ans, aimant la bonne chère, le confortable, sous toutes ses formes, et surtout les femmes. Envieux et paresseux, il n’a, pour servir son ambition rentrée, que sa belle prestance d’ancien sous-officier de hussarde et une intelligence médiocre mais éveillée, jointe à une instruction fort négligée. En rentrant du service, il a trouvé une place de commis dans une administration. Les appointements sont faibles et ne permettent pas de bombances. C’est la misère pour Duroy, ce dont il enrage. On devine qu’il est prêt à tout pour en sortir, fût-ce à commettre quelque mauvais coup. Il a guerroyé contre les Arabes et l’habitude ancienne aidant, il a conservé le goût du « chapardage ». Que de profitables razzias il tenterait si, pour protéger ces pékins qui se carrent à la terrasse des cafés, pendant que lui tire la langue, il n’y avait pas de sergents de ville pour les protéger.
La chance lui fait rencontrer, un jour qu’il était plus que de coutume piqué par tous les désirs, mordus par toutes les tentations, un ancien camarade du régiment, Forestier, qui a fait son chemin, lui ! C’est un journaliste. Il dirige la politique à la Vie française ; il fait le Sénat au Salut et des chroniques littéraires pour la Planète. Bon à tout et propre à pas grand chose, c’est sa femme, Madeleine, une fine mouche, qui le pilote : elle lui dicte sa conduite, lui souffle ses articles, les corrige et parfois les lui dicte. Forestier a besoin d’un reporter, il prend Duroy, auquel il prête quelque argent pour qu’il puisse se nipper convenablement. Et voilà le sous-off lancé ! Il est présenté par Forestier chez le patron de la Vie française, un juif ténébreux qui tripote dans toutes les affaires d’une propreté douteuse. Les rencontres qu’il y fait, les jugements qu’il y entend porter sur les hommes et sur les choses lui démontrent clairement que, dans la vie civile comme dans la vie militaire, on peut chaparder, pourvu qu’on y mette un peu d’adresse. Il comprend à merveille que dans ce milieu on arrive facilement par les femmes, et il se jure qu’il arrivera. Aussi fait-il une cour assidue aux dames : sa blonde moustache en croc, ses larges épaules, lui assurent un prompt succès auprès d’elles. Il ne s’appellera plus désormais, dans l’intimité, que Bel-Ami. Le voilà devenu l’amant de Mme de Marelle, femme d’un ingénieur peu gênant qui ne s’aperçoit de rien ou qui ferme volontairement les yeux. Jusqu’ici Bel-Ami ne triomphe guère dans me Journalisme : chargé de faire des chroniques sur l’Algérie, pays qu’il connaît bien, puisqu’il y fut deux ans soldat, il ne peut mener à bien cette besogne. Le premier article est fait par la femme de son collaborateur Forestier, mais celui-ci s’étant lassé, le second article, émanant tout entier de Bel-Ami, est jugé si mauvais qu’il est refusé par le directeur de la Vie française. Tout ce que l’ex-sous-off peut faire, c’est de devenir reporter assez habile. Mais l’argent lui manque toujours et il en arrive à faire appel à la bourse de sa maîtresse, cette Mme de Marelle, fille par tempérament et grisette par l’esprit.
Forestier meurt. Bel-Ami qui a toujours convoité Madeleine, la femme de ce triste sire, parce qu’elle est une intrigante de première force, l’épouse quand elle est devenue veuve, sans abandonner pour cela sa maîtresse. C’est alors que la prospérité sourit à Bel-Ami, conseillé par Madeleine qui lui laisse le beau rôle, qui lui souffle ses articles, qui le tient au courant de tout ce qui se passe, qui lut dicte sa conduite, il devient rédacteur en chef de la Vie française, dont il dirige la politique. Sa maison ne désemplit pas d’hommes publics, sénateurs et députés, qui le flattent et lui font une cour empressée, quémandant ses services et l’appui de son journal. Bel-Ami songe à la députation. Ce n’est plus le soudard besoigneux, le petit employé à quinze cents francs, qui crève d’ennui entre les quatre murs de son bureau. C’est un personnage influent. Mais il désire plus encore : la fortune, voilà ce qu’il veut, voilà le but de tous ses désirs, et s’il pense parfois à se faire nommer député, c’est parce que grâce à ce titre, il pourra se livrer en grand à la trituration des affaires. Devenu l’amant de Mme Walter, la femme de son patron, bourgeoise épaisse qui faiblit pour la première fois et connaît, dans la maturité de l’âge, toutes les ardeurs d’une juvénile passion, Bel-Ami gagne, grâce aux secrets financiers qu’elle lui prodigue, une soixantaine de raille francs. Mas qu’est cela, pour cet ambitieux ? Rien.

Le caprice qu’il a eu pour Madeleine n’existe plus depuis longtemps ; aussi, quels que soient les doutes qu’il puisse avoir sur la fidélité de sa femme, — il suppose qu’elle est la maîtresse d’un nommé Vaudrec, vieux beau discret et correct dont il avait déjà remarqué les assiduités du temps de Forestier — il fait comme le mari de sa maîtresse à lui, M. de Marelle : il fait semblant de ne s’apercevoir de rien, il ne veut rien voir. Et quand le vieux Vaudrec meurt en instituant Madeleine légataire universelle de ses biens, Bel-Ami extorque la moitié de l’héritage, aguant que si Madeleine acceptait la totalité du legs, ce serait avouer ses anciennes relations avec le défunt. À présent que sa femme lui a servi de marche-pied, qu’elle l’a piloté dans ce monde qui lui était fermé, il voudrait se débarrasser d’elle, bien qu’il ait souvent recours à sa finesse pour se sortir des cas difficiles et qu’elle soit toujours son inspiratrice. C’est ainsi qu’ils rédigent à eux deux des articles d’une importance telle qu’ils renversent le ministère, et que leur journal a une prépondérance marquée dans la politique. Bel-Ami est une puissance, et le jour est proche où il ira siéger à la Chambre. Mais tout cela ne lui suffit pas. Il a une quarantaine de mille francs de rente, il en gagne presque autant dans le journalisme, et il se considère comme très pauvre. L’opulence du juif Walter le trouble ; il a pris la femme de ce financier, Il rêve de lui prendre s fille avec les millions qu’elle aura pour dot.
Pour cela, il lui faut se débarrasser de Madeleine. Il y parvient en la surprenant en flagrant délit, dans un hôtel borgne, avec un ministre duquel il croit avoir à se plaindre. La loi Naquet lui vient en aide : il divorce, le voilà libre et le voilà vengé du même coup, car le ministre paie de son portefeuille son amoureuse escapade. Alors, après avoir flirté avec la fille de Walter, il l’enlève et l’épouse sans vergogne, lui qui a été l’amant de la mère qui l’aime encore et qui devient presque folle de désespoir, tout en conservant pour maîtresse la jolie Clotilde de Marelle qui lui a pardonné toutes ses trahisons et dont il est absolument féru.
Bel-Ami, directeur de la Vie française, marié à la fille d’un crésus, riche à millions et enfin « arrivé », rien ne l’arrêtera plus, il sera ministre à son tour, le monde est à lui.
On voit que ce roman est extrêmement machiné et plein de péripéties imprévues ; que par cela même il peut avoir beaucoup d’attrait. Mais quel que soit le succès qu’il obtienne, ce livre n’est pas assurément le meilleur de Guy de Maupassant. Si par places on y trouve une élude très serrée sur les dessous de la vie parisienne, si certains types sont dessinés de main de maître, si le côté passion est traité avec une rare supériorité, on y rencontre une telle dose d’exagération qu’on est bien forcé de convenir que l’auteur a singulièrement eu recours à la fantaisie la plus outrée.
Où donc M. de Maupassant a-t-il vu un journal comme la Vie française, vivant de scandales et de tripotages, avoir une pareille influence sociale et politique ? Quand donc un seul article écrit par un journaliste d’occasion, en collaboration avec une femme, dans un boudoir où il est beaucoup plus question d’amour que d’autre chose, a-t-il pu culbuter un ministère, alors que les efforts répétés de cent journaux sérieux de Paris et de province, joints à la pression de l’opinion publique, n’en viennent pas à bout ? Ce n’est pas sérieux.
Sans contester la portée des commérages, des cancans, des articles scandaleux, sans nier l’existence de la politique d’intrigue, où la femme peut prendre une certaine part, les conséquences n’en sont pas aussi radicales, aussi graves, que nous le voyons dans Bel-Ami. Et si l’auteur a exagéré les choses dans le but de mieux nous les faire sentir, il s’est trompé : L’étude qu’il a voulu faire est devenue un roman bien fait, il est vrai, mais un simple roman, exact, dans les détails, faux dans l’ensemble, voila tout, et dont l’action se passe tantôt à Paris, en France, tantôt dans quelque très amusant duché de Gerolstein.
Sutter Laumann.











