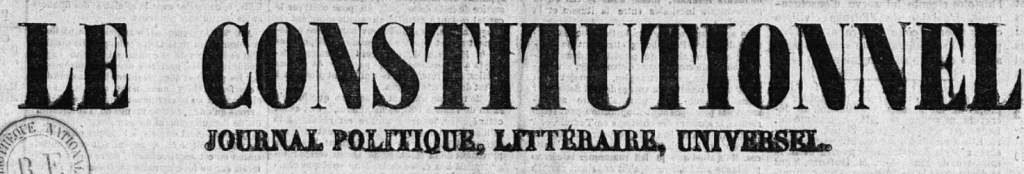
Vous êtes invités à lire la recension de La correspondance de Balzac (éditée par la maison Lévy en 1876) rédigée Jules Barbey d’Aurevilly pour le numéro du lundi 27 novembre 1876 du quotidien Le Constitutionnel.
En fait, figurativement, à travers ce texte, deux artistes royalistes et catholiques dialoguent :
II.
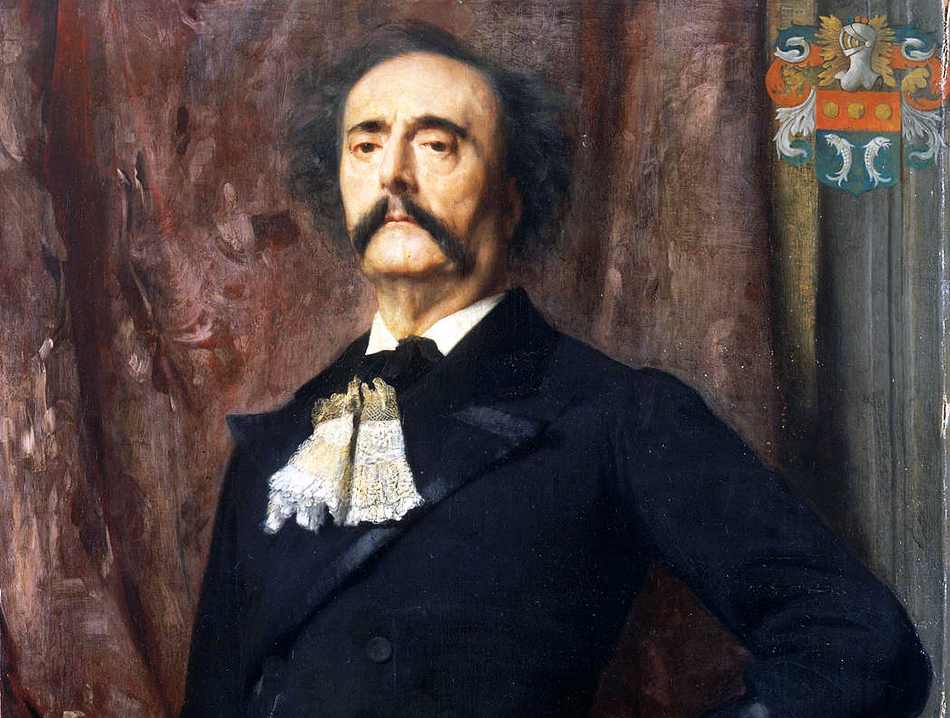
Que grâces lui soient rendues, à cette Correspondance, qui balaie, du coup, les anecdotes et les anecdotiers sur Balzac, les anecdotes et les anecdotiers, qui s’attachent à toute célébrité, et sont la vermine de toute gloire. Balzac a souffert plus que personne, en raison de son omnipotente supériorité et de la vie qu’il s’était créée, de ces insectes littéraires. Depuis même que cette Correspondance est publiée, — et il y a quelques jours à peine, — ne sont-ils pas revenus à la charge, comme mouches qu’on chasse, et n’ont-ils pas essayé de prendre une dernière sucée dans la célébrité de l’illustre romancier — qui va leur échapper ?… La Correspondance rendra désormais impossible ces petits régals des commères, à bec vide et à ventre vide, de la littérature, à même la substance d’un grand homme… Que n’a-t-on pas dit de Balzac ? Que n’a-t-on pas dit du matérialisme ardent de sa nature, de son amour effréné, de son amour d’alchimiste pour l’or, de son besoin furieux de luxe, de richesse, de millions ; et pour on acquérir, de ses entreprises insensées et… avortées ; de ses illusions, de ses dettes, qui n’étaient pas des illusions, de ses manies, de ses vices, de sa vie cachée, qui impatientait la curiosité et dans laquelle il se retranchait, ce grand-travailleur comme il n’en exista peut-être jamais, contra les importunités de toute sorte, qui l’assiégeaient et surtout contre cet affreux coup de sonnette du créancier, qui a bien, après tout, le droit de sonner, mais qui n’en rend pas moins fou le débiteur de génie, qui a besoin de toute sa tète, même pour le payer ?… Oui, que n’a-t-on pas dit ?… Toute personnalité grandiose est odieuse, quand elle n’a pas le pouvoir, — a écrit Balzac, dans sa Correspondance, et il entendait certainement le pouvoir matériel, politique, absolu ; le pouvoir qui a les six laquais de Pascal, multipliés par une nation, et qui empêchent toute contestation insolente ; le pouvoir qui crée des chambellans ! car les hommes n’ont pas assez de générosité intellectuelle, pour s’incliner devant l’Esprit pur, réduit à sa seule force. Moins intéressants que l’Intimé, qui avait quatre enfants à nourrir, il leur faut, même sans enfants, des coups de bâton ! Autant à chaque œuvre nouvelle de Balzac, — de ce prodigieux producteur — il était impossible de ne pas convenir du prodige de sa production, autant on cherchait à diminuer, dans sa vie morale et pratique, l’être si souverainement supérieur dans l’ordre de l’esprit et de l’idéal ; — et c’est ainsi qu’on était parvenu à faire de la toute-puissance de Balzac, quelque chose d’énorme, il est vrai, mais d’anormal, d’étrange, de mystérieux, d’absorbant, dans lequel l’homme moral n’était plus pour rien, quelque chose enfin comme une mécanique de génie, comme une splendide et énigmatique monstruosité !
Eh bien ! c’est là que fut l’erreur de l’imagination et de l’opinion contemporaines ! Balzac n’est point cette chimère. Il n’est pas si incompréhensible que cela. Il n’est pas, qu’on me permette le mot, si hypertrophiquement intellectuel. Il était, au contraire, un organisme très équilibré et très accompli. Il était composé d’un cerveau et d’un cœur comme les autres hommes. Seulement, ce cerveau et ce cœur étaient également grands et formaient la plus opulente harmonie. Ce Gaulois et ce Rabelaisien, qui a écrit les Contes drôlatiques, avec la gaîté de Rabelais, le Titan-Satyre, et qui y a mêlé les choses les plus inconnues à Rabelais, — l’attendrissement et la mélancolie, — était romanesque pour son propre compte, dans la plus noble acception de ce mot charmant, romanesque ! Les livres, que nous écrivons, moulent toujours un peu notre vie. Vous vous rappelez ce pur et idéal Daniel Darthès si chevaleresquement amoureux de la princesse de Cadignan, dans les Scènes de la Vie parisienne ! Balzac fut réellement ce Darthés. Il fut encore l’Albert Savarus d’un autre roman, cet Albert Savarus qui veut acheter, par le travail et par la gloire, le bonheur qui doit venir du mariage avec une femme aimée. La ressemblance dans le sentiment et dans la position saute aux yeux… Balzac, cet inventeur, qui inventa à propos de tout, et qui eut même le défaut sublime de trop d’invention, car il inventa jusque dans la critique et dans l’histoire — et il les faussa, quelquefois, toutes les deux, mais comme il n’y avait que lui qui pût les fausser — Balzac qui, un jour, s’inventa, dans sa pensée et dans son désir, l’homme politique qu’heureusement il ne fut jamais, n’avait pas besoin de s’inventer romanesque. Naturellement il l’était — et peut-être le plus romanesque de tous les héros de roman, qu’il avait inventés ! ■ (À suivre)
À découvrir, de chez Belle-de-Mai Éditions : La Femme de Trente ans
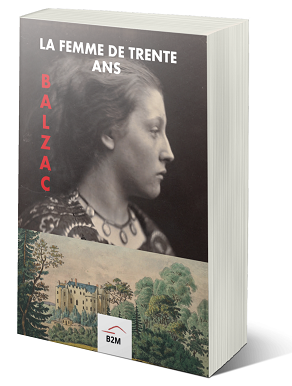
Nombre de pages : 196.
Prix (frais de port inclus) : 21 €.
Commander ou se renseigner à l’adresse ci-dessous : commande.b2m_edition@laposte.net ■











