
PIERRE LOTI CHEZ LES BASQUES, par Gaston Deschamps

Le président de la République, sur la proposition du ministre de la marine, enjoignit naguère à l’académicien Pierre Loti, lieutenant de vaisseau, d’aller prendre le commandement du Javelot, chaloupe-canonnière, qui est, de toute éternité (l’Annuaire est là pour le prouver), « en mission dans la Bidassoa ».
Quel est, au juste, l’objet de cette mission? Les voyageurs qui vont de Hendaye à Saint-Sébastien se posent cette question les uns aux autres, lorsqu’ils voient le Javelot perpétuellement embossé devant l’île des Faisans, sous le pont du chemin de fer.
Les uns disent : « C’est pour la contrebande ». Les autres insinuent : « C’est pour surveiller la côte ». Les malins pensent qu’il s’agit peut-être de régler certaines questions de frontières, qui sont irrésolues depuis le traité des Pyrénées, et pour lesquelles une commission diplomatique (voyez l’Annuaire des affaires étrangères) « fonctionne » encore à Paris.
Je croirais plutôt que M. le président et M. le ministre, en signant et en contresignant cet ordre ingénieux, ont obéi à une arrière-pensée de littérature. Ils ont pensé sans doute que le paisible Javelot est un observatoire commode pour étudier l’âme basque. Pourvu de ce commandement, qui n’exige pas une application soutenue ni une attention de toutes les heures, Loti, dans sa chaloupe, a pu rêver, méditer, écrire, corriger des épreuves. Et il nous a donné ce qui nous manquait : un livre sur la Biscaye.
Une femme d’esprit me disait récemment :
— Quel dommage qu’un écrivain n’aille pas s’installer à Saint-Jean-de-Luz, à Urrugne ou aux environs de Hendaye, afin de substituer aux sèches nomenclatures du Guide Joanne ou du Manuel Bædeker, la peinture vivante de ce divin pays ! On décrit la Bretagne, encore la Bretagne, toujours la Bretagne. Personne, ou presque personne ne songe à ce pauvre coin de Biscaye.
— Et le Voyage aux Pyrénées de Taine, insinuai-je.
— Taine ? Eh bien franchement, ses descriptions sont trop violentes, trop forcenées. Il n’a vu, à Saint-Jean-de-Luz, que des spectacles épouvantables. Évidemment, il y est arrivé par un mauvais jour…
Ma gracieuse interlocutrice avait raison. Jusqu’ici, la plupart des prosateurs et des poètes n’ont parlé de la Biscaye qu’en passant, en courant, d’un ton hâtif et d’une haleine essoufflée. Théophile Gautier, en 1840, eut à peine le temps de remarquer (bien qu’il eût de fort bons yeux) le chapeau pointu, la veste brune, les guêtres de peau et la ceinture rouge du mayoral qui conduisait la voilure de Bayonne à Madrid. Il dessina, sur son carnet, deux ou trois contrebandiers qui n’étaient peut-être que d’honnêtes bouviers en béret. Aux relais, avant de payer avec des réaux, pleins de couleur locale, le propriétaire de la posada, le bon Théo improvisait des vers picaresques sur
Urrugne,
Nom rauque, dont le son à la rime répugne.
Victor Hugo, le 23 juillet 1843, par un après-midi de pesante chaleur, fut cahoté de Dax à Bayonne sur l’impériale d’une diligence dont la sellette lui parut aussi dure que les cailloux du chemin. Quelques jours après, il vit rapidement Biarritz, « village blanc à toits roux et à contrevents verts ». Se promenant, à marée basse, parmi les coquillages et les crabes, il vit « une belle jeune fille qui nageait vêtue d’une chemise blanche et d’un jupon court dans une petite crique fermée par deux écueils à l’entrée d’une grotte ». En nageant, cette baigneuse chantait
Gastibelza, l’homme à la carabine.
De là, le poète des Feuilles d’automne se rendit à Saint-Jean-de-Luz, qui lui parut « un village cahoté dans les anfractuosités de la montagne ». La Bidassoa lui sembla une jolie rivière, mais il observa que, « dans l’île des Faisans, il y a des canards ». Irun ne lui plut guère. « Irun, dit-il, ressemble aux Batignolles. » Toutefois, en regardant la carte du Guipuzcoa, il remarqua de beaux noms aux syllabes étranges et il se promit de leur faire un sort. Déjà, il avait illustré le village d’Hernani, troupeau de huttes, perdu sur la frontière d’Espagne. Plus tard, en écrivant la Légende des siècles, il se souvint de ce mont Jaïzquivel, auquel les touristes de Saint-Sébastien ne manquent jamais d’accorder un coup d’œil entre deux courses de taureaux :
Laveuses, qui, dès l’heure où l’Orient se dore,
Chantez, battant du linge, aux fontaines d’Andorre,
Et qui faites blanchir des toiles sous le ciel ;
Chevriers, qui roulez, sur le Jaïzquivel,
Dans les nuages gris votre hutte isolée;
Muletiers, qui poussez de vallée en vallée
Vos mules sur les ponts que César éleva,
Sait-on ce que là-bas le vieux mont Corcova
Regarde par-dessus l’épaule des collines ?
Ainsi, la Biscaye, effleurée par des incursions brèves, n’avait pas encore été annexée à la littérature. C’est à ce moment que Loti vint. Il était temps, grand temps. Car les Basques subtils exploitent déjà les curiosités de leur beau pays, comme s’ils étaient Suisses. Victor Hugo avait prédit ces appétits de lucre et cette invasion des Barbares. « Un jour viendra, disait-il, où Biarritz, ce village si honnête, sera pris du mauvais appétit de l’argent, sacra fames. Biarritz mettra des peupliers sur ses mornes, des rampes à ses dunes, des escaliers à ses précipices, des kiosques à ses rochers, des bancs à ses grottes, des pantalons à ses baigneuses On lira la gazette à Biarritz ; on jouera le mélodrame et la tragédie à Biarritz. Le soir, on ira au concert, et un chanteur en i chantera des cavatines de soprano à quelques pas de ce vieil océan qui chante la musique éternelle des marées, des ouragans et des tempêtes. »
Hélas ! cette sinistre prophétie est maintenant réalisée. Biarritz et Hendaye sont des « plages ». Les casinos, les hôtels (de premier ordre), les cabines, les cafés, les villas se multiplient dans les vallées de la Bidouze, de la Nive et de la Nivelle. Des chalets trop confortables guettent les voyageurs au sommet de la Rhune. Le bourg d’Ascain, où Loti aimerait à planter sa tente, ne sera bientôt plus qu’une colonie d’auberges cosmopolites. L’état lamentable de ce pays dévasté n’a pas découragé Loti. L’auteur des Japoneries d’automne est un grand conquérant. Il est sûr de vaincre, parce qu’il ne voit pas l’ennemi. Il lit les Guides, il les sait par cœur, mais il n’a, de sa vie, entrevu M. Perrichon. Heureux homme ! Son imagination l’znveloppe d’un nuage doré qui dérobe à ses yeux toutes les vulgarités et toutes les platitudes. Il est doué d’une puissance d’illusion divinement enfantine. Le pèlerin du Désert a mis un burnous pour monter au Sinaï, et là-haut il n’a pas été offusqué par la table d’hôte, établie pour les clients de l’agence Cook, à l’endroit même d’où Moïse rapporta les tables de la Loi. Pareillement, le commandant du Javelot « en mission dans la Bidassoa », élimina d’instinct tout ce qui pouvait gêner sa vue. Il se fit Basque, comme il s’était déjà fait Turc, Nippon et Bédouin. Son initiation, commencée en l’automne de 1891, par une châtelaine du pays « escualdanac » (c’est ainsi qu’il faut appeler le pays basque), vient d’aboutir à une manière de chef d’œuvre Ramuntcho.
C’est du Loti, du vrai Loti, de l’ancien. Cette histoire, très belle, se passe autour du clocher massif d’Etchezar, planté comme un donjon de forteresse au tournant d’un chemin, en face de la haute muraille des Pyrénées. Occasion, pour Loti, de nous dépeindre, avec cette précision émue dont il est coutumier, le décor des montagnes basques. Hauteurs peu élevées, mais dont les crêtes découpent sur le ciel un zigzag de lignes très nettes. Silhouettes lointaines de vieilles villes, Fontarabie, Irun, dont la physionomie âpre s’adoucit dans les vapeurs bleuâtres de l’horizon. Églises « qui ressemblent à des mosquées, avec leurs grands vieux murs farouches, percés tout en haut seulement de minuscules fenêtres ». Cimetières dont les cyprès se massent, en assemblées sombres, au milieu des hameaux disséminés. Petits sentiers de chèvres, qui semblent ramper au flanc des coteaux. Chemins ombreux et solitaires sous les vieux chênes qui s’effeuillent, entre des talus richement feutrés de mousses et de fougères. Ravins où bruissent des torrents. Pelouses inclinées, où les fleurs de digitale s’élancent partout comme de longues fusées rosés. Gorges d’ombre, où se tassent de grands chênes, et au-dessus, partout, un lourd amoncellement de montagnes, d’une couleur rousse, brûlée de soleil. Et la Bidassoa tantôt encaissée comme un gave entre deux falaises de roches, tantôt élargie en estuaire, bleue comme un lac aux heures de marée haute, ou devenue un mince filet d’argent, à l’étalé de basse mer. Tous les aspects du ciel, de la terre et des eaux, tous les moments du jour et de la nuit, tous les changements des saisons pourraient se refléter en images fixes sur les plaques sensibles que Pierre Loti, merveilleux photographe en couleurs, offre aux impressions de la fantasmagorie universelle. Il suffît, pour s’en convaincre, de feuilleter cet album-ci.
Journées de novembre, « dans un tiède rayonnement de ce soleil, qui s’attarde longtemps sur les pentes pyrénéennes. Au bord des chemins, montent de hautes graminées, comme au mois de mai, et de grandes fleurs en ombelles, qui se trompent de saison ; dans les haies, des troènes, des églantiers ont refleuri, au bourdonnement des dernières abeilles, et l’on voit voler de persistants papillons, à qui la mort a fait grâce de quelques semaines. »
Crépuscules d’arrière-saison, où « l’automne s’indique par la chute hâtive du jour, avec tout à coup une fraîcheur montant des vallées d’en dessous, une senteur de feuilles mourantes et de mousse; les brumes tristes apparaissant avec le soir; tes Pyrénées confondues parmi des vapeurs d’un gris d’encre, ou bien, par places, découpées en noires silhouettes sur un pâle ciel d’or ».
Après-midis limpides d’hivers attiédis par les brises d’Afrique. Le relief des montagnes s’avive de lumière et d’ombre. Les Pyrénées semblent s’avancer, écraser le village. Les cimes espagnoles ou les cimes françaises sont là, toutes proches, comme plaquées les unes sur les autres, exagérant leurs bruns calcinés, leurs violets intenses et sombres. Par instants, la clarté du jour est éclipsée par de grandes nuées opaques, déployées en forme d’arc. Çà et là, le voile se déchire. Et, par la déchirure, frangée de vif-argent, on aperçoit la profondeur d’un ciel bleu, presque vert…
Pluie dans la montagne. Les nuages sont descendus si bas qu’ils enveloppent les pacages de mi-côte, s’appesantissent en traînées lourdes jusqu’au fond des combes et semblent amasser un poids de tristesse sur le toit des maisons, sur la tête des hommes, sur l’âme obscure des bêtes. La bourrasque d’automne s’annonce par une demi-obscurité qui brouille l’aspect des choses, et, par de brusques coups de vent qui font frissonner les arbres. La nature semble se recueillir, attendre. « Et les premières gouttes d’eau commencent à tomber, larges, espacées, lourdes, s’étalant, avec un bruit monotone sur la jonchée des feuilles mortes. Les courlis, messagers de tempêtes, fuient vers la haute mer. Le vent, plus fort, secoue les branches. L’eau, plus drue, ruisselle à travers les herbes couchées, les chemins ravinés et les roches dénudées. Les montagnes semblent emprisonnées, comme dans un réseau, par les raies innombrables, continues de l’averse. Et, pendant des heures et des heures, la Biscaye est noyée, glacée par l’ondée refroidissante, avant que l’hiver vienne tuer les germes, arrêter les sèves, alanguir les cœurs.
Effets de nuit. C’est dans les montagnes que la nuit, nourricière de fantômes, évocatrice de rêves, source obscure des terreurs, a gardé le plus cette puissance des ténèbres, qui, dans les temps anciens, faisait chanceler de vertige et d’effroi l’âme religieuse de notre race. Aurores d’avril, si magnifiques et si douces, qu’on ne sait, en vérité, quelle puissance méchante a voulu, par le perpétuel rajeunissement du printemps merveilleux, rendre plus sensibles à notre cœur, plus inconcevables à notre esprit, plus implacables à notre chair les atteintes de la décrépitude, le mystère décevant de l’amour, l’aiguillon de la douleur et de la mort.
Loti, en Biscaye, s’effrayait de ces formidables antithèses, dont la hantise a poursuivi, dans les cinq parties du monde, son âme longuement songeuse et vite amusée. Il n’y a pas de coin de terre, si petit qu’il soit, où nous ne puissions apercevoir l’infinité de notre misère. Et partout aussi nous pouvons espérer de trouver un peu de ce réconfort précaire, que Pascal appelait le « divertissement ».
L’auteur de Mon frère Yves s’est « diverti » en regardant les Basques. Il aime ces montagnards chaussés d’espadrilles, parce qu’ils sont lestes et forts, résignés et braves. Attiré par l’inconnu, il se plaît à interroger l’énigme insoluble qui fait hésiter la science devant le problème de leurs origines. Je ne sais s’il comprend cette langue « euskarienne », qui a dérouté tant de philologues. Mais j’incline à croire qu’il sait l’irrintzina, le grand cri basque, signe de joie, de ralliement ou de détresse, appel des contrebandiers, si fort qu’il domine le tonnerre des gaves, si perçant que les pêcheurs l’entendent malgré le vent et les vagues, si terrible que les carabiniers d’Espagne et les douaniers de France pâlissent en l’écoutant. À l’appel de Loti, les Basques sont venus à travers la montagne. Tous, beaux garçons et belles filles, vieillards et enfants, mendiants, buveurs de cidre, bouviers sans sous ni maille ou notables villageois enrichis par des migrations vers l’Amérique du Sud, tous sont venus, d’un pas dégagé, le béret sur l’oreille, la jambe serrée par les lanières des souliers de corde. Et, dans le décor arrangé par le sortilège du magicien qui les assemble, ils se souviennent de leurs aïeux, ils font les gestes héréditaires.
D’abord, la contrebande. C’est très amusant, surtout par les nuits d’hiver, par grand vent et pluie fouettante, lorsque les rudes gars descendent vers la Bidassoa et remontent péniblement, les pieds enfoncés dans la vase, à cause de la lourdeur des caisses et des ballots. Gare au bateau-ronde, qui promène chaque nuit les gabelous d’Espagne Il faut alors ruser comme des Peaux-Rouges, faire le guet, se tapir contre les barques de pêche, veiller. L’oreille tendue, sous le ruissellement de la pluie. Quelle joie, lorsqu’on peut arriver, avec la cargaison, à la petite auberge de Zitzarry. C’est alors qu’on pousse à pleins poumons le terrible cri : l’irrintzina !
Ensuite, les parties de pelote, après vêpres, le dimanche. Ils sont là six beaux garçons, six pelotaris, en tenue de combat, le torse libre dans une chemise de cotonnade rose ou moulé par un maillot de fil — sauf les curés qui, dans ce pays sont aussi enragés que les autres, et veulent lancer la balle, malgré l’entrave de leur robe noire. Etchezar est le centre des bons joueurs, le « conservatoire de la pelote », célèbre en Espagne et jusqu’en Amérique. La « pelote » est une petite balle de corde, serrée et recouverte en peau de mouton, et dure comme une boule de bois. On la saisit, on la lance avec un gant d’osier, fabriqué en France par un vannier unique du village d’Ascain. Le pelotari vainqueur est acclamé en Biscaye, comme en Castille le toréador. Les filles, dont le joli chignon est noué d’un foulard de soie, sourient en le voyant venir.
Le dimanche soir, au clair de lune, on danse le fandango sur des airs de valse ancienne. Le fandango tourne et oscille… Tous les bras, tendus et levés, s’agitent en l’air, montent ou descendent avec de jolis mouvements cadencés, suivant les oscillations du corps. C’est une danse silencieuse, car les espadrilles légères effleurent à peine le sol. Le froufrou des robes se mêle, comme un bruissement indistinct, au petit claquement sec des doigts, imitant un bruit de castagnette. « Avec une grâce espagnole, les filles, dont les manches s’éploient comme des ailes, dandinent leurs tailles serrées, au-dessus de leurs hanches vigoureuses et souples. » Et, pendant la semaine, la vie habituelle reprend, dure et vaillante. Par les chemins étroits, les charrettes aux roues de bois, sans rayons et sans jantes, passent, en grinçant, traînées par des bœufs qu’active la mélopée des anciennes chansons.
Ainsi, par le caprice tout-puissant de Loti, la Biscaye ressuscite à peu près telle qu’elle pouvait être, au temps de cet Alain, sire d’Albret, dont M. Achille Luchaire a narré les aventures. On oublie qu’il y a maintenant, dans cette province, un chef-lieu d’arrondissement, des chefs-lieux de canton, des percepteurs, des maîtres d’école, des modistes, des politiciens et des agents électoraux. Le touriste profanateur a disparu. C’est une Biscaye. nettoyée, purifiée, faite à souhait pour encadrer les amours sauvages et fières de Ramuntcho et de Gracieuse.
Ramuntcho (autrement dit le petit Raymond) est le plus fin contrebandier d’Etchezar, le plus vigoureux pelotari des Pyrénées, le plus fin danseur de fandango, qui ait jamais tourné sut la place de l’église, durant les soirs d’été, tandis que la lune écornait son croissant aux cimes abruptes de la Gizune. Plus raffiné que la plupart de ses compagnons, il est Basque par sa mère Franchita (une grande femme sérieuse, pâle et droite sous ses vêtements noirs) mais son père est un étranger, qui est venu dans le pays jadis et qui est reparti vers les villes. Gracieuse est la sœur d’un garçon nommé Arrochkoa, lequel est camarade d’enfance, le rival au jeu de Ramuntcho. Qu’elle est jolie, cette Gracieuse, et qu’on aime à la regarder, soit qu’elle entre à l’église, embéguinée de noir, ses cheveux blonds serrés par l’étroite mantille des cérémonies, soit que la guitare et le tambourin basque, sonnant la seguidille espagnole, égayent d’un rire clair la fraîcheur de ses quinze ans, soit que, sous les platanes, après le fandango, en s’en allant parmi les herbes longues et les scabieuses, elle se retourne pour sourire à son ami et lui envoyer, de la main, un gentil adios !
Ramuntcho aime Gracieuse. Elle est pour lui une fiancée toujours présente, même lorsqu’elle est loin. Toutes ses bonnes pensées, il les lui dédie, comme à une image de la Vierge tutélaire et consolatrice. Toutes ces prouesses, tous ces exploits qui rendent jaloux les autres jeunes gens, il les lui offre en secret. Quand ils se promènent, au bras l’un de l’autre, ils parlent d’avenir, d’espérance, d’immortel amour. Ils songent au foyer entrevu, au bonheur espéré, à ce plus tara dont se berce et se leurre éternellement la fragilité de nos pensées. Et je ne résumerai point ces dialogues. Ils sont charmants. Je ne vois que Loti qui sache faire parler ainsi les lèvres vermeilles, les yeux adolescents et les âmes en fleur.
Amours divines, que traverse et torture, comme toujours, la survenue des intérêts humains, et cette question de « convenance », qui est pour les familles, même en Biscaye, une sorte de raison d’État.
Ramuntcho n’épousera pas Gracieuse. Cela serait trop beau, trop conforme à la loi sacrée. C’est pourquoi des gens s’y opposent.
Il quitte le pays, pour son service militaire. Quant à elle, afin de la guérir de son mal, on l’enferme dans un couvent. Trois ans après, bruni par des campagnes au soleil, très loin, dans les colonies, il revient au village natal, et il apprend que sa fiancée s’est faite religieuse. Que ceux qui ont connu quelque part, dans l’univers, un coin béni et douloureux, qui fut plein du souvenir de l’adorée, et qui, par son absence, est devenu désert, que ceux-là relisent l’histoire de ce retour. Oh ici, toute l’ironie mauvaise dont nous sommes saturés ne peut duper notre esprit ni désabuser notre cœur. Cela est beau, d’une beauté primitive et cependant contemporaine de tous les âges, d’une beauté déchirante, comme tout ce qui touche le fond de nos joies rapides et de nos longues misères.
Avant toutes choses, avant de savoir ce qu’il fera ou ne fera pas, le malheureux veut suivre, en un lent pèlerinage, tous les chemins où il marchait jadis avec elle, chemins fleuris, alors, chemins de paradis, et maintenant si âpres, malgré l’image enfuie, dont là grâce flotte encore sur leur solitude.
Mais à son âge, on ne souffre pas sans révolte. Avant de renoncer au bonheur, on veut le conquérir de haute lutte. Lisez, dans cet admirable poème (décidément impossible à résumer), lisez comment Ramuntcho essaya de lutter contre sa destinée et comment il fut vaincu. La scène de ta rencontre, dans le couvent, est un des drames les plus magnifiques et les plus poignants que je connaisse. Et avec des moyens si simples ! Je vous préviens que cela finit très mal, comme la plupart des nobles romans et comme beaucoup d’histoires qui sont arrivées.
Gaston Deschamps
« La vie littéraire », Le Temps, 21 mars 1897
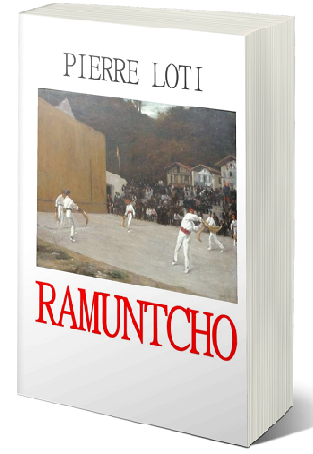
Nombre de pages : 188.
Prix (frais de port inclus) : 24 €.
Commander ou se renseigner à l’adresse ci-dessous : commande.b2m_edition@laposte.net ■











