
Par Jacques SAPIR, Quentin Rousseau.
« La responsabilité de l’euro puis de l’UE dans la situation budgétaire et financière française est importante, et très largement sous-estimée. Tous les politiciens qui braillent sur le rétablissement des comptes publics oublient l’éléphant dans le couloir, autrement dit la responsabilité écrasante de l’euro et de l’UE dans la situation financière actuelle de la France. »
Ce long entretien particulièrement remarquable est paru le 15 septembre dans Front Populaire. Il est dans le fil de l’entretien vidéo que JSF a publié le 16 juillet dernier sous le titre : « Dette : Emmanuel Macron a-t-il détruit l’économie française ? L’analyse de Jacques Sapir« On pourra s’y reporter. On peut aussi en discuter tel ou tel point. Er en débattre sur le fond comme nous le faisons régulièrement ici. JSF
ENTRETIEN. François Bayrou s’est écrasé sur le mur (politique) des finances et de la dette publiques. Derrière les discours et les incantations médiatiques, que réellement disent les chiffres ? Quelles sont les causes premières de l’appauvrissement de la France ? Que faudrait-il faire ? Pour y voir plus clair, nous avons interrogé l’économiste Jacques Sapir.

Front Populaire : François Bayrou a fait de la dépense publique l’axe central de son gouvernement. Quoi que l’on pense du personnage et de ses idées, son diagnostic sévère était-il selon vous justifié ?
Jacques Sapir : François Bayrou a essayé, que ce soit de bonne foi ou par manège politique, de se construire depuis 2007 une image de réducteur de la dette publique en France. Il l’a fait sans comprendre les mécanismes qui poussent à certains moments la dette vers le haut et à d’autre vers le bas, et sans comprendre non plus qu’une forte dette publique peut avoir, dans certaines occasions, des avantages et dans d’autres des désavantages. Il a tenu sur ce sujet un discours essentiellement idéologique.
Rappelons ici quelques faits. En premier lieu, tout discours tenu sur la dette en volume et non en pourcentage est une escroquerie intellectuelle. Et c’est d’ailleurs ce à quoi François Bayrou s’est livré, avec l’accord ou le consentement des journalistes. S’affoler sur un chiffre, par exemple les 3200 milliards de dettes de la France aujourd’hui, n’a pas de sens tant que l’on ne dit pas également, et dans la même phrase, le montant du PIB ou de l’épargne nette des Français, ou encore le montant de la propriété publique. C’est de la « grosse propagande », et mon père, qui avait connu la fin des années trente, parlait de « Funken Propaganda », en référence aux discours radiodiffusés de Hitler, Goebbels et consorts.
Un État ne rembourse JAMAIS sa dette. Pour la bonne raison qu’une situation où la dette publique serait à 0% serait une catastrophe économique grave (…).
Ensuite, le rapport « dette/PIB » est mystificateur. La dette est un stock (exprimé en valeur nominale) et le PIB est un flux. L’accroissement de la dette s’appelle le déficit budgétaire, quand il est financé par l’emprunt. L’accroissement du PIB provient de la croissance réelle ET de l’inflation. On peut donc avoir un fort déficit budgétaire et, de l’autre côté, une forte croissance ET une forte inflation. Le résultat est que ce rapport diminue. C’est le cas de la Russie en 2024 par exemple. On le voit, ce rapport n’a pas grand sens. Ce qui aurait plus de sens c’est le rapport des intérêts de la dette sur le PIB, ou, et ce serait même encore plus pertinent, les intérêts en proportion des dépenses publiques. Or, en France, cette proportion reste modérée (un peu plus de 2% du PIB). Notons, d’ailleurs, qu’il serait très facile de faire baisser les taux d’intérêts sur la dette par des méthodes qui ont été appliquée en France jusqu’au années 1980.
Front Populaire : L’ancien Premier ministre a d’ailleurs fait porter la responsabilité de la situation aux « boomers »… Qu’en pensez-vous ?
Jacques Sapir : François Bayrou a tenu, comme bien d’autres d’ailleurs, un discours mystificateur sur la dette en disant qu’il s’agissait d’un « poids sur les épaules de nos enfants » ou en accusant une génération, celle qui est née de 1943 à 1968 pendant le « baby-boom » d’avoir « creusé » la dette. Ce sont des quasi-mensonges qu’il faut démonter.
Premièrement, un État ne rembourse JAMAIS sa dette. Pour la bonne raison qu’une situation où la dette publique serait à 0% serait une catastrophe économique grave où les banques seraient privées de liquidités, les assurances privées de placement, les entreprises privées elles aussi de méthodes pour placer leurs argents à court terme en attendant d’avoir des opportunités d’investissement. Les banques, les assurances (et l’assurance-vie en particulier), les entreprises, et en définitive nous, consommateurs et ménages, avons besoin de la dette publique. Donc, si un État ne rembourse JAMAIS sa dette que fait-il ? Il la fait « rouler ». Autrement dit : quand des bons du Trésor arrivent à maturité, il réémet pour une somme équivalente de bons du Trésor, augmentée du montant du déficit budgétaire. Cela s’appelle le « besoin de financement des finances publiques ». C’est cette somme qui peut, à un moment donné, poser problème. Si un pays se trouve confronté à une défiance massive des prêteurs étrangers et n’a pas une épargne intérieure suffisante, il peut être obligé de faire banqueroute sur sa dette.
Le risque de voir le « besoin de financement des finances publiques » provoquer une banqueroute est purement imaginaire.
Ce cas de figure est déjà arrivé dans l’Histoire, notamment à l’Allemagne (sept fois depuis 1815) et à la France – après le règne de Louis XIV, à travers la semi-banqueroute engendrée par le système de Law. Mais, aujourd’hui, la France bénéficie toujours d’une demande extérieure importante sur sa dette et elle a une épargne interne considérable. Donc, le risque de voir le « besoin de financement des finances publiques » provoquer une banqueroute est purement imaginaire. Par contre, il faudrait privilégier les prêteurs français (ou résidents) aux prêteurs internationaux. Le Japon vit très bien avec un rapport dette/PIB de 210%, soit à peu près le double du nôtre. Mais, c’est parce que sa dette publique est quasi-entièrement entre les mains d’acteurs économiques japonais.
Deuxièmement, venons-en au mensonge contenu dans le discours de François Bayrou sur la question générationnelle. Dire que la dette publique aurait été engendrée par une génération implique de regarder l’état du capital public tel qu’il s’est développé durant la vie active de cette génération. Or, l’ampleur des infrastructures (autoroutes, TGV, aéroports, centrales thermiques et nucléaires, etc…) s’est considérablement accrue de 1968 à 2020. La France est, en termes de capital public seuls, beaucoup plus riche qu’elle ne l’était en 1968. C’est la contrepartie de la dette publique. Donc, tenir le discours selon lequel une génération aurait creusé la dette, faire croire qu’une génération aurait confisqué à son profit l’émission de cette dette, est un pur mensonge, et même ce que l’on appelle un mensonge puant.
Le déficit renvoie soit à un problème de recettes insuffisantes, soit à un problème de dépenses excessives et, dans les faits, fréquemment aux deux.
Ceci ne veut pas dire que l’ampleur du déficit, ou qu’un niveau très élevé (mais encore faudrait-il définir un seuil…) de la dette publique ne soient pas des problèmes économiques légitimes. Mais, une fois qu’ils sont débarrassés des la démagogie mensongère de François Bayrou (et, soyons justes, de quelques autres…) on peut les aborder raisonnablement. Le déficit renvoie soit à un problème de recettes insuffisantes, soit à un problème de dépenses excessives et, dans les faits, fréquemment aux deux. Le problème d’une dette élevée pose donc celui d’auprès de qui cette dette a été placée et des institutions existantes ou non existantes qui permettent de « renationaliser » cette dette. Ce sont des problèmes réels, par ailleurs autant techniques que politiques. Mais, cela n’a rien à voir avec la démagogie de la dette que l’on nous sert du petit-déjeuner au souper.
Front Populaire : Force est de le constater : dans le champ politique, même les partisans les plus véhéments du rétablissement de finances publiques saines n’évoquent pas la question de l’euro. Quelle est la part de responsabilité de la monnaie unique dans l’état économique de la France ? Et plus généralement, celle de l’UE ?
Jacques Sapir : Effectivement, la responsabilité de l’euro puis de l’UE dans la situation budgétaire et financière française est importante, et très largement sous-estimée. Tous les politiciens qui braillent sur le rétablissement des comptes publics oublient l’éléphant dans le couloir, autrement dit la responsabilité écrasante de l’euro et de l’UE dans la situation financière actuelle de la France. Mais les mécanismes de l’action de l’euro et de l’UE ne sont pas les mêmes.
Commençons par l’euro, dont j’ai écrit qu’il conduisait non seulement la France, mais aussi l’Europe, à la catastrophe (1). Il induit une surévaluation du taux de change réel du franc (qui est un taux « virtuel » puisque le franc n’est plus utilisé) face au Deutschemark mais aussi au florin néerlandais. Cette surévaluation, faible initialement en 1999, s’est largement accentuée par la suite. La publication du External Sector Report du FMI (2) pour 2017 a souligné le problème posé par l’euro pour des pays comme la France, mais aussi pour l’Italie et l’Espagne. Les écarts de taux de change réels sont d’ailleurs régulièrement calculés par le FMI.
/frontpop/2025/09/Capture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202025-09-15%20a%CC%80%2013.07.40.jpg)
L’écart avec l’Allemagne était donc compris entre 26% et 43% 18 ans après l’entrée en vigueur de l’euro dit « scriptural ». Cela signifie que pour que les taux de change réels soient les mêmes, le « franc » aurait dû se déprécier entre 26% et 43%. Bien entendu, cela est désormais impossible car la France a abandonné le franc pour l’euro. Ces écarts expliquent sans peine pourquoi l’économie française souffre dans ses relations avec les autres pays, l’Allemagne bien sûr au premier chef, mais aussi la Chine et les Etats-Unis. Cet écart de taux de change explique aussi la désindustrialisation qui frappe la France depuis 1999.
L’impact sur la croissance a aussi été important mais plus progressif. On peut chercher à le calculer de deux manières différentes. Soit on considère que la France, sans l’euro, aurait continué sur la pente de 1998-2002 (avec un taux de 2,8% par an), soit on considère que l’impact de l’euro peut se calculer à travers la comparaison des taux de croissance d’avant la crise financière de 2008, avec le taux de 1998-2002 pouvant être considéré comme représentatif de la dynamique « hors euro » et celui de 2003-2007 comme représentatif de la dynamique « dans l’euro ». Dans ce cas, on est conduit à estimer à -0,8%/-1,0% de croissance du PIB par an l’impact de l’euro sur le taux de croissance de l’économie française. L’impact sur le PIB à prix constants est alors considérable, d’autant plus que l’on sait que l’économie française doit avoir une croissance d’au moins 1,3% pour que le chômage baisse.
Les conséquences de cette situation, qui a globalement duré jusqu’à la crise COVID, sont doubles. On a tout d’abord un effet de freinage sur la croissance française qui est loin d’être négligeable. Pour le compenser, et maintenir un taux de croissance égal, voire supérieure, à celui de l’Allemagne, le gouvernement a dû procéder à un déficit budgétaire d’environ 1,0% à 1,5% tous les ans, à partir du moment où les effets négatifs du taux de change ont commencé à être important, soit 2006-2007. Ce déficit est évidemment indépendant des chocs exogènes, comme celui de la crise financière des « subprimes ».
Le « retard de croissance » induit par l’effet dépressif de l’euro contraint le niveau du PIB de la France.
Ensuite, les entreprises françaises ont commencé à souffrir de cette surévaluation du taux de change réel et il a fallu les aider à compenser ce handicap. Les mesures d’aides ont commencé en 2009, mais se sont développé surtout après 2012-2013 quand la hausse du chômage est devenue un problème politique et que la désindustrialisation est devenue un problème sérieux. De nombreuses mesures ont été prise, dont le CICE, qui a été intégré dans le budget par la suite. Au total, les aides pèsent, que ce soit en réduction de recettes (abattements fiscaux) ou en dépenses pures environ 4,0% à 5,0% du PIB. On constate que c’est presque le montant du déficit budgétaire actuel.
En ce qui concerne la dette publique, (…) on peut considérer que l’euro est responsable entre 20% et 25% du rapport dette/PIB.
Enfin, le « retard de croissance » induit par l’effet dépressif de l’euro contraint le niveau du PIB de la France. Alexandre Lohmann a calculé cet impact dans une étude récente. Mon centre de recherche, le CEMI, avait fait un calcul similaire fin 2019-début 2020, calcul que j’avais présenté dans mon émission su Russia Today à la toute fin de 2021. Charles Gave, un économiste bien connu, a lui aussi obtenu des résultats convergents. Ces travaux montrent que le déficit budgétaire consenti de 2006 à 2019 a été incapable de corriger l’impact de l’Euro
/frontpop/2025/09/Capture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202025-09-15%20a%CC%80%2013.19.02.jpg)
Or, cette croissance qui a été « perdue » du fait de l’Euro se serait traduite par des rentrées fiscales et de cotisations plus importantes qui auraient équilibré, par exemple, le régime des retraites, et en bonne partie les comptes de la sécurité sociale.
Au total, aujourd’hui, en raison des effets cumulatifs du poids de l’euro sur l’économie française, on peut considérer qu’il représente directement ou indirectement (via les abattements fiscaux consentis aux entreprises) environ 6,0% du PIB. En ce qui concerne la dette publique, c’est plus compliqué à calculer, mais on peut considérer que l’euro est responsable entre 20% et 25% du rapport dette/PIB.
Mais il y a plus grave. Admettons que la France n’ait pas adopté l’euro. Elle aurait pu consacrer une partie des dépense publiques, tout en restant avec un déficit annuel de l’ordre de 2,0% à 2,5% – dans les clous de l’orthodoxie budgétaire –, à des dépenses de recherches et à des investissements en infrastructures qui aurait eu un effet positif sur la croissance. De même, si la France n’était pas entrée dans l’Eurosystème, elle aurait pu conserver des méthodes de financement de la dette publique (comme par exemple le plancher des effets publics dans le bilan des banques) qui auraient évité de recourir à des prêteurs étrangers et auraient encore plus réduit les taux d’intérêts sur la dette existante.
Les effets cumulatifs de l’euro sur l’économie française, et donc sur la dette publique et le déficit budgétaire sont très lourds.
Ils ne sont pas les seuls. L’impact du marché unique puis de l’Union européenne – en empêchant l’économie française d’adopter des mesures de politique industrielle et de protection de certaines de nos industries naissantes – a certainement contribué à dégrader la situation de la France. Si la surévaluation du taux de change réel induite par l’euro est responsable d’une partie de la désindustrialisation de la France (dans le secteur de l’automobile notamment) le marché unique et l’UE sont responsables d’une autre partie. Or, avec la désindustrialisation, ce que la France a perdu sont des emplois à forte valeur ajoutée, bien rémunérés, dont les cotisations sociales abondaient aussi dans les années 1970 la sécurité sociale et les caisses de retraites. Compte tenu du montant des cotisations dans le salaire brut, cela aboutit à un énorme manque à gagner pour la sécurité sociale et les caisses de retraites. Nous aurions pu alors, sans déficit, conserver la retraite à 60 ans et maintenir une sécurité sociale de qualité.
Estimer l’impact sur le budget du marché unique et de l’UE est très difficile, parce que les effets en sont mélangés avec ceux de l’euro. Mais, on peut raisonnablement estimer que cela a privé le budget social d’environ 1 points de PIB (sans doute moins dans les années 1990, et sans doute plus depuis les années 2010).
Front Populaire : On parle beaucoup de la dette publique, mais de quoi s’agit-il précisément ? Problème fondamental (et insoluble ?) ou véritable épouvantail politico-médiatique ?
Jacques Sapir : La dette publique est le produit cumulé du besoin de financement net de l’État. La « garantie » de cette dette, c’est la capacité de l’État à lever des impôts. Quand le déficit s’accroit en pourcentage (et pas seulement en valeur), cela montre qu’il y a un problème, soit au niveau des dépenses, soit au niveau des recettes. Bien sûr, il peut y avoir des chocs exogènes comme une crise financière, la COVID-19 ou les conséquences des sanctions prises contre la Russie qui rendent des dépenses supplémentaires nécessaires. Quand, un fois ces chocs passés, le déficit ne revient pas à son pourcentage précédent alors, oui, il y a un problème. La France avait, hors période de crise, un déficit tendanciel de 3,0% à 3,5%, dont environ 1,0% à 1,5% pour combattre les effets récessifs de l’euro. Mais quand on se trouve, hors choc exogène, avec un déficit de 5,5% à 6,5%, il y a bien un problème, et qui se trouve sans doute à la fois du côté des dépenses et de celui des recettes.
Ce déficit engendre un gonflement de la dette. Mais toute dette est-elle nocive ? Car, comme je l’ai dit plus haut, la dette publique est nécessaire dans une économie moderne. Il est difficile de calculer un niveau « optimal » de la dette publique, mais on constate que la Corée du Sud (avec 53% de rapport dette/PIB) et le Japon (avec 212%) vivent sans problème. Le problème est donc plus le taux d’intérêt de cette dette. Ainsi, en 1998, la Russie avec une dette de seulement 30% du PIB mais empruntée à un taux de 40% devait payer environ 12% du PIB, ce qui était insoutenable, alors que la France avec 110% de son PIB, mais à un taux à 10 ans de 3,44%, (avant la dégradation de la note française réalisée par Fitch dans la soirée du 12 septembre) ne paiera que 2,92% de son PIB. Notons que le taux d’intérêt à 10 ans de la France est égal à celui de la Slovaquie dont, pourtant, le rapport dette/PIB n’est que de 56,0%. De même la Norvège, qui est pourtant notée AAA et dont le rapport dette/PIB n’est que de 39,0%, paye pourtant un taux à 10 ans de 4,0%. Le lien entre le taux à dix ans et la notation n’est pas clair. De même, le lien entre le taux à dix ans et le rapport dette/PIB n’est pas évident. Ce qui est donc problématique serait à la fois une maturité trop courte de la dette (cas de la Russie avant 1998) ou une forte hausse des taux pour un pays dont le rapport dette/PIB est élevé. Pour la France, la maturité de la dette est bonne (légèrement au-dessus de 7 ans) et le taux, même s’il est élevé, reste raisonnable. Il n’y a donc pas de « problème insoluble » ou « dramatique », même si une hausse importante du taux à dix ans serait un problème.
La question de la désindustrialisation est fondamentale pour comprendre la question du financement des retraites.
On est donc bien plus face à un épouvantail médiatique, comme vous le suggérez. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas de problème. Mais, ce dernier se situe plus au niveau des marges de manœuvres de l’économie française. La France va payer en 2025 pour les intérêts de la dette entre 62 et 65 milliards d’euros. Faire baisser cette somme autour de 35 milliards dégagerait des moyens pour investir dans des domaines urgents comme la recherche et développement ou l’IA et ses applications. Le problème est donc là. L’accroissement de la dette et du taux d’intérêts réduit les marges de manœuvre de l’économie française. Ce n’est donc pas la menace de l’apocalypse, de l’arrivée en France du FMI (encore faudrait-il que le gouvernement l’appelle…) ou la mise sous tutelle de la France par l’Eurogroupe. Mais, c’est un problème récurrent. Nous n’investissons pas, ou plus précisément nous investissons moins qu’il y a trente ans, dans l’avenir.
Front Populaire : On le sait bien : la France est largement désindustrialisée et sa balance commerciale est particulièrement mauvaise. Ces problèmes sont-ils selon vous plus pressants que celui des retraites, avancé notamment par François Bayrou ?
Jacques Sapir : Oui, incontestablement. Ce sont deux questions absolument fondamentales sur lesquelles François Bayrou, mais aussi une bonne partie de la « gauche », ont été si ce n’est silencieux, du moins extrêmement discrets alors qu’il rameutait la population avec tambours et trompettes sur la question des retraites.
La question de la désindustrialisation est fondamentale pour comprendre la question du financement des retraites. L’emploi industriel a, traditionnellement, une productivité plus importante que l’emploi non industriel. Il contribue à faire monter le gain annuel en productivité de l’ensemble de l’économie quand la part de l’industrie croît et à la faire baisser quand cette part décroît. Or, le gain annuel de productivité est essentiel pour le financement du système social dès lors que la part des actifs dans la population diminue. Quand on dit que l’on devrait travailler plus longtemps car cette part des actifs diminue, on « oublie » (et ce n’est pas innocent) le rôle de la productivité. Au rythme moyen des années 1970, en 25 ans, un travailleur avait augmenté de 94,7% sa production. Le ratio inactif/actif aurait-il diminué de 30% en 25 ans (ce qui n’a pas été le cas), que les gains de productivité auraient encore pu payer le maintien des retraites, voire de les augmenter d’un tiers environ.
Mais, évidemment, encore faut-il que le rythme des gains de productivité se maintiennent dans le temps et c’est là que la désindustrialisation fait sentir ses effets négatifs. Regardons un simple exemple où, pour simplifier, nous avons des gains annuels de 5% dans l’industrie et de 1,8% dans le secteur non-industriel. Le fait de passer d’une part de l’industrie dans le PIB de 27,5%, ce qui était le cas dans les années 1970 à 10% actuellement implique une baisse non négligeable de la productivité totale de l’économie.
/frontpop/2025/09/Capture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202025-09-15%20a%CC%80%2013.56.04.jpg)
Le gain annuel total de productivité a perdu 21%. Or cette perte implique que le gain en production sur 25 ans passe de 93,7% au rythme et avec la structure industrielle des années 1970 à 69% (soit -26%) pour le rythme et la structure industrielle de 2025. On voit la place centrale que jouent les gains de productivité dans la capacité d’une économie à maintenir (et à améliorer) un niveau de protection sociale donné sur longue période avec une baisse des actifs, et l’impact dramatique de la diminution progressive de la part du secteur où ces gains sont les plus grand, autrement dit de la désindustrialisation.
Dans le monde moderne, la dépendance induite par la désindustrialisation est irrémédiable.
Cette question est effectivement centrale pour l’évolution du système des retraites et l’on voit bien que la réponse de François Bayrou est à contre-sens de ce que l’on aurait dû faire en longue période. Mais, il faut ajouter que la « gauche » est toute aussi aveugle sur ce sujet. En effet, depuis 2021, la France a connu – et nous sommes un cas unique en Europe – un quasi arrêt des gains de productivité. Ceci est bien documenté sur le blog de l’INSEE. Donc, prétendre que l’on peut revenir à la retraite à 60 ans, ce qui serait naturellement souhaitable, n’est plus possible aujourd’hui. Je constate d’ailleurs que des dirigeants des partis de gauche à qui j’avais communiqué ces résultats, et dont certains sont pourtant des « économistes » (Mme Sandrine Rousseau est maître de conférences en économie) sont incapable de comprendre la logique implacable des gains de productivité pour l’équilibre de notre système social.
Par ailleurs, la question de la désindustrialisation nous condamne à être dans la dépendance des pays industrialisés. On parle beaucoup de la dépendance que créerait la dette. Mais ce problème est bien moins important, car il existe une série de mécanismes qui permette de s’émanciper de la tutelle d’un prêteur, que celui que crée la désindustrialisation. Dans le monde moderne, la dépendance induite par la désindustrialisation est irrémédiable.
Venons-en maintenant à la question de la balance commerciale.
Depuis 2000 (tiens, tiens…) notre balance commerciale a vu son excédent fondre puis se transformer en déficit. Ce dernier atteint même pour 2024 à peu près 80 milliards d’euros, soit environ 3,0% du PIB. C’est évidemment l’impact de l’euro. On remarquera, d’ailleurs, que la politique de « franc fort » qui a été menée de 1986 au début des années 1990, et dont le but était de « préparer » l’économie française à l’Euro avait, elle aussi à son époque, abouti à une dégradation sensible du solde commercial de la France.
/frontpop/2025/09/Capture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202025-09-15%20a%CC%80%2014.31.43.jpg)
Bien sûr, les flux financiers (investissements étrangers, retour des profits) équilibrent la balance des paiements. Mais, l’ampleur de ce déficit commercial pose, à terme, la question de l’équilibre extérieur de la France. En fait, le déficit commercial est un symptôme, un indicateur, de la désindustrialisation du pays. Non seulement nous n’exportons plus de biens manufacturés pour compenser nos achats de matières premières, mais nous perdons sans cesse du terrain sur notre marché intérieur.
Donc, oui, c’est une question bien plus fondamentale que celle des retraites et c’est un indicateur bien plus réel et radical de déclassement de la France que la question du déficit, de la dette publique et que celle des retraites.
Présenter l’État comme un « monstre » qui prendrait à la population sans qu’il y ait un effet immédiat de retour est tout simplement faux.
Front Populaire : La droite dit “austérité” (voire “afuera !”), la gauche dit “taxer les riches”. Ces solutions sont-elles selon vous pertinentes ? Suffisantes ? Que devrait dire le souverainisme – s’il devait devenir une force politique unifiée et cohérente ?
Jacques Sapir : Bien sûr, nous avons des injonctions contradictoires qui nous viennent des deux bords de l’échiquier politique.
La droite dit, en substance, il faut moins d’État, comme si l’État était un monstre qui dévorerait les impôts. Or, d’un point de vue économique, l’État fait trois choses : il redistribue, il consomme et il investit. Ces trois choses sont positives pour l’économie. On peut toujours contester la gouvernance de l’État, les choix d’investissement, voire l’ampleur de de la redistribution (ou ses critères). C’est l’objet de la politique. Mais, présenter l’État comme un « monstre » qui prendrait à la population sans qu’il y ait un effet immédiat de retour est tout simplement faux.
Si l’on regarde maintenant les politiques d’austérité, qui visent-elles ? Toujours les classes populaires, soit directement, soit indirectement au travers de la diminution des services publics. Sont-elles efficaces face à une réduction du déficit budgétaire et de la dette publique ? Pas réellement : le cas de la Grèce est à ce titre instructif. La très forte réduction des dépenses publiques imposée par l’Eurogroupe (et acceptée par Tsypras) provoque à court terme une forte contraction du PIB. Le déficit en pourcentage reste le même car les recettes se contractent à peu de choses près comme les dépenses. La dette continue d’augmenter, mais comme le déficit recule, le rapport dette/PIB explose. Il faut attendre la baisse des salaires réels (qui prend plusieurs années), qui induit ce que l’on appelle une « dévaluation interne », mais aussi l’émigration d’une partie de la population (qui va chercher du travail en Allemagne notamment) pour que la situation se stabilise et que le PIB recommence à augmenter. Une sortie de l’Euro, même faite en catastrophe (comme y était résolu le ministre de l’économie de l’époque Varoufakis), aurait été bien moins traumatique. Avec une forte dévaluation, la production grecque aurait retrouvé sa compétitivité et les entrées de capitaux venant des armateurs grecs se faisant en dollars aurait été multipliées par la dévaluation de la monnaie, permettant à la Grèce de retrouver un équilibre extérieur.
La gauche dit « taxons les riches ». Que c’est une idée, qu’elle est intéressante, comme aurait dit en son temps Coluche. Première question à laquelle il faut répondre : qui sont les riches ? Et, sur ce point, on va entrer dans un débat sans fin. De plus, on confond souvent richesse en revenu et richesse en patrimoine. Or seule la richesse en revenu est réellement imposable. Alors on dit, on ne va pas taxer les riches mais les « hyper-riches ». Il y a déjà un progrès, mais comment ? La taxe Zucman, elle, se propose de taxer à 2% le patrimoine des « plus riches ». Sauf que ce patrimoine est souvent un patrimoine professionnel (entreprises) et qu’il est, pour partie, un patrimoine virtuel.
Sur ce dernier point, un exemple. Admettons que je possède 1 millions d’euros en actions aujourd’hui (12 septembre) quand le CAC 40 est à 7825 points. Mais, il y a cinq ans, fin mars 2020, le CAC était tombé à 4351 points soit une baisse de 44%. La valeur de mon portefeuille n’aurait été que de 660 000 euros. En fait, je ne possède pas ces 1 million d’euros, mais un droit à un revenu irrégulier (les dividendes, qui fluctuent avec la santé de l’économie) et une capacité de revente de ces actions, laquelle dépend du cours des actions. Si je les revends au cours où je les ai achetées, je ne fais aucun bénéfice. Or, les dividendes comme la revente des actions quand il y a plus-value sont déjà taxés. On peut considérer qu’ils ne le sont pas assez et l’on peut vouloir augmenter l’imposition. Ce n’est pas un problème, mais cela rapportera assez peu.
D’autre part, quand le patrimoine est professionnel, il faudrait comparer le montant de la taxe Zucman au taux de retour sur le capital. Or, suivant la nature des activités, ce taux varie beaucoup. Il y a plein d’activités dont le retour sur capital (autrement dit le profit annuel sur la valeur du capital) est inférieur ou égal à 2%. Dans ce cas, la taxe Zucman provoquerait un désastre. Elle ne pourrait être appliquée qu’à des activités dont le retour sur capital serait de 5% ou plus. Ces activités existent, et on peut considérer qu’elles doivent être taxées du fait des « sur-bénéfices » qu’elles engendrent. Encore faut-il discerner ce qui, dans un « sur-bénéfices », relève d’un effet de rente (comme dans l’industrie pétrolière par exemple) et ce qui relève d’un effet d’innovation. S’il est légitime de taxer les premiers, il est stupide, d’un point de vue économique, de taxer les seconds, du moins tant que les effets de l’innovation se font sentir. On doit donc prévoir un délai d’exemption. Sauf que la durée d’une innovation – avant qu’elle ne soit entièrement intégrée et copiée – varie considérablement suivant les branches économiques…
La taxe Zucman s’avère tourner au casse-tête chinois et n’est donc pas une bonne idée. Alors on peut dire, créons une tranche supplémentaire pour l’impôt sur le revenu. Effectivement, cela peut fonctionner, mais rapportera peu. Car, pour les « riches d’entre les riches », la libération des capitaux voulue par l’UE (tiens, tiens…) leur permettra toujours de s’évader. Donc, une réforme du système fiscal afin de la rendre plus progressif, oui, assurément c’est une bonne idée. À la condition qu’elle soit utilisée pour diminuer la charge pesant sur les niveaux bas et moyen de la classe moyenne. Cela rendra le système plus juste, et plus tolérable – ce qui est un objectif légitime – mais ne fera pas rentrer tant argent que cela dans les impôts. Chercher à taxer les revenus de la rente (quelle que soit cette rente, y compris financière) et diminuer les impôts sur le travail et la production, oui, assurément ce serait une bonne idée. Mais, ici encore, le gain net ne sera pas extraordinaire, loin de là. Cependant, il y a d’autres solutions…
Un point de vue souverainiste peut aider sur la question. J’ai écrit, et je le maintiens, que l’euro a été une catastrophe pour la France et que le poids de l’UE, et même du « marché unique », a exercé un effet délétère sur l’économie française. Supposons qu’un gouvernement souverainiste conséquent arrive au pouvoir, que ferait-il ?
Être un souverainiste conséquent, ce n’est pas se contenter de faire de grandes déclarations sur la souveraineté de la France et sur sa « grandeur ». C’est utiliser l’ensemble des marges de manœuvre que nous donnerait notre souveraineté retrouvée pour construire une politique économique plus juste, une politique économique de croissance et de réindustrialisation du pays.
Évidemment, il sort de l’UE et l’euro et accepte une dépréciation de 30% du « franc » retrouvé. Cela permet de supprimer une partie des aides consenties aux entreprises justement pour compenser l’euro. Le gain serait sans doute, à minima, de l’ordre de 3 points de PIB, peut-être plus, mais jouons la sécurité. Admettons qu’il en utilise 1 point pour des subventions dans le cadre d’une politique industrielle rénovée. Le gain net, par rapport au déficit budgétaire, est donc de 2 points de PIB. N’étant plus contraint par les règles de l’Eurosystème, il remet en place un cadre financier visant à une renationalisation de la dette (comme le plancher d’effets publics pour les banques et institution financières souhaitant opérer en France) et il autorise la Banque de France (qui aura alors perdu son indépendance) à « prendre en pension » des bons du Trésor, et à en acheter directement (avec une limite annuelle) à l’État. Cela ferait baisser la charge des intérêts, actuellement presque 3 points de PIB d’environ 1,33 points de PIB. Par ailleurs, un tel système nous protègerait complètement des agissements des agences de notation. Le gain net en point de PIB sur le déficit budgétaire de 3,33 points de PIB.
Par ailleurs, la contribution nette de la France à l’UE disparait (9 milliards d’euros pour 28,8 milliards d’euros de contribution totale). Cela représente approximativement 0,33 points de PIB. Donc, par rapport au déficit budgétaire annuel, on passe de 5,8 points de PIB à 2,14 points de PIB. En euros de 2024 cela représente un passage de 155,9 milliards d’euros à 57,5 milliards d’euros, soit un gain de 98,4 milliards d’euros. Même dans ses rêves les plus fous, jamais François Bayrou n’aurait imaginé cela ; lui qui n’espérait qu’une réduction de 44 milliards d’euros.
Dans le moyen terme, un gouvernement souverainiste s’attaquerait aussi au système fiscal français, pour le rendre plus juste, à une politique industrielle rénovée, mettrait sur pied une véritable planification (3), comme dans les années 1960, afin de réindustrialiser la France. Être un souverainiste conséquent, ce n’est pas se contenter de faire de grandes déclarations sur la souveraineté de la France et sur sa « grandeur ». C’est utiliser l’ensemble des marges de manœuvre que nous donnerait notre souveraineté retrouvée pour construire une politique économique plus juste, une politique économique de croissance et de réindustrialisation du pays. C’est ce que nous avions écrit avec Philippe Murer et Christophe Durand en 2013 (7). Sur la base de cette politique de croissance et de réindustrialisation, il serait alors possible de revenir, progressivement, dans un délai de 5 ans, à la retraite à 60 ans. ■
:max_bytes(300000)/frontpop/2023/01/WhatsApp%20Image%202023-01-18%20at%2016.40.41.jpeg)
Propos recueillis par Quentin Rousseau
Notes
1 Sapir, J., L’Euro contre la France, l’Euro contre l’Europe, Paris, le Cerf, 2016.
2 Voir http://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2017/07/27/2017-external-sector-report et http://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2016/12/31/2016-External-Sector-Report-PP5057
3 Voir Sapir J., Le Grand Retour de la Planification ? Paris, Éditions Jean-Cyrille Godefroy, mars 2023
4 Sapir J., Les scénarii de dissolution de l’Euro, (avec P. Murer et C. Durand) Fondation ResPublica, Paris, septembre 2013
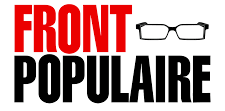












Peut-on ajouter quoi que ce soit après ce déluge de science ? Tout ce qui concerne la désindustrialisation, la question de la productivité, le déficit commercial extérieur et l’impact de l’euro me semble frappé au coin du bon sens.
La dédramatisation proposée pour la dette publique m’apparaît très confuse. M. Sapir reconnait que la masse des dettes envers les non résidents posent un réel problème. Dont acte
Un certain niveau d’endettement est certes indispensable à l’État. Comme à tout chef d’entreprise, comme à tout jeune ménage. Pour l’État, il y a aussi La question très complexe des relations avec la banque centrale et les banques ordinaires pour la maîtrise des masses monétaires.
On ne voit cependant aucune justification aux augmentations soudaines et démesurées le la dette publique telle qu’illustrées par l’image en tête. Pour leur plus grande part, elles ne s’expliquent pas par des investissements pour l’avenir mais par l’incurie des responsables publics. Certes, l’épargne privée et les autres richesses nationales garantissent la solvabilité de la France ; la possibilité d’une banqueroute financière est peut-être imaginaire, celle de la banqueroute politique l’est beaucoup moins. Et ses effets sur nos finances pourraient être redoutables.
Il est surprenant de voir la question de la retraite à 60 ans traitée de façon aussi légère, comme s’il n’y avait que quelques ajustement à faire pour la conserver. Sur ce sujet M. Sapir s’écarte du terrain scientifique.
De même quand il refuse qu’on qualifie l’État de monstre. Il est bien des moments où son incurie l’y fait ressembler fort.