
Un « prognostic » clair et complet, plus fatal que vital. Paru le 23 septembre dans Aleteia.
Par Mathilde de Robien.
Joachim Le Floch-Imad est enseignant et essayiste. Il publie en cette rentrée « Main basse sur l’Éducation nationale : Enquête sur un suicide assisté » (Éditions du Cerf). Il décrypte les causes de l’effondrement de l’école et fournit des pistes pour enrayer la crise. Entretien.

Chute du niveau, explosion des violences, crise des vocations… En France, l’école est en crise. Les réformes – et les ministres – se succèdent mais l’effondrement se poursuit. Joachim Le Floch-Imad pose un regard lucide sur le système éducatif français. Il le connaît de l’intérieur, a recueilli de nombreux témoignages de ministres, conseillers, hauts fonctionnaires et personnels éducatifs et montre l’envers du décor. Son constat est glaçant, autant que les conséquences si l’État n’adopte pas, selon lui, une politique de rupture. Au-delà d’une charge virulente contre le système en place, vérolé par les « experts », les lobbies et les syndicats de la rue de Grenelle, Joachim Le Floch-Imad souligne les enjeux cruciaux, pour notre civilisation, d’une véritable reprise en main de l’école.
Aleteia : Dans votre livre, vous décrivez non pas le déclin mais l’effondrement de l’école. Sur quels critères et quels faits vous appuyez-vous pour conclure à la faillite de l’Éducation nationale ?
Joachim Le Floch-Imad : Notre école subit un effondrement protéiforme, attesté par l’ensemble des statistiques officielles. Effondrement du niveau d’abord : la 26ᵉ place au classement PISA, un niveau moyen de nos écoliers en mathématiques situé entre le Kazakhstan et le Monténégro (TIMSS), et une piteuse 16ᵉ position sur 19 en lecture dans l’Union européenne (PIRLS). Effondrement de l’autorité des maîtres, ensuite, explosion de la violence (+114% d’incidents graves dans l’école publique en trois ans) et dégradation du climat disciplinaire de notre école, que PISA classe au 3ᵉ rang le plus mauvais de l’OCDE. Effondrement de la promesse républicaine, lorsque l’ascenseur social se bloque : un enfant issu des catégories populaires a aujourd’hui dix fois plus de chances d’être en difficulté que celui d’une famille aisée. Effondrement, enfin, de l’Éducation nationale comme institution, celle-ci ne donnant plus aux professeurs les moyens de leur mission et la considération qu’ils méritent, d’où l’explosion des démissions (+567% en dix ans) et la crise des vocations (-30% d’inscriptions au Capes en 20 ans). Tout ne se réduit néanmoins pas à des chiffres. Par l’enquête de terrain que j’ai conduite, j’ai voulu montrer l’envers du décor : mettre en lumière les réalités taboues de l’Éducation nationale et répondre à ceux qui feignent de croire que les professeurs en première ligne ne vivent pas ce qu’ils vivent et ne voient pas ce qu’ils voient.
Depuis des années, on évoque le déclin du niveau des élèves et de la qualité de l’enseignement, qu’est-ce qui est nouveau aujourd’hui ? Y a-t-il eu un déclic qui vous a fait réagir au point de mener cette enquête approfondie ?
Tant que la situation continuera de se dégrader et qu’aucune volonté politique forte pour l’école ne se manifestera, il faudra continuer d’alerter, tout en donnant à voir les réalités nouvelles auxquelles elle est confrontée : révolution numérique, prise en charge des enfants en situation de handicap dans le cadre de « l’école inclusive », conséquences de l’immigration, entrisme associatif, impact de la dégradation budgétaire sur le système éducatif. Si j’écris sur l’école depuis dix ans, plusieurs éléments m’ont conduit à rédiger ce livre : ma collaboration avec Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre de l’Éducation nationale, la noirceur des constats que j’ai pu dresser comme professeur dans le supérieur mais aussi la décapitation de Samuel Paty et l’assassinat de Dominique Bernard, à qui mon enquête est dédiée. Selon un rapport parlementaire, 100.000 professeurs sont menacés et agressés chaque année, qu’attend-on pour prendre les mesures qui s’imposent et mettre fin au « pas de vagues » qui, à rebours des promesses officielles, continue plus que jamais de sévir en pratique ?
On discute du sexe des anges pendant que le suicide de notre école se poursuit.
L’école est devenue le théâtre privilégié des renoncements de politiciens qui, faute de vision, de courage et d’expertise, abdiquent sitôt nommés et se retrouvent réduits, au mieux, à un rôle de gestionnaire, au pire de communicant. Les ministres défilent – sept en trois ans – et laissent l’école naviguer à vue, au gré de slogans, d’effets d’annonce et de propositions de façade. Il n’est qu’à voir ce qui tient lieu de débat éducatif en cette rentrée scolaire : éducation à la sexualité, intelligence artificielle, quotas filles-garçons en classes préparatoires, réglementation des réseaux sociaux, réforme des rythmes scolaires. Il est question de tout sauf de l’essentiel. On discute du sexe des anges pendant que le suicide de notre école se poursuit.
Vous imputez la responsabilité de cette faillite à un État dans l’État qui aurait fait « main basse sur l’Éducation nationale », comme l’annonce le titre de votre livre, quel est cet État dans l’État ? Qui le compose ?
La démission du politique a ouvert une brèche où s’est engouffrée l’administration de la rue de Grenelle, avec ses « experts », ses lobbies et ses syndicats qui édulcorent les réformes ou refusent purement et simplement de les mettre en œuvre. Cela ressemble à un État dans l’État, voire à un État profond. Des bureaucrates, quel que soit le verdict des urnes, demeurent inamovibles aux principaux postes, aussi bien dans l’administration centrale que dans les rectorats où certains hauts fonctionnaires se sont constitués de véritables baronnies, parfois avec des profils inquiétants.
L’État dans l’État, ce sont aussi les pédagogistes, omniprésents dans les INSPÉ (ex-IUFM), où l’on enseigne aux futurs enseignants à ne rien enseigner à leurs élèves, à coups de formations toujours plus idéologiques : « Guérir de l’hégémonie hétérosexuelle », « La nature a-t-elle un genre ? », « Queeriser le curriculum ». Je pense également aux syndicats qui outrepassent leurs prérogatives (la défense – légitime – des intérêts matériels de leurs mandants) pour défier l’autorité du ministre sur un terrain politico-idéologique. Les exemples ne manquent pas, de la contestation de l’interdiction de l’abaya au refus des « groupes de niveau », en passant par le rejet des méthodes de lecture les plus efficaces, la prise en otage des copies du bac sous Jean-Michel Blanquer ou encore le mouvement des « désobéisseurs » sous Xavier Darcos. S’y ajoute, enfin, le poids des juges, des gestionnaires de Bercy et des associations militantes agréées qui propagent un wokisme aux effets délétères pour notre jeunesse.
Vous alertez sur le fait que cet État profond impose des choix éducatifs qui sont aux antipodes des besoins réels des élèves et des attentes des Français. Quels sont ces choix éducatifs ?
Je fais d’abord référence au retournement de l’école contre sa mission première de transmission et d’instruction, symbolisé par le passage du ministère de « l’Instruction publique » à celui de « l’Éducation nationale ». Au cœur de ce brouillage des finalités, il y a la lame de fond de l’Éducation nouvelle, ce mouvement apparu au tournant du XXe siècle, dont le credo tient dans la formule du pédagogue Roger Cousinet : « Il faut que le maître cesse d’enseigner pour que les élèves commencent à apprendre. » Le triomphe de ce mot d’ordre – qui revient à faire de l’école une contre-société libertaire – ne fut possible qu’avec la complicité des politiques, en particulier la loi Jospin de 1989, qui place « l’élève au centre » et, avec la création des IUFM, transforme les maîtres en animateurs multitâches.
Au cœur du naufrage, il y a aussi le dévoiement de l’égalité en égalitarisme.
Au cœur du naufrage, il y a aussi le dévoiement de l’égalité en égalitarisme, c’est-à-dire le passage d’une logique républicaine d’ »égalité des chances » à une logique d’ »égalité des résultats ». Bourdieu a gagné la bataille des idées : sous prétexte d’en finir avec les héritiers, il faudrait liquider l’héritage, c’est-à-dire le savoir et l’exigence intellectuelle. De là découle la suppression des devoirs écrits à la maison en primaire, la quasi-disparition du redoublement, des notes et des options dites « élitistes ». Pire encore, dans des classes toujours plus hétérogènes, on a aligné les exigences sur ce que pouvaient assimiler les plus faibles – selon le vœu de François Dubet, l’un des penseurs organiques de l’Éducation nationale, qui déclarait, en 2001, souhaiter que les contenus enseignés au collège soient adaptés à « ce que doit savoir le plus faible des élèves quand il en sort ».
À cela s’ajoute une philosophie irénique, saturée de bons sentiments et de logique du « c’est mon droit » qui, face aux incidents, fait de la sanction l’exception et abandonne la jeunesse à elle-même au lieu de chercher à l’élever intellectuellement et moralement. Ce renoncement a largement contribué à la désanctuarisation de l’école, devenue caisse de résonance des fractures, de la violence et des forces centrifuges de la société. Enfin, parmi les choix les plus néfastes, figurent ceux des gestionnaires, qui imposent leur philosophie managériale et traitent l’école comme une simple variable d’ajustement. On ménage une bureaucratie pléthorique, tandis qu’on refuse de mettre les moyens là où ils seraient indispensables – le primaire, la revalorisation du métier enseignant – sacrifiés au nom d’efforts budgétaires mal orientés.
L’enseignement privé est-il préservé des maux que vous recensez dans votre ouvrage ?
De plus en plus de familles, déboussolées et inquiètes pour l’avenir de leurs enfants, en viennent à considérer l’enseignement privé comme un refuge : meilleurs résultats aux examens nationaux, cadre disciplinaire plus ferme, remplacement plus efficace des professeurs absents, climat scolaire moins violent. Mais le privé n’échappe pas, lui non plus, aux dérives qui minent l’ensemble de notre système éducatif. J’ai en tête, notamment, la baisse du niveau des jeunes enseignants. Il suffit de se pencher sur le niveau d’exigence au CAFEP, dont le taux de réussite dépasse largement les concours, pourtant toujours plus simples, de l’enseignement public.
Je crois stérile d’opposer enseignement public et enseignement privé.
Une controverse oppose ceux qui croient en une supériorité intrinsèque du privé et ceux qui attribuent ses résultats plus flatteurs à la sociologie privilégiée de son public. Pour ma part, je crois stérile d’opposer enseignement public et enseignement privé : l’enjeu n’est pas de dresser les deux systèmes l’un contre l’autre, mais de rebâtir une école de l’excellence au service de tous. On ne s’en sortira pas en déconstruisant le peu qui tient encore debout, ni en s’attaquant à la liberté de choix des familles – liberté que les plus grands républicains, de Condorcet à Victor Hugo, ont défendue en leur temps.

Il y en a assez de faire du privé un bouc émissaire de notre effondrement éducatif. Assez de ceux qui ne supportent pas qu’il existe une dimension « catholique » dans l’enseignement privé catholique. Assez de ceux qui, à La France insoumise notamment, rêvent de couper ses financements et, ce faisant, de rallumer les guerres scolaires. L’instrumentalisation de l’affaire Bétharram en a fourni une illustration indécente : lors de la commission d’enquête parlementaire qui en a résulté, certains ont cru pouvoir jeter l’opprobre sur l’ensemble de l’enseignement privé. Comme si l’existence d’une brebis galeuse suffisait à condamner tout le troupeau !
Quels sont les enjeux ? Vers où la France va-t-elle si l’Éducation nationale ne redresse pas la barre ?
Notre économie vaudra demain ce que vaut notre système éducatif aujourd’hui, tant en matière de gains de productivité que d’innovation et de croissance. Selon une étude de deux économistes, 25 points supplémentaires aux tests PISA représenteraient, d’ici 2100, 30 % de PIB en plus. Mais la mécanique fonctionne aussi dans l’autre sens : notre régression scolaire porte par conséquent en elle un risque de tiers-mondisation.
De sa capacité à transmettre les savoirs dépend le maintien de la paix civile, la barbarie des actes s’inscrivant toujours dans le vide de l’esprit.
Au-delà des seuls enjeux matériels, l’effondrement de notre école engage notre pronostic vital comme civilisation. Il n’est pas indifférent que, chaque fois que la France a été saisie par la peur de disparaître, elle se soit tournée vers son école pour y puiser le remède à ses malheurs et la force de résister à ses déconstructeurs. De sa capacité à transmettre les savoirs dépend le maintien de la paix civile, la barbarie des actes s’inscrivant toujours dans le vide de l’esprit. Se joue également la survie d’un modèle de citoyenneté, d’une conception de la civilité, d’une culture, d’une langue et d’une certaine idée de l’homme. La rationalité n’est-elle pas en crise lorsqu’un jeune sur cinq croit que les pyramides ont été bâties par des extraterrestres ? Peut-on encore « faire nation », selon l’expression désormais consacrée, lorsque la moitié des 16-24 ans ignore l’année où débuta la Révolution française ? L’école qui a fait la France hier est en train de la défaire aujourd’hui.
Quels sont les remèdes et les réformes que vous préconisez pour sauver l’école ?
Le salut passera par des politiques de rupture : recentrage sur les fondamentaux et la culture générale au détriment de l’approche par compétences et de l’idéologie des sciences de l’éducation, réécriture des programmes et reprise en main des manuels, reconstruction de la valeur certificative des examens, réhabilitation du redoublement et des notes, fin du collège unique, brevet couperet et sélection à l’université, remise à plat de l’éducation prioritaire et retour à l’assimilation, revalorisation des professeurs et réforme de leur formation, impunité zéro face aux violences, à l’islamisme et à la démission parentale, construction d’internats dédiés et de centres éducatifs fermés pour sortir les jeunes ultraviolents et radicalisés du circuit ordinaire, résistance au tout-numérique qui détruit notre jeunesse de l’intérieur.
Ce virage à 180 degrés ne sera possible qu’en libérant le politique de l’emprise de la technostructure, ce qui passe par le démantèlement d’une large partie des comités Théodule et de la bureaucratie de l’Éducation nationale. 20 % de la dépense totale est aujourd’hui consacrée à des personnels non-enseignants (340.000 tout compris), c’est intenable ! Des rotations ciblées seront en outre nécessaires aux postes-clés du ministère : directeurs d’administration (notamment DGESCO), secrétariat général, inspection générale, recteurs. À l’exigence de cohérence dans les nominations s’ajoute celle de sanctions à l’endroit des fonctionnaires – y compris les responsables syndicaux – qui violent le devoir de « loyauté » et de « neutralité » reconnu par les textes officiels. ■ MATHILDE DE ROBIEN
Mariée et mère de famille, Mathilde de Robien est journaliste chez Aleteia depuis 2016 pour les rubriques « Au quotidien » et « For Her ». Elle s’est spécialisée dans les sujets ayant trait au couple, à la famille et à l’éducation. Elle est également l’auteur de deux recueils de prières : « Le livre de prière du couple » (Mame, 2019) et « Prier avec les saints » (Mame, 2020) ainsi que des livres « Couple : se comprendre pour mieux s’aimer » (Mame, 2021) et « Se pardonner » (Mame, 2022).
Pratique
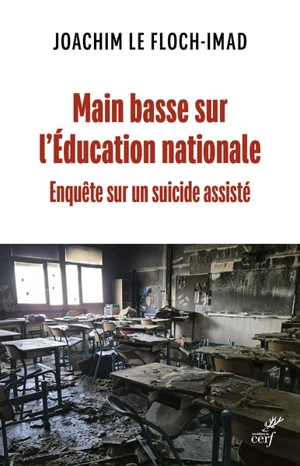
Main basse sur l’Éducation nationale : Enquête sur un suicide assisté, Joachim Le Floch-Imad, Le Cerf, août 2025, 20,90 euros.
Merci à Marc Vergier pour sa transmission, parmi bien d’autres…












