
À l’occasion, au mitan du XIXe siècle, de la parution des Prophètes du passé de Barbey d’Aurevilly, essai qui contient notamment un hommage à la grande figure contre-révolutionnaire Louis de Bonald, cet immense critique littéraire qu’était Charles-Augustin Sainte-Beuve signa un article-fleuve pour le Constitutionnel du 18 août 1851 où il présenta l’essentiel de sa vie et de sa pensée.
Retrouvez-le toute cette semaine, découpé en six parties.
M. de Bonald, qui est le premier dans sa préface à reconnaître les défauts de sa manière, pense pourtant que les livres sont faits pour exercer de l’influence, et c’est pour cela qu’il écrit, « Depuis l’Évangile jusqu’au Contrat Social, dit-il et répètera-t-il depuis en maint endroit, ce sont les livres qui ont fait les révolutions. » Les révolutions, qui ont changé en bien ou en mal l’état de la société, n’ont eu d’autre cause que la manifestation des vérités ou la propagation des erreurs. Pour lui, il croit que, depuis plusieurs siècles, c’est l’erreur qui se propage, et il veut rappeler les lois fondamentales et la vérité. Cette vérité, c’est qu’il n’y a qu’une, une seule constitution (entendez-vous bien ?) de société politique, et une, une seule constitution de société religieuse, la réunion et l’accord de l’une et de l’autre composant la vraie société civile. Cette unique constitution de société politique est la constitution royale pure, cette unique constitution de société religieuse est la religion catholique : hors de là, point de salut, même ici-bas, et nulle stabilité. C’est sur cette doctrine, chez lui fondamentale, et qui est le résultat du raisonnement comme la donnée de la foi, qu’il va discourir jusqu’au dernier jour, dire, redire sans cesse et répéter (car s’il est l’homme qui varie le moins, il est celui qui se répète le plus), et enchaîner toutes sortes de pensées élevées, fines où fortes, souvent mal sonnantes et tout-à-fait fausses, mais le plus souvent vraies encore d’une vérité historique relative au passé. M. de Bonald est le publiciste de la famille, de la royauté patriarcale, de l’autorité antique et immuable, de la stabilité sacrée.
On ne le comprend bien que quand on se le représente à sa date de 1796, en situation historique pour ainsi dire, en face des adversaires dont il est le contradicteur le plus absolu et le plus étonnant, non pas avec des éclairs et des saillies de verve et de génie comme de Maistre, mais un contradicteur froid, rigoureux, fin, ingénieux et raide. Jamais les Condorcet en politique, les Saint-Lambert en morale, les Condillac en analyse philosophique, n’ont rencontré un jouteur plus serré et plus démontant ; car, notez que, pour les réfuter, il ne dédaigne pas de prendre un peu de leur méthode ; il mêle un peu d’algèbre à son raisonnement, il a des formules pour revenir au ciel, et il se sert des mots exacts avant tout, il les presse et les exprime pour leur faire rendre tout l’esprit qu’ils recèlent et toute la pensée. Enfin il prend une partie de leurs armes à ses adversaires et les retourne contre eux, en remontant pied à pied.
Je ne citerai de sa Théorie du Pouvoir que deux ou trois endroits remarquables et qui peuvent s’entendre sans recourir à la formule. Développant pour la première fois cette pensée qu’il a depuis résumée ainsi et qui fait loi : La littérature est l’expression de la société, M. de Bonald examine dans leurs rapports la décadence des arts et celle des mœurs : « Ce serait, ce me semble, nous dit-il, le sujet, d’un ouvrage de littérature politique bien intéressant, que le rapprochement de l’état des arts chez les divers peuples avec la nature de leurs institutions. » Et il en donne à sa manière un aperçu, indiquant que la plus grande perfection des arts et des lettres, comme il les conçoit, répond généralement à l’état le plus parfait des institutions sociales, c’est-à-dire à la monarchie. Dans un chapitre intitulé : Des Gens de Lettres, il saisit très finement, les qualités distinctives de cette nouvelle espèce, née ou développée seulement au XVIIIe siècle ; il dénonce les inconvéniens d’un pareil corps vaguement introduit dans l’État et y devenant une puissance ; il essaie de la restreindre et d’assigner les termes dans lesquels il conviendrait, selon lui, de renfermer toute discussion littéraire, soit par rapport à la religion, soit par rapport aux mœurs. Rien n’est curieux comme cette sorte de Charte, ou plutôt de Loi Spartiate et hébraïque, que M. de Bonald méditait d’imposer aux écrivains, et cela pendant les plus grandes saturnales de la presse, en plein Directoire. Il n’entendait pas restreindre moins rigoureusement les arts du dessin, il était sans pitié pour les statues : « Gouvernemens, s’écria-t-il, voulez-vous accroître la force de l’homme ? gênez son cœur, contrariez ses sens ; semblable à une eau qui se perd dans le sable si elle n’est arrêtée par une digue, l’homme n’est fort qu’autant qu’il est retenu. » Se croyant déjà revenu à Lycurgue ou à Moïse, il proposait sérieusement à l’Administration de faire faire des éditions châtiées et exemplaires des auteurs célèbres : on extrairait de chaque auteur ce qui est grave, sérieux, élevé, noblement touchant, et on supprimerait le reste : « Tout ce qui serait de l’écrivain social serait conservé, tout ce qui serait de l’homme serait supprimé ; et, si je ne pouvais faire le triage, dit-il, je n’hésiterais pas à tout sacrifier. »
Telle est la pensée que M. de Bonald énonçait en 1796, qu’il continuera d’énoncer et d’exprimer pendant toute la Restauration, et qu’il voudra réaliser tant bien que mal en 1827, comme président du dernier Comité de censure ; peut-on s’étonner de la suite d’après le début ? Qu’un tel régime de littérature spartiate ou romaine, comme le pourrait régler un Caton l’ancien, soit souhaitable ou regrettable, je n’examine pas cette question, qui n’est autre que l’éternelle querelle entre les vieilles mœurs et le génie des arts ou de la pensée ; mais est-ce possible dans l’état actuel et prochain de la société, et sur les pentes nouvelles où se précipite le monde ? M. de Bonald n’en doutait pas. Là est le rêve.
Sa prévention était telle, qu’à peine si lui et les siens passaient l’esprit proprement dit à leur parti et pour la défense de leur cause. Un jour (le fait est de toute vérité), M. de Marcellus était allé voir M. Michaud dans les beaux jours de la Quotidienne : « Eh bien ! lui dit M. Michaud, vous devez être content, il y a de l’esprit dans notre journal. » — « Oui, répondit l’ami de M. de Bonald, et c’est précisément ce que je n’y aime pas : il y a toujours quelque chose de satanique dans l’esprit. » On croit entendre M. de Bonald lui-même. ■ (À suivre)

Pierre Boutang trouvait qu’« une espèce de perfection guerrière » caractérise l’essai de Charles Maurras Trois idées politiques, qui fut composé en 1898 et légèrement augmenté en 1912.
Dans ce volume c’est l’esprit grec dans toute sa pureté, sa splendeur, sa perfection, qui s’exprime ; une citation d’Anaxagore sur le « Noûs », l’Intelligence, ne vient pas figurer par hasard.

Si Maurras décida de traiter de trois idées, celle de Chateaubriand, puis celle de Michelet, et enfin celle de Sainte-Beuve, c’est qu’il s’attache à la démarche épistémologique grecque du ternaire, que l’on retrouve dans les règles de la rhétorique (ethos, logos, pathos), ou de la formulation d’un raisonnement (thèse/antithèse/synthèse ou les articulations d’un syllogisme : prémisses majeures et mineures dont on tire une conclusion), qui au fond découlent du grand principe d’identité entre le bien, le vrai et du beau, du principe que l’Un se réalise dans le Trois.
Cet ouvrage est le discours de la méthode maurrassien, où il développe son idée d’« empirisme organisateur » et expose son intention profonde : regrouper Le Play et Taine, Comte et Bonald, soit deux écoles a priori antagoniques, le positivisme et les contre-révolutionnaires.
Maurras rejette autant ceux pour qui l’âge d’or se situe uniquement dans le passé – Chateaubriand – que ceux qui ne le voient que dans le futur – Michelet –, érigeant le maître de la critique littéraire Sainte-Beuve en antidote de ces deux apories, celui qui marche sur ces deux jambes, quand l’un marche sur quatre et l’autre sur trois, pour reprendre l’énigme du Sphinx. ■
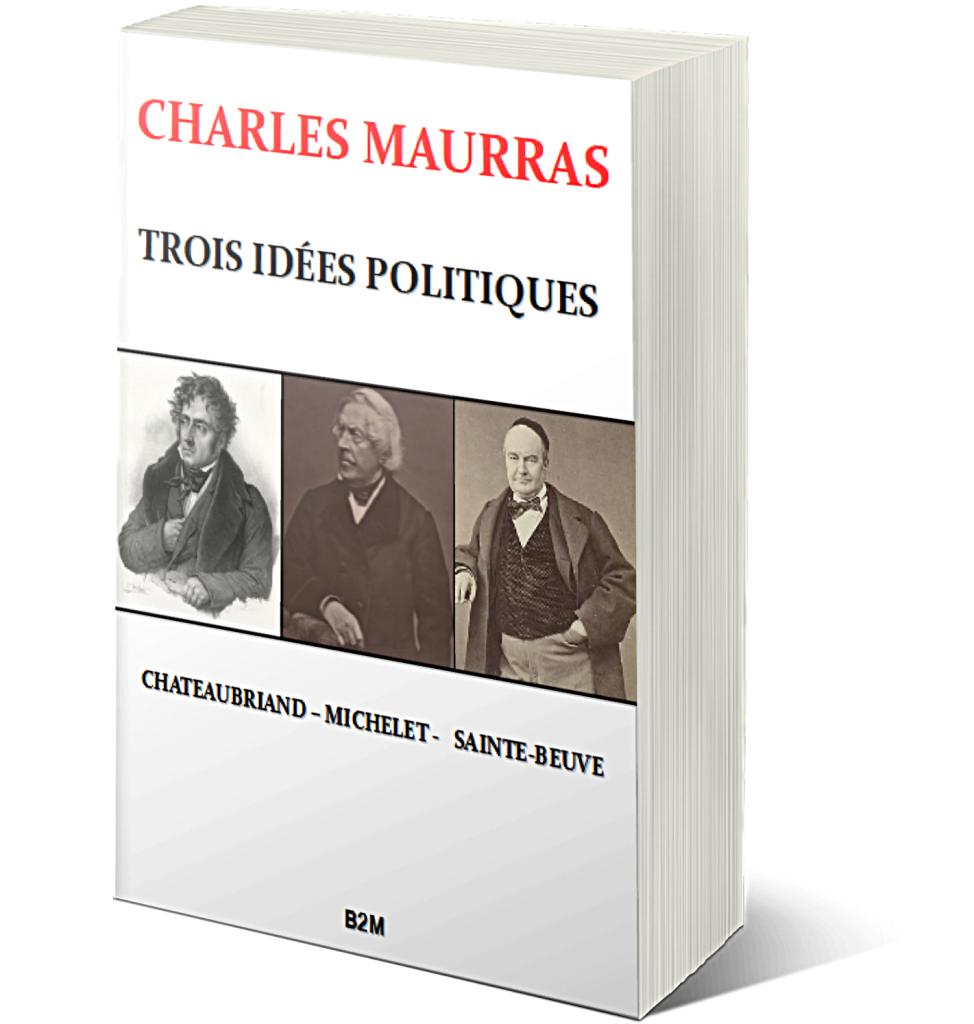
Nombre de pages : 92
Prix (frais de port inclus) : 21 €
Commander ou se renseigner à l’adresse ci-après : commande.b2m_edition@laposte.net ou Belle de Mai Éditions











