
À l’occasion, au mitan du XIXe siècle, de la parution des Prophètes du passé de Barbey d’Aurevilly, essai qui contient notamment un hommage à la grande figure contre-révolutionnaire Louis de Bonald, cet immense critique littéraire qu’était Charles-Augustin Sainte-Beuve signa un article-fleuve pour le Constitutionnel du 18 août 1851 où il présenta l’essentiel de sa vie et de sa pensée.
Retrouvez-le toute cette semaine, découpé en six parties.
Son Traité Du Divorce fut une noble et bonne action, et dont le fruit subsiste encore. Homme de famille, M. de Bonald, en s’occupant d’un tel sujet, était sur le fond et sur le roc même de sa conviction. Il sentait plus que personne la portée politique et publique d’une question où quelques-uns ne voyaient qu’un règlement de l’ordre privé et qu’une facilité domestique. Il y avait longtemps qu’il s’était dit : « C’est par l’état social des femmes qu’on peut toujours déterminer la nature des institutions politiques d’une société. » On peut regretter seulement que, là comme ailleurs, il ait compliqué les excellentes raisons de tout genre qu’il produisait, par d’autres trop absolues, trop abstruses et trop particulières. On dirait par momens qu’il obscurcit ses propres clartés à plaisir. Pour prouver la religion des premières familles et le sacerdoce des premiers patriarches, qu’avait-il besoin de passer par des espèces d’équations et de proportions où il fait entrer ses termes favoris, cause, moyen, effet, qui répondent ici à père, mère, enfant, et tout ce qui s’ensuit ? Mais, à côté de ces travers tout à fait désagréables du dialecticien, on aime à dégager de belles et justes pensées comme celle-ci, qu’il ne faut pas que la loi conspire avec les passions de l’homme contre sa raison : « Ainsi, du côté que l’homme penche, la loi le redresse, et elle doit interdire aujourd’hui la dissolution à des hommes dissolus ; comme elle interdit, il y a quelques siècles, la vengeance privée à des hommes féroces et vindicatifs. » La conclusion de ce Traité Du Divorce, adressée sous forme d’allocution aux législateurs du Code civil, est d’une grave et réelle éloquence ; l’âme de l’homme de bien et du bon citoyen s’y fait jour par des accens qui ne se laissent pas méconnaître ; on y entend ce cri vertueux et ce vœu de réparation, qui s’élève de la société après chaque grand désordre, et qui ne demande qu’à être régulièrement dirigé : « Commandez-nous d’être bons, et nous le serons. Faites oublier à l’Europe nos désordres à force de sagesse, comme vous avez effacé notre honte à force de succès. Vous avez fait de la France la grande nation par ses mœurs et par ses lois. C’est assez de gloire, c’est trop de plaisirs ; il est temps de nous donner des vertus. »
La Législation primitive qui paraissait tout à côté du Génie du Christianisme, et dans le même sens réparateur, était d’un genre bien différent : « La vérité dans les ouvrages de raisonnement, disait M., de Bonald, est un roi à la tête de son armée au jour du combat : dans l’ouvrage de M. de Chateaubriand, elle est comme une reine au jour de son couronnement, au milieu de la pompe des fêtes, de l’éclat de sa Cour, des acclamations des peuples, des décorations et des parfums. » Dans la Législation primitive, le corps du livre, qui ne se compose que d’une suite de propositions et d’axiomes souvent très contestables, rangés et numérotés comme les pierres d’un édifice non construit, ou comme une table de matières, a paru et partira toujours d’une lecture difficile et ingrate. D’autres parties subséquentes s’y joignent, qui n’y tiennent que pat voie de digression ; je ne sais pas d’ouvrage si étroitement raisonné et si mal composé. Mais ce qui est à lire, c’est le Discours préliminaire où tout M. de Bonald se trouve avec son système
Ce système, que je ne puis qu’indiquer brièvement, est celui-ci : M. de Bonald, homme de foi, d’une religion profonde, orthodoxe, et qui chez lui n’a jamais été ébranlée, croit fermement à la parole des Livres saints et à la création de l’homme telle qu’elle est consignée dans le récit de Moïse. Il croit donc que Dieu a fait l’homme à son image, et M. de Bonald a une manière de presser le sens des mots qui le mène à en tirer de longues et précises conséquences. De cette ressemblance et de cette similitude de l’homme avec Dieu, il résulte qu’il y a société, au pied de la lettre, entre Dieu et l’homme, et que celui-ci a reçu de Dieu la loi, la pensée et la parole sans laquelle la pensée humaine n’est pas. Et ce que Dieu a fait pour le premier homme, l’homme à son tour le fera pour ceux qui naîtront de lui : il leur enseignera la parole, et par elle la vérité, ce fonds commun et ce patrimoine de la famille, et de la société qui n’est que la réunion des familles. Ce n’est donc que hors de lui et par la société que l’homme s’instruit et s’élève ; il importe donc que ce fonds premier de vérité sociale ne soit point altéré, ou, s’il l’a été, qu’il soit réintégré et rétabli dans sa pureté primitive, comme il le fut, et même à un plus haut degré de perfection, lors de la venue de Jésus-Christ. Depuis lors les altérations ne sauraient plus être que passagères. C’est là l’espoir de Bonald, et, malgré les apparences contraires qui sont faites pour troubler les faibles, c’est là sa foi. Car il lui paraîtrait absurde et sacrilège de penser que Dieu a laissé un seul moyen de connaissance et de vérité aux hommes, et que ce moyen est à jamais détourné ou intercepté. Il croit donc en définitive au triomphe de la religion chrétienne catholique sur toutes les religions, et de la constitution monarchique pure sur tous les gouvernemens, comme il croit à une vérité géométrique, comme il est convaincu de l’égalité des diamètres d’un même cercle, c’est la comparaison qu’il emploie quelque part.
Ainsi, dans la société, M. de Bonald croit à un ordre particulier, aussi naturel et aussi nécessaire que l’ordre général de l’univers : il marche donc dans sa voie, tranquillement, fermement, sous l’œil de Dieu et de ceux qu’il a préposés, comme au temps de Moïse et du Décalogue, comme au temps de Grégoire VII et d’Innocent III, comme au temps de saint Louis. Que lui importe le XVIIIe siècle et que Voltaire soit venu ? Voltaire ne lui paraît que le plus grand des beaux-esprits. L’Esprit des Lois de Montesquieu ne lui semble écrit bien souvent qu’avec la même légèreté qui a dicté les Lettres persanes. ■ (À suivre)

Pierre Boutang trouvait qu’« une espèce de perfection guerrière » caractérise l’essai de Charles Maurras Trois idées politiques, qui fut composé en 1898 et légèrement augmenté en 1912.
Dans ce volume c’est l’esprit grec dans toute sa pureté, sa splendeur, sa perfection, qui s’exprime ; une citation d’Anaxagore sur le « Noûs », l’Intelligence, ne vient pas figurer par hasard.

Si Maurras décida de traiter de trois idées, celle de Chateaubriand, puis celle de Michelet, et enfin celle de Sainte-Beuve, c’est qu’il s’attache à la démarche épistémologique grecque du ternaire, que l’on retrouve dans les règles de la rhétorique (ethos, logos, pathos), ou de la formulation d’un raisonnement (thèse/antithèse/synthèse ou les articulations d’un syllogisme : prémisses majeures et mineures dont on tire une conclusion), qui au fond découlent du grand principe d’identité entre le bien, le vrai et du beau, du principe que l’Un se réalise dans le Trois.
Cet ouvrage est le discours de la méthode maurrassien, où il développe son idée d’« empirisme organisateur » et expose son intention profonde : regrouper Le Play et Taine, Comte et Bonald, soit deux écoles a priori antagoniques, le positivisme et les contre-révolutionnaires.
Maurras rejette autant ceux pour qui l’âge d’or se situe uniquement dans le passé – Chateaubriand – que ceux qui ne le voient que dans le futur – Michelet –, érigeant le maître de la critique littéraire Sainte-Beuve en antidote de ces deux apories, celui qui marche sur ces deux jambes, quand l’un marche sur quatre et l’autre sur trois, pour reprendre l’énigme du Sphinx. ■
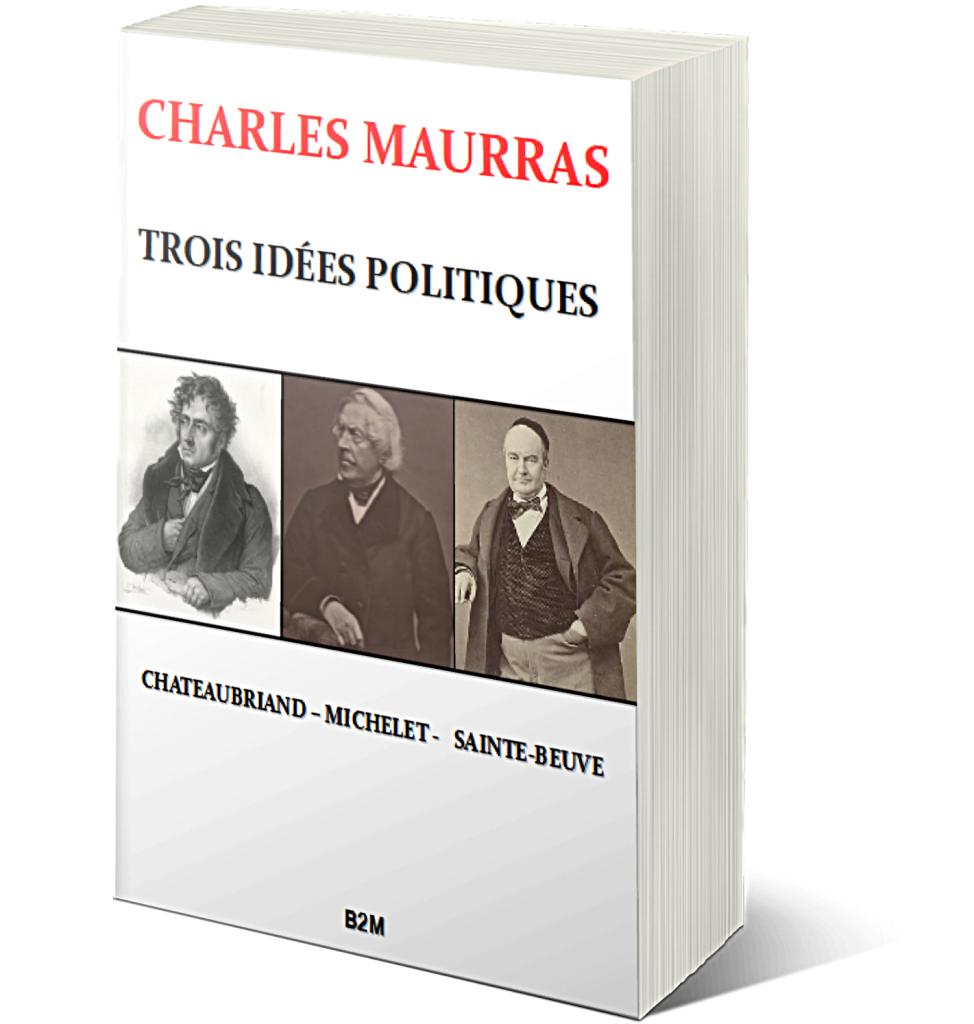
Nombre de pages : 92
Prix (frais de port inclus) : 21 €
Commander ou se renseigner à l’adresse ci-après :











