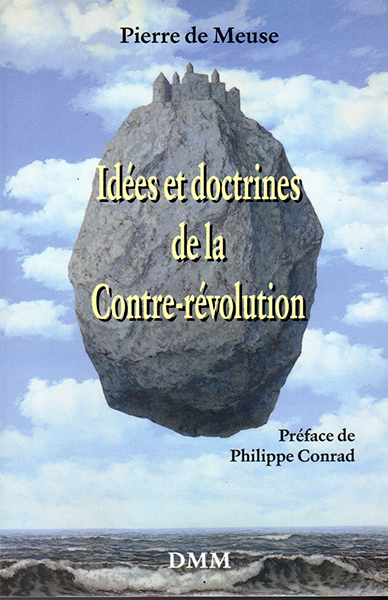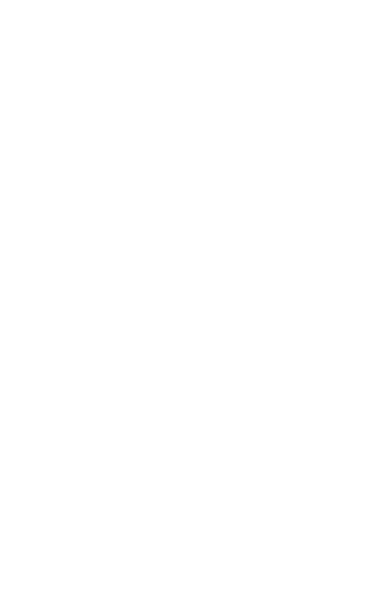« La question de savoir si une politique nataliste s’impose est futile : on ne se demande pas s’il faut se soigner quand on est malade. »
Par Pierre de Meuse.

Depuis quelques mois, une information se répète avec régularité dans nos médiats : la France connaît à son tour le déclin démographique. Après l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Hongrie, notre pays enregistre plus de décès que de naissances, malgré l’immigration. Il est vrai que la démographie est une science impitoyable, et que ses révélations ne peuvent que véhiculer l’angoisse, depuis la chute de Rome (1). Un pays dans cette situation, en effet, voit se profiler un destin sinistre : celui de la fin irrémédiable de son être, par étiolement et épuisement de sa vitalité. Un destin sans discussion aucune, que la science historique projette de la manière la plus crue. Lorsque la France était un grand peuple, elle bénéficiait d’une natalité dynamique, la plus élevée d’Europe, résumée de manière laconique par l’aphorisme du vieux Jean Bodin « Il n’y a de richesse que d’hommes. » (2)
Face à cette grave constatation, reconnaissons que les voix ne manquent pas pour souligner sa réalité. À la différence de nos voisins qui se taisent depuis des décennies sur ce sujet, nous en parlons, au-delà des différences d’opinion. Cela dit, là s’arrête notre satisfaction. Car les commentateurs se croient invariablement obligés de protester qu’ils n’en prônent pas pour autant une politique nataliste, considérée en soi comme un repoussoir. Certes notre Président a parlé en 2024 de « réarmement démographique », mais comme toujours, ce ne sont que des mots. D’ailleurs Macron n’a voulu envisager que des mesures techniques – la lutte contre l’infertilité – ou des mesurettes comme l’augmentation des places de crèche, d’ailleurs insignifiantes. Il nous paraît donc intéressant de voir quelles sont les composantes de cette anomalie logique, qui sont des constantes de la politique républicaine depuis un siècle à l’égard de la natalité. On peut en dénombrer trois, qui tiennent toutes à l’idéologie et au rapport entre la politique et la morale.
La première, archétypique, que nous désignerons sous le nom de surnaturalisme, est issue de la réflexion ascétique.
Elle regroupe en effet des esprits très différents : on la trouve aussi bien chez les démocrates-chrétiens que chez des spiritualistes athées et même chez des hommes favorables à une réaction salvatrice proches de nos idées. On peut la résumer ainsi : le fait d’engendrer sa descendance suppose un altruisme, un don de soi, un acte d’amour si élevé qu’il exclut tout calcul « matérialiste ». En conséquence, il serait illusoire, dans cette démarche, de penser que l’on puisse en quelque sorte l’acheter avec des avantages matériels. Une politique nataliste est donc taxée d’indécence plus encore que d’inefficacité. Or ce raisonnement d’origine janséniste ne tient pas compte de la réalité sociale. L’observation historique permet de discerner des périodes de dénatalité profonde, à des époques où n’existait pas de contraception chimique : le Haut Moyen-âge, le Japon de l’ère Tokugawa, l’Amérique australe post-colombienne, toutes étant des périodes d’incertitude culturelle profonde. De même, l’époque récente nous offre des exemples probants de tentatives réussies de politiques nataliste, notamment la relance démographique spectaculaire de l’Allemagne de l’est à la fin des années soixante-dix, un effort anéanti à partir de la réunification. Il est donc faux que les incitations matérielles soient inopérantes : elles sont seulement coûteuses, et supposent la mise en œuvre d’une volonté. Il est également inexact que la pauvreté soit un obstacle à la natalité : si des pays notoirement démunis comme l’Inde d’après-guerre ont longtemps conservé une natalité très élevée, c’est à la suite d’un calcul bien compréhensible, qui conduisait les parents à rechercher la solidarité des nouvelles générations pour donner des moyens d’existence aux vieillards devenus incapables de travailler à la fin de leur vie, et dépourvus de revenus. Une assurance retraite naturelle, en quelque sorte.
La seconde composante, empreinte d’une vénéneuse duplicité, est fondée sur l’indifférence à la chute, et même sur le désir de voir le déclin se poursuivre, par haine de l’héritage collectif.
Renaud Camus appelle cette famille d’ esprits « les amis du désastre », une désignation polémique, mais judicieuse. Il convient d’en faire une critique sans concession.
Selon cette vision des choses, il a fallu d’abord cacher les évolutions afin de les rendre irréversibles. Un démographe célèbre personnifie admirablement ce calcul : il s’agit d’Hervé Le Bras. Ce personnage s’est attaché depuis trente ans à nier le déclin de la natalité, prétendant seulement que celui-ci n’était pas une réalité actuelle, mais seulement un retard momentané apporté à enfanter, pouvant être facilement compensé par l’immigration temporaire. Et subitement, voici neuf ans (3), Le Bras jette bas le masque : il se déclare satisfait de la « créolisation » de la France, qu’il se refuse, pour des raisons de présentation persuasive, à dénommer le Grand remplacement », même si, en fait, c’est bien cela dont il se félicite en la nommant une « bonne nouvelle ». Il en est heureux parce qu’ainsi la France prend selon lui un visage universel. En disant cela, Le Bras justifie les propos de Pierre Manent reproduits opportunément par Je suis Français d’avant-hier : « Nous avons été amenés à considérer les mouvements migratoires comme le phénomène le plus significatif du monde actuel. En tant qu’incarnation concrète du mouvement vers une humanité unifiée, les migrants apparaissent comme les témoins et les agents de l’œuvre de justice par excellence. Ils représentent le passage du particulier au général, ou à l’« universel », comme nous préférons désormais le dire. » Inutile de souligner que Manent ne tombe pas dans le piège tendu à nos contemporains sur le sens de l’« universel », y compris à certains néo-maurrassiens qui confondent l’universel de la beauté et de l’ordre architectural et littéraire hérité de la Grèce antique avec le magma indifférencié des hommes déracinés. Bref, ce salut à la mort de nos héritages est une con,viction commune à toutes nos élites, et il n’a rien de surprenant. À la différence de la précédente, cette composante ne pèche pas par son inexactitude, mais par sa perversité : déterminée par le ressentiment, elle conduit clairement au suicide collectif, souhaité, salué, béni, considéré comme la prémisse d’une humanité libérée de ses « assignations ».
La troisième composante est d’une nature différente, quoiqu’elle aussi idéologique : c’est celle du capitalisme financiarisé.
Rejetant par principe la justice distributive selon Saint Thomas, ce système suppose que le marché se substitue totalement à l’ordre social. C’est pourquoi le renouvellement naturel des générations par la filiation y devient l’affaire exclusive des individus consommateurs. Si cela ne fonctionne plus, il suffit d’en importer comme des marchandises, et en aucune façon d’investir pour remplacer les générations. Et d’appliquer le principe habituel des financiers : mutualiser les charges mais privatiser les profits. C’est donc avec la plus totale légèreté que le patronat s’est empressé de raboter jusqu’à les détruire toutes les incitations à la natalité qui dataient des années 30-40 : réduction à peu de chose des quotients familiaux, suppression des parts supplémentaires, limitation des allocations à des aides aux indigents, selon le principe de Lord Beveridge. Cette évolution s’est bien accordée avec l’immense mouvement de transfert des revenus vers le capital au détriment des salaires, qui s’est opéré depuis soixante ans avec l’approbation tacite de la Gauche. Que l’on finance ainsi des populations de moins en moins travailleuses, de moins en moins responsables, et même de moins en moins héritières, au détriment des couches moyennes de la société importe peu à la nouvelle ingénierie sociale. L’immigration est devenue, selon l’expression de Marx à propos du travail des femmes, la nouvelle armée de réserve du Capital. Bien entendu la logique du marché ne raisonne qu’à court terme, et si des problèmes graves d’incompatibilité des peuples et des cultures surviennent, c’est alors aux pouvoirs publics qu’il incombe de s’en débrouiller. Comme si l’économie de l’échange était la seule science essentielle et le reste billevesées.
Le résultat ? Nous l’avons sous les yeux en ce domaine comme dans les autres. Il n’est pas nécessaire de disserter sur la fragilité désastreuse de nos sociétés, qui s’effondrent sous l’effet de poussées internes incontrôlées. Dès lors, la question de savoir si une politique nataliste s’impose est futile : on ne se demande pas s’il faut se soigner quand on est malade. Bien sûr, il serait à souhaiter que le renouvellement naturel des générations, nécessité vitale s’il en est, soit un processus spontané et non issu de la volonté. Comme le disait Thibon, un organe social sain se fonde le plus possible sur les mœurs, le moins possible sur des lois. Mais enfin nous ne pouvons nous soustraire à la réalité consternante à laquelle nous sommes confrontés. Par conséquent, puisque s’impose la nécessité de redresser la natalité, on ne peut qu’énumérer les principes indispensables pour la rendre efficace :
1. D’abord, fixer les objectifs de manière intransigeante. Le but irréductible est de redonner sa vitalité au peuple français. Il en résulte qu’une politique nataliste ne doit en rien se justifier par rapport à d’autres impératifs idéologiques comme l’égalitarisme ou le maintien de la « diversité ». Agir autrement, c’est l’affaiblir irrémédiablement comme l’ont fait depuis quarante ans nos gouvernants. Aucun panachage n’est possible car ce serait affaiblir notre objectif.
2. Elle ne doit nullement se limiter à des mesures financières et techniques, elle doit être aussi culturelle. Le but n’est pas de réformer les chiffres mais d’agir concrètement pour accroître la masse des Français réels, non les Français de papier. Cela suppose d’assouplir pour le moins le sacro-saint principe de non-discrimination. C’est un préalable sans lequel rien de solide ne peut être mis sur pied.
3. Elle doit recréer et ranimer les institutions favorables à l’accueil des enfants. Au premier rang desquels la famille. La conscience familiale est un socle qui doit être consolidé. Ne nous le cachons pas, l’éducation des enfants suppose des sacrifices. Ils ne pourront être faits que s’ils sont appréciés à leur juste valeur par la collectivité. Cela implique une revalorisation de la conscience nationale.
4. Elle doit privilégier la qualité et proposer des modèles. C’était le propos que nous tenait, au début des années soixante, à la Faculté de médecine de Marseille le regretté Alfred Sauvy, qui en avait fait l’œuvre de sa vie, et qui est injustement oublié aujourd’hui.
Il ne prétendait pas que ce fût une tâche facile : ses derniers mots furent ce jour-là « La France rebondira dans l’Histoire, mais quelle bataille ! »o ■ o PIERRE DE MEUSE
__________________________________
1. Selon Jean Michel Dufays, la chute démographique de l’Empire romain d’occident est constante à partir du 3ème siècle et s’accélère vertigineusement au 5ème.
2. « République ». La formule est à prendre au sens le plus concret, et c’est abusivement qu’on lui donne quelquefois un sens humanitaire
3. Le grand déménagement du monde. Répliques sur France culture 10 juin 2017
Derniers ouvrages parus