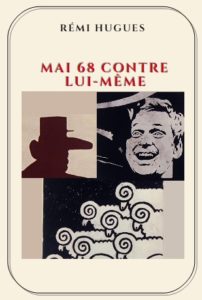PAR RÉMI HUGUES.
Article en 7 parties, publiées du lundi 27 février au dimanche 5 mars 2023. Étude ayant fait l’objet d’une conférence du Café d’actualité d’Aix-en-Provence qu’anime Antoine de Crémiers. (23.02.2023).
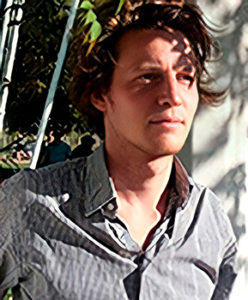
L’histoire nous enseigne que l’inflation amène nécessairement à la guerre. D’abord le pouvoir, confronté à des difficultés économiques, tombe dans cette solution de facilité qu’est la planche à billets. Mais vite cette voie, qui est « la facilité, l’illusion, le péril ajourné, la difficulté remise au lendemain »[1], comme l’écrit Pierre Gaxotte dans La Révolution française, produit ses effets négatifs.
Les prix s’envolent, ce qui sème la misère par la cherté des prix, et la ruine des entreprises par la raréfaction des achats. En ce moment deux secteurs sont particulièrement touchés : les boulangeries et le commerce de textile, avec notamment les faillites de Burton, Go Sport et San Marino, après celle de Camaïeu.
Cela provoque la colère de la population, le déclenchement de mouvements sociaux ou des désordres plus graves tels qu’un phénomène de violence généralisée. La situation dans le pays devient alors ingérable. Les gouvernements n’ont plus qu’une seule porte de sortie : la guerre.
C’est exactement ce qui se passa lors de la Révolution française, après le lancement des assignats en tant que monnaie-papier, qui visait à pallier la ruine totale de l’État.
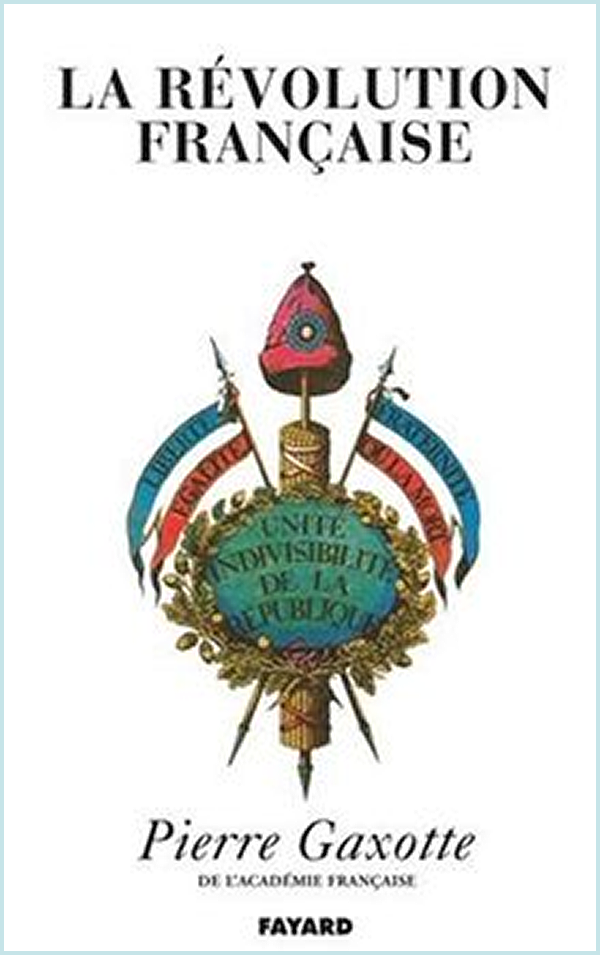 « Mais, décrit Pierre Gaxotte dans le même ouvrage, si les acteurs sont mauvais, la pièce est tragique. La première ivresse passée, l’inflation a commencé ses ravages. La vie est difficile ; les denrées sont rares et chères ; les troubles chassent la clientèle ; le commerce languit. Si les récoltes de 1789 et 1790 ont été bonnes, celles de 1791 est mauvaise. De Saint-Domingue en feu, les produits coloniaux n’arrivent plus. Le sucre manque »[2].
« Mais, décrit Pierre Gaxotte dans le même ouvrage, si les acteurs sont mauvais, la pièce est tragique. La première ivresse passée, l’inflation a commencé ses ravages. La vie est difficile ; les denrées sont rares et chères ; les troubles chassent la clientèle ; le commerce languit. Si les récoltes de 1789 et 1790 ont été bonnes, celles de 1791 est mauvaise. De Saint-Domingue en feu, les produits coloniaux n’arrivent plus. Le sucre manque »[2].
La France des assignats se trouva rapidement en situation de chaos généralisé : « Dès l’automne, on signale à nouveau un peu partout des épiceries assiégées, des convois attaqués, des marchés mis à sac. En février 1792, au dire du ministre de l’Intérieur, il ne se passe pas de jour qui n’apporte la nouvelle de quelque insurrection alarmante. Perquisitions armées dans les fermes, taxations arbitraires des blés, violations de domiciles, arrêt des transports, pillages des moulins et des greniers, d’un bout à l’autre du royaume, c’est une seconde épidémie de violences », après celle de 1789.
Et notre département ne fut pas à l’abri de ces graves tumultes, bien au contraire : « Dans les Bouches-du-Rhône, le mépris des lois est arrivé au dernier degré. La guerre civile sévit en permanence. De véritables expéditions villes contre villes, communes contre communes, s’y organisent chaque semaine. La garde nationale de Marseille se fait une fructueuse spécialité de ces razzias qui l’amènent successivement à Aubagne, à Auriol, à Eyguière, à Apt, à Arles surtout […]. Manosque et Digne sont visitées à leur tour. »[3]
Face à cet état chaotique dont la France est en proie, l’idée de réagir par la guerre ne manque pas de sourdre parmi la classe politique. C’est l’homme-lige du banquier Étienne Clavière, Jacques Pierre Brissot, appartenant au camp des Girondins devint « dans les clubs, dans la presse et à l’Assemblée, le prédicateur obstiné de la guerre qui vient. »[4]
Les Jacobins aussi se muent en partisans de la guerre. Dans une adresse ils la parent de toutes les vertus économiques : « Bientôt la confiance renaît dans l’empire, le crédit se rétablit, le change reprend son équilibre, nos assignats inondent l’Europe et intéressent ainsi nos voisins au succès de la Révolution. »[5]
 Conséquence de quoi le 20 avril 1792, pressé de toutes parts, Louis XVI, à l’Assemblée, propose de déclarer la guerre à Léopold II, empereur du Saint-Empire romain, roi de Hongrie et de Bohême. La France propose à Victor-Amédée III, roi du Piémont-Sardaigne, de s’unir face à l’Autriche et lui promet le Milanais, contre la Savoie. Mais il préfère rejoindre une coalition formée par le roi de Naples et le grand-duc de Toscane, ce qui a pour effet la conquête de Nice et de la Savoie par la France.
Conséquence de quoi le 20 avril 1792, pressé de toutes parts, Louis XVI, à l’Assemblée, propose de déclarer la guerre à Léopold II, empereur du Saint-Empire romain, roi de Hongrie et de Bohême. La France propose à Victor-Amédée III, roi du Piémont-Sardaigne, de s’unir face à l’Autriche et lui promet le Milanais, contre la Savoie. Mais il préfère rejoindre une coalition formée par le roi de Naples et le grand-duc de Toscane, ce qui a pour effet la conquête de Nice et de la Savoie par la France.
Dans un décret du 19 novembre 1792, la Convention lance un appel à la « fraternité et secours à tous les peuples qui voudront recouvrer leur liberté », ce qui consiste concrètement à chercher à annexer le Rhin, les Pyrénées et les Alpes.
En mars 1796 le général Bonaparte est nommé commandant de l’armée d’Italie. Et vite il devient le maître de la partie nord et centrale de la péninsule italienne. C’est en tant que « véritable pro-consul, dégagé de la surveillance des commissaires aux armées, qu’il a mené les négociations avec les vaincus. »[6]
L’analyse que fait Pierre Milza des débuts de l’ascension fulgurante de Napoléon Bonaparte souligne que le motif de la campagne d’Italie était financier : « À chacune de ces violations de leur autorité, les Directeurs ont fermé les yeux, peu désireux de voir cesser les envois massifs d’argent et d’œuvres d’art que le général victorieux tirait du pillage systématique des richesses de la Péninsule. »[7] ■ (À suivre).
[1]Paris, Arthème Fayard, 1928, p. 163.
[2]Ibid., p. 219-220.
[3]Ibid., p. 220.
[4]Ibid., p. 238.
[5]Cité par ibid., p. 239.
[6]Pierre Milza, Histoire de l’Italie. Des origines à nos jours, Paris, Librairie Arthème Fayard, 2005, p. 624.
[7]Ibid., p. 625.
À lire de Rémi Hugues Mai 68 contre lui-même (Cliquer sur l’image)
© JSF – Peut être repris à condition de citer la source