
De nos jours, les partis protestataires se sont envolés : on les assigne à l’enfer du populisme. Le cercle de la raison ne se laisse pas intimider par les « sentiments » populaires du déclassement, de l’insécurité, de l’appauvrissement monétaire, de la dépossession culturelle, etc.
Par Pierre Vermeren.

Cette tribune est parue dans Le Figaro de ce matin (14 octobre). Nous n’y ajouterons pas de commentaire superflu. Voilà un article qui n’a, nous semble-t-il, rien d’un aimable bavardage. Nous nous sommes plaints, en effet, que la presse, les médias et les responsables politiques n’aient produit quasiment aucune réflexion, aucun texte d’une certaine ampleur, à la mesure de la gravité de la situation. En voici un, assurément. Et important. Signé de Pierre Vermeren. Et il paraît dans Le Figaro, où – il faut bien le noter – l’on ne trouve pas que de mauvaises lectures… JSF
TRIBUNE – L’esprit de suffisance et l’aveuglement de nos dirigeants, qui refusent aussi bien de prendre en compte les réalités économiques et culturelles que de faire appel au peuple, rappellent notamment la crise qui a fini par emporter l’Ancien Régime sous Louis XVI, analyse l’historien.
* Normalien, agrégé et docteur en histoire, professeur d’histoire des sociétés arabes et berbères contemporaines à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Pierre Vermeren est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages remarqués. Il est notamment coauteur d’une Histoire du Moyen-Orient de l’Empire ottoman à nos jours (Éditions de la Sorbonne, 2016).

Crise politique ou crise de régime, agonie du macronisme, épuisement de la Ve République ou fin du cycle politique commencé en 1981, quelle que soit la manière dont on appréhende la crise en cours de la République française, celle-ci offre le spectacle de l’étrange auto-aveuglement des élites dirigeant la France, suivies par une frange restreinte de l’électorat. La chose n’est pas inédite au pays des quatorze constitutions, quand les Britanniques n’en ont jamais eu. Depuis la crise finale de l’Ancien Régime sous Louis XVI (1775-1793), soit durant les deux cent cinquante dernières années, la France se caractérise par une série de cycles politiques ou générationnels plus ou moins longs, qui se terminent parfois en tragédie, mais toujours brutalement, du fait de l’incapacité des élites nationales à rectifier le tir avant le naufrage, le coup d’État ou l’effondrement final.Publicité
Empires et Républiques sont-ils rattrapés par le syndrome indépassable de l’impasse financière et politique qui a emporté l’Ancien Régime ? La chose est possible. Elle singularise la France par rapport à ses voisins. Mais comme il n’y a ni fatalité ni sens de l’histoire, il faut s’interroger sur les acteurs et les groupes dirigeants, qui sombrent tour à tour dans une forme d’hubris, mâtinée de certitudes et de pensées fausses, en vertu desquelles ils pensent avoir raison envers et contre tous, jusqu’à ce que le réel finisse par les chasser du pouvoir.
Louis XVI, Napoléon Ier, Charles X, Louis-Philippe, Napoléon III, la IIIe République en 1940, puis la IVe face à l’Algérie, en attendant la crise actuelle de la Ve République, la plupart de nos régimes ont connu une issue dramatique. Si les IIIe et Ve Républiques se distinguent par leur stabilité et par leur longévité (plus de soixante-dix ans chacune), elles ont toutefois connu un électrochoc à leur mitan : la guerre de 1914 dans le premier cas, l’alternance de 1981 dans le second, qui ont précipité la relève d’une génération épuisée.
La relève des radicaux républicains d’avant-1914 s’est opérée dans les conditions dramatiques de la Grande Guerre. Celle des sociaux-libéraux post-gaullistes par les socialistes de François Mitterrand a été vécue comme un tournant sans retour. De fait, « l’alternance » de 1981 a amorcé jusqu’à nos jours une déconstruction, pierre par pierre, de l’édifice bâti lors du premier siècle républicain (1879-1981) : l’école de l’excellence, l’armée de conscription, les services publics, la sûreté publique, l’économie de production, l’équilibre budgétaire et même l’acquis révolutionnaire de la souveraineté politique et économique du peuple français.
Le général de Gaulle est l’un des seuls chefs d’État qui ont su quitter le pouvoir par un acte volontaire (par deux fois : 1946 et 1969), évitant sa propre déréliction. Nul doute que l’immense prestige qu’il en a retiré vient de cette rare forme de sagesse… Il reste l’exception en la matière, quand tous veulent durer, quoiqu’il leur en coûte.
Depuis la présidentielle de 2002, nous vivons une crise politique inédite par sa durée, désormais proche de trouver son dénouement
Notre vie politique est donc hachée par des séquences d’une ou deux générations, à l’issue souvent brutale, voire dramatique. Qu’on en juge : la Terreur de 1793 pour abattre la monarchie ; la double invasion de la France en 1814 et 1815 pour tuer l’Empire ; la révolution de 1830 pour chasser les Bourbons ; les deux Révolutions de 1848 et leur violente répression pour chasser les Orléans ; Sedan en 1870 pour liquider le second Empire, suivi par la deuxième invasion de la France et la Commune ; la guerre de 1914 qui clôt dramatiquement le règne des radicaux ; l’effondrement de 1940 pour engloutir la République au risque de faire disparaître le pays (avec une troisième invasion) ; la guerre d’Algérie pour emporter la IVe République et briser l’utopie coloniale. Et pour finir, la séquence révolutionnaire douce de 1968-1981 qui a porté les gauches sur le pavois en 1981. Depuis la présidentielle de 2002 (qui a porté contre toute attente Jean-Marie Le Pen au second tour), nous vivons une crise politique inédite par sa durée, désormais proche de trouver son dénouement. Une génération durant, seule une série de leurres a permis de repousser l’inéluctabilité de la chute du « cercle de la raison » (Alain Minc).
Les analystes décrivent une France irréformable, dont le peuple manifeste par intermittence sa fureur politique et constitutionnaliste, et où ses élites politiques sont incapables de passer des compromis – et plus encore de reconnaître la moindre erreur de cap ou d’orientation. De sorte que la résolution des crises ne se réalise que dans le drame : l’invasion et l’effondrement, la révolution et la fin du régime, la banqueroute, la guerre ou l’insurrection, le coup d’État, la guerre civile ou quelques massacres soutenus (Terreur, Vendée, 1848, Commune, épuration, guerre d’Algérie). Ces épisodes, souvent dramatiques, ont émergé et se sont développés dans des conditions et selon des conjonctures très différentes. Mais ils disent que la sortie de nos conflits est tout sauf orchestrée, pacifique et intelligente : elle est subie, brutale, souvent sanglante, ce qui n’étonnera que les amnésiques au pays de la Révolution.
L’archipel français est une société multiconflictuelle que la gouvernance des élites politiques attise plus qu’elle ne la contient
Les voies de résolution de l’actuelle crise demeurent inconnues. La mise en place d’une sévère crise financière, voire d’une crise systémique de l’euro, n’est pas à exclure, non plus qu’une banqueroute plus ou moins solvable dans une purge financière de moins en moins évitable. Redoutons qu’un brutal changement de majorité politique au Parlement ou à l’Élysée ne se paye par des violences politiques ou sociales, dont les dernières années ont offert des préfigurations : attentats, émeutes urbaines, manifestations violentes, montée de l’insécurité et des règlements de comptes… Un violent conflit de répartition est possible entre les clientèles de l’État nourricier, quand s’imposeront sous la contrainte la réduction des dépenses de 150 milliards d’euros et la réaffectation d’une centaine au profit du régalien. Déjà, des boucs émissaires sont désignés : immigrés, Juifs, riches… D’autres ne sauraient être exclus : retraités boomeurs, fonctionnaires, catholiques, patrons, paysans… L’archipel français est une société multiconflictuelle que la gouvernance des élites politiques attise plus qu’elle ne la contient.
Pourquoi les élites dirigeantes de la France s’enferment-elles dans des certitudes qui se muent en impasses ? Pourquoi tiennent-elles un cap contre vents et marées, même quand il conduit au désastre ? Pourquoi refusent-elles de reconnaître la moindre erreur, au risque de préférer une violente sortie de l’histoire, quand l’inéluctable a sonné ? Qui sont ces chefs politiques qui se murent au fil des ans dans des certitudes qui causent leur perte ?
Nos dirigeants ont une incontestable prétention littéraire et intellectuelle, quoi qu’étant rarement d’esprit scientifique – ainsi tel brillant ministre de l’Agriculture ignore ce qu’est un hectare, et s’en fiche. Leur expérience professionnelle de terrain est rarement leur apanage, car la politique est leur métier. Rares sont les Clemenceau, qui fut médecin, ou les de Gaulle, officier d’active durant deux guerres mondiales. La plupart de nos dirigeants refusent, quoi qu’ils en disent, les contraintes de l’économie et de la comptabilité nationale, dans la droite ligne de l’Ancien Régime, agonisant du poids de ses dettes. « L’intendance suivra », disait Napoléon jusqu’à Moscou… La citation est reprise par de Gaulle, pourtant loin de négliger les finances. Après Raymond Barre, nos dirigeants ont fait leur cette maxime : depuis l’euro, ils ont adopté le fantasme des années 1920 « l’Allemagne paiera ». Mais si nous pouvons nous endetter grâce à ce pays, ce sont bien les Français qui ont, et qui vont payer !
Ces dirigeants sont en effet enfermés dans des systèmes idéologiques qui les portent à l’abstraction plus qu’au pragmatisme. Ainsi, la destruction méthodique de notre économie de producteurs – fruit de deux cents ans de labeur collectif –, a été le prix à payer pour édifier la monnaie commune, l’Euro – au seul profit de l’Europe germanique. Or non seulement nous refusons de le reconnaître, mais le pays est saisi d’une hubris financière et consumériste qui pourrait emporter l’édifice européen – du moins l’Europe du Sud dont nous sommes. « Tout va très bien Madame la marquise » (1935), « qu’est-ce qu’on attend pour être heureux, qu’est-ce qu’on attend pour faire la fête ? » (1938) chantait-on derrière la ligne Maginot à quelques mois de la plus grande défaite militaire de notre histoire…
La plupart des étrangers soulignent l’arrogance de nos dirigeants, voire le mépris qu’ils affichent. Bien sûr, le considérable affaiblissement de notre pays a réduit l’impact de ce trait national, le rendant même risible, car la superbe est un apanage de la puissance. Or nous ne faisons plus peur. Ainsi, le président Macron, bien qu’animé des meilleures intentions envers l’Afrique, s’est brouillé avec la plupart de ses dirigeants, qui préfèrent désormais Chinois, Russes et émirs du Golfe, dont les arguments semblent plus efficients que les nôtres.
Notre esprit de suffisance nous aveugle. Convaincus de la supériorité de nos anticipations et de nos visions, il nous éloigne des réalités objectivables
Notre esprit de suffisance nous aveugle. Convaincus de la supériorité de nos anticipations et de nos visions, il nous éloigne des réalités objectivables. Comment s’imposer sur la scène internationale par la voix de la raison et de la diplomatie – même la mieux intentionnée et la plus intelligente du monde –, face à des adversaires brutaux et sans scrupule, s’ils savent que nous sommes désargentés, que nous peinons – faute d’autorité – à mettre de l’ordre dans nos affaires, que notre outil de défense manque de munitions, que notre dépendance productive ne cesse de s’accroître, que nos déficits sont sans remède, et nos frontières ouvertes ? « Nous gagnerons parce que nous sommes les plus forts », disait notre ministre des Finances, Paul Reynaud, à l’automne 1939. Pourquoi pas en effet ?
Face au si controversé domaine migratoire, nos dirigeants prêchent en faveur de l’immigration de travailleurs. Ils se croient dans les années 1960. Ils savent pourtant que la croissance est devenue anémique, que l’immigration ne la stimule pas (sinon elle serait forte !), que la France recèle 6 millions d’inactifs déclarés – non comptés les autres –, que d’après l’Insee, les immigrés sont deux fois plus touchés par l’inactivité, et qu’au demeurant, moins d’un immigré sur huit vient en France pour travailler. Or ces réalités sociales et économiques n’ont aucun effet sur le langage politique, ses impensés et sa doxa. Pour nos dirigeants, les idées et les représentations l’emportent sur les réalités, quand bien même elles taraudent leurs électeurs.
Ne croyant en rien, si ce n’est en leur bonne étoile et en leur réussite personnelle, ils sont peu sensibles à l’introspection, moins encore au discernement. Ils sont peu attentifs aux autres et « à ceux qui ne sont rien », mais leur appétence est grande pour les modèles et les prophéties autoréalisatrices : hier, l’Algérie « était la France », quoiqu’on n’y applique pas ses principes – la catastrophe finale était inéluctable ; l’Europe que nous avons inventée, devait ligoter l’Allemagne à nos intérêts – ce fut l’inverse – ; l’euro allait porter la croissance de notre économie ; la désindustrialisation permettrait de ne garder en France que les fonctions de commandement à haute valeur ajoutée ; le libre-échange sans contrepartie profiterait à notre économie ; l’immigration serait une chance inconditionnelle pour notre pays ; l’école et l’hôpital français sont les meilleurs du monde ; l’endettement public est la croissance de demain, de sorte que la dette serait indolore… Pourtant, tout cela a conduit le pays dans une triple impasse productive, financière et culturelle. Et désormais politique.
Mais nos dirigeants refusent de s’être trompés. Pourraient-ils reconnaître qu’une bonne chose peut, à long terme, se transformer en catastrophe, parfois même en une impasse mortifère ? D’autant plus que les statistiques et les prévisions qu’ils affectionnent s’avèrent souvent menteuses (Churchill) et trompeuses. La dissonance cognitive, dès lors qu’elle devient collective, éloigne de la réalité, et forge un monde parallèle qui se décline suivant des mots d’ordre volontaristes : le niveau scolaire monte, la croissance se renforce, le chômage baisse, le monde nous envie, la délinquance régresse, la réindustrialisation est en marche… Autant de formules battues en brèche.
C’est l’un des traits les plus saillants des élites françaises : leur constante méfiance envers un peuple tenu en suspicion de radicalisme et d’extrémisme
Quelle est notre démocratie ? Suffrage universel, retour au peuple, référendum ne peuvent être que redoutés, car ils déchireraient le voile des illusions. De Gaulle n’en a jamais eu peur, ce qui est la raison du souvenir tenace qu’il imprime. De nos jours, les partis protestataires se sont envolés : on les assigne à l’enfer du populisme. Le cercle de la raison ne se laisse pas intimider par les « sentiments » populaires du déclassement, de l’insécurité, de l’appauvrissement monétaire, de la dépossession culturelle, etc. Il renvoie le peuple à ses « émotions », à son inconstance, à ses radicalités, à sa perception tronquée des réalités sociales et économiques, à son ignorance… C’est l’un des traits les plus saillants des élites françaises : leur constante méfiance envers un peuple tenu en suspicion de radicalisme et d’extrémisme. Un extrémisme que l’on hait plus que tout au monde depuis la Terreur, à juste titre. Mais un extrémisme de l’exaspération que l’on fait monter avec des efforts si constants et si déterminés, qu’on se demande s’il n’est pas un désir refoulé ? ■ PIERRE VERMEREN
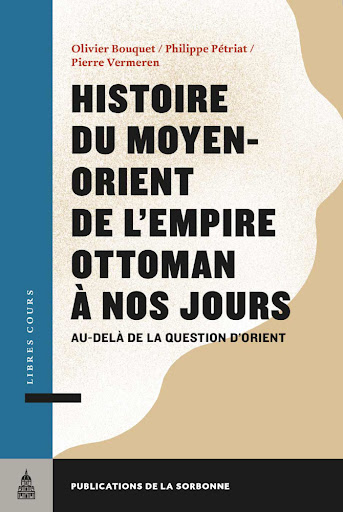












Helas!
Loin d’un bavardage lénifiant, en effet, ce texte sonne comme la confirmation d’un cancer mortel métastasé.
Nos élites préféreraient la théorie à la pratique. Pourquoi pas ? Mais si la théorie est fausse ? Alors arrogance et intellectualisme dévoyé reforment le couple diabolique de l’erreur et de la persévérance.
C’est manifeste dans le domaine économique. De fausses conceptions ont étouffé, chez nos énarques-perroquets, toute rationalité et, accessoirement, toute morale. Corroborant le propos de M. Vermeren je rappelle ce qui nous a été seriné depuis des décennies : l’avenir est dans les services, le fameux secteur tertiaire.
J’ajouterais au tableau clinique du peuple français proposé par cet article l’idée suivante : Le culte fanatique rendu aux » droits acquis » au détriment de tout esprit d’aventure et de responsabilité. Ce culte peut se justifier pour les plus modestes, un droit à la dignité, un droit d’échapper à la déchéance après une erreur ou un coup du sort. Il est bien autre chose pour ces hauts dirigeants dont la responsabilité pour un échec ne peut être recherchée que dans le cadre d’une promotion. Certains noms viennent à l’esprit, banquiers, littérateurs ou mathématiciens égarés en politique…
Exemple : la débacle d’Orpea devenu(e) Émeis. Le Tesla ou le Nvidia du troisième age ?
En dix ans l’action a perdu 99,97 % de sa valeur. C’était pourtant un magnifique investissement dans les « services » : Numéro 1 européen de la prise en charge globale de la dépendance avec près de 94 000 lits et 1031 établissements, créé en 1989 ;
– Chiffre d’affaires de 5,2 Mds€, réparti entre la France-Benelux pour 58 %, l’Europe centrale pour 26 %, l’Europe de l’est pour 10 %, la péninsule ibérique et l’Amérique latine (Brésil, Chili et Uruguay) pour 5,5 % puis la Chine et les Emirats arabes unis ;
Selon AOF, » un modèle de création de valeur fondé sur la sélectivité à l’international, la diminution de la détention des actifs immobiliers, le redressement de la situation financière et l’amélioration des conditions de travail débouchant sur une meilleure prise en compte des besoins des résidents ou malades. »
Un développement rendu possible, cela va sans dire, par un apport important de main d’œuvre immigrée (mon clavier allait écrire manœuvres).
Un mystérieux chevalier d’industrie pilotait-il cette opération ? Que nenni : son capital est contrôlé à 50,2 % par 4 actionnaires agissant de concert : la Caisse des dépôts pour 22,4 %, la Mutuelle des instituteurs de France pour 14,8 %, la MACSF pour 7,4 % et CNP Assurances pour 5,6 % ; Que du beau monde sur-diplomé en théorie économique et, malheureusement, ignorant du reste. Quand au 49,8 % du capital, le peuple tant méprisé avait été généreusement admis à y faire fondre ses économies. Après Eurotunnel, Natexis, Atos, etc