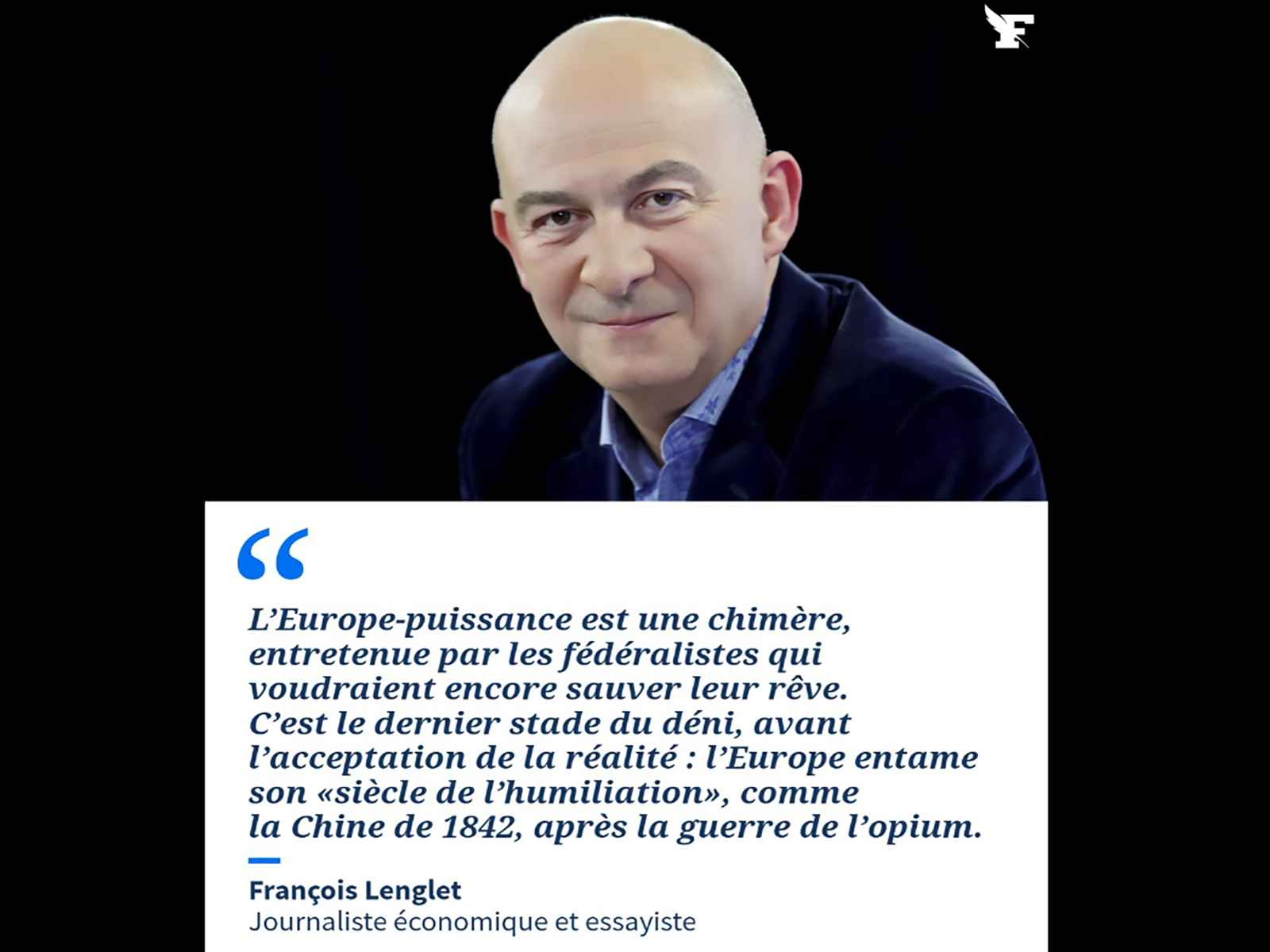
Il est temps que l’Europe abandonne l’illusion post-nationale pour reconnaître que nous sommes dans un monde de confrontation. Les armées, les frontières et la souveraineté sont redevenues des priorités. Elle doit aligner ses politiques industrielles sur ces réalités géopolitiques et cesser de se saboter par des réglementations contre-productives.
Entretien par Ronan Planchon.

COMMENTAIRE – Le Figaro a publié le 3 octobre cet entretien avec François Lenglet, entretien dont les turbulences de l’actualité, écume des choses plus que réel profond, nous ont fait décaler la reprise dans ces colonnes jusqu’à aujourd’hui. François Lenglet, nous l’avons déjà dit, se définit comme journaliste économique et essayiste — qui plus est, il l’est au sein des grands médias, et il aligne les succès de librairie. Ses analyses sont intéressantes à ce titre : elles reflètent et amplifient un état de l’opinion, ainsi que ses évolutions, en parallèle avec les transformations et les permanences du monde — nécessairement liées. Comment l’U.E. y est-elle perçue aujourd’hui ? Quel avenir lui accorde-t-on désormais ? L’Europe réelle doit abandonner l’illusion post-nationale, et ses politiques — fussent-elles autant que possible harmonisées — seront nécessairement plurielles, c’est-à-dire nationales. Quid, aussi, de l’idéologie du primat de l’économie — surtout du commerce, d’ailleurs — et du prétendu retour du politique, comme s’il avait jamais cessé, en réalité, d’être présent derrière les ambitions des marchands et des financiers ? Les questions sont posées. On peut en débattre. ooJSF
ENTRETIEN – La paralysie politique et les difficultés à faire adopter un budget sont en décalage complet avec le combat pour le leadership mondial qui se joue entre la Chine et les États-Unis, dont la France semble être spectatrice, analyse le journaliste économique* dans son nouveau livre.
François Lenglet est éditorialiste économique à TF1-LCI et RTL. Son prochain livre : Qui sera le prochain maître du monde ?, Éditions Plon, octobre 2025.

LE FIGARO. – Pendant que les États-Unis et la Chine se battent pour être les « maîtres du monde » selon vous, la France ne semble même pas capable de faire adopter un budget. Sommes-nous condamnés au déclin ?
François LENGLET. – La France est dans une situation paradoxale où elle se concentre sur des problématiques intérieures et des solutions saugrenues, comme la taxe Zucman, alors que le monde connaît des transformations majeures. Ce décalage reflète une incapacité à s’aligner sur les véritables enjeux globaux. Nous sommes à contretemps, absorbés par nos querelles internes, tandis que le combat pour le leadership mondial se joue ailleurs, notamment entre la Chine et les États-Unis. Ce n’est pas la première fois que la France se trouve dans cette posture. À la veille de 1939, elle était déjà affaiblie économiquement, paralysée politiquement et dominée par des questions sociales, comme sous le Front populaire. En 1937, l’Exposition universelle, comparable aux JO de 2024, masquait des grèves et une incapacité à agir sur les véritables problèmes. Aujourd’hui, nous reproduisons ce schéma, avec une paralysie politique. Sans doute les dirigeants politiques capables de nous sortir du trou sont-ils déjà là, mais ils ne parviennent pas à s’exprimer dans ce maelström. Comme dans l’entre-deux-guerres, où de Gaulle était considéré comme un personnage secondaire, et Churchill un homme du passé, alors qu’ils sont devenus les sauveurs du monde libre.
À un moment où la France aurait besoin d’investir massivement et de réfléchir à sa place dans le monde, elle se trouve affaiblie politiquement et budgétairement. La dissolution récente a torpillé tout espoir d’ajustement budgétaire significatif. De plus, certaines initiatives, comme la reconnaissance de la Palestine, semblent déconnectées des priorités stratégiques et relèvent d’une forme d’inconscience face à l’état réel du pays. Le président reste inflexible sur ses choix, poursuivant des initiatives parfois baroques dans un contexte de cacophonie mondiale. Pourtant, l’histoire montre que la France a su se relever de périodes similaires. Faut-il que nous fassions l’expérience de crises majeures, comme des guerres, pour y parvenir ? Aujourd’hui, nous semblons moins aguerris, moins préparés à affronter les chocs de l’existence.
De toute façon, le nouveau budget réglera-t-il quelque chose ?
Au mieux, l’adoption d’un budget permettra à la machine administrative et étatique de fonctionner à peu près normalement. Mais les espoirs raisonnables s’arrêtent là. La dissolution a tué dans l’œuf tout projet d’ajustement budgétaire sérieux. Tant que l’actuel président restera en place ou qu’une crise majeure ne nous y contraindra pas, il n’y aura pas de réformes structurelles. Ces réformes, notamment sur le modèle social – santé, retraites, équilibre entre risque individuel et collectivisé -, sont indispensables mais ne verront pas le jour avant l’élection présidentielle de 2027. Même alors, rien ne garantit une résolution, car le paysage politique est, on le sait, fragmenté en trois blocs.
Aujourd’hui, la géopolitique reprend le dessus. Les entreprises, même les géants comme les Gafam, doivent se soumettre au pouvoir politique. On le voit avec Zuckerberg, qui s’aligne sur Trump, ou Musk, qui risque de payer cher sa rébellion
La France est prisonnière d’une spirale vicieuse. Notre base productive se dégrade, ce qui limite notre capacité à répondre à la demande intérieure. L’investissement ne représente plus une part significative de la croissance, qui repose désormais sur la consommation. Pour stimuler cette consommation, il faudrait augmenter les salaires, mais sans gains de productivité – en raison de l’état de notre tissu industriel -, cela nécessite des transferts de revenus financés par le déficit. Nous nous endettons donc pour maintenir la consommation, mais comme l’offre française est défaillante, cette demande profite aux industries étrangères, notamment chinoises et allemandes. Ce double déficit – budgétaire et commercial – est une malédiction française ancienne, mais elle a atteint des niveaux records. Par exemple, notre agriculture, qui affichait le deuxième excédent commercial mondial il y a trente ans, est aujourd’hui déficitaire, même en tenant compte des vins et spiritueux. Ce mécanisme alimente les usines étrangères tout en creusant nos déficits.
Vous décrivez un monde marqué par le retour des frontières, des velléités expansionnistes et de la compétition pour la domination mondiale. Ce changement d’ère n’est-il pas qu’un retour à la normale ?
Nous sortons d’une parenthèse historique, celle de la domination sans partage des États-Unis après 1989. Cette période, marquée par une mondialisation sans entraves et un faible risque géopolitique, a permis à l’économie d’imposer sa logique. Aujourd’hui, nous revenons à un monde plus classique, celui de la confrontation entre grandes puissances – États-Unis, Chine, Russie et les autres – où l’économie doit s’adapter aux tensions géopolitiques. Ce n’est pas une anomalie, mais un retour à la norme historique. La parenthèse de mondialisation, nous en avions déjà connu de similaires dans l’histoire : à la fin du XVe siècle sous la domination ibérique, au XIXe siècle sous l’hégémonie britannique, ou encore entre 1989 et 2019.
Chaque fois, une puissance dominante aplatit le risque géopolitique, favorisant la mondialisation des échanges, des capitaux et des migrations. Aujourd’hui, la géopolitique reprend le dessus. Les entreprises, même les géants comme les Gafam doivent se soumettre au pouvoir politique. On le voit avec Zuckerberg, qui s’aligne sur Trump, ou Musk, qui risque de payer cher sa rébellion. Les oligarques n’ont que deux options : la soumission ou la marginalisation. L’Europe est à la traîne, car elle persiste à croire que la mondialisation heureuse reviendra. Les armées, les frontières et la souveraineté redeviennent des priorités, mais l’Europe tarde à le comprendre. Elle dispose pourtant d’un levier : son marché intérieur et son potentiel technologique. Mais pour en tirer parti, elle doit aligner ses politiques industrielles et cesser de se saboter avec des réglementations bureaucratiques.
La Chine produit désormais à elle seule plus que toutes les industries du monde, écrivez-vous, mais elle semble tergiverser…
La Chine est à un tournant. Son modèle économique, centré sur l’exportation et la répression de la consommation intérieure, bute sur une demande mondiale qui s’essouffle. Ses coûts de production augmentent, et les frictions commerciales, comme les droits de douane imposés par les États-Unis et, plus timidement, par l’Europe, compliquent ses exportations. Comme la France subventionne sa consommation par l’endettement, la Chine subventionne ses investissements via les provinces, notamment en rendant ses entreprises surcompétitives à l’export grâce à des aides sur l’électricité. Mais ce modèle est intenable à long terme, car la logique économique se venge par des barrières douanières croissantes.
La Chine ne cherche pas à conquérir le monde, mais à ne plus subir la loi des autres, notamment des Américains. Cela pourrait mener à des confrontations, mais pas à une domination globale
Un autre verrou est le taux de change. Historiquement, les pays en forte croissance, comme le Japon ou la Corée, ont vu leur monnaie s’apprécier en raison de la demande extérieure, ce qui a fait croître les revenus et stimulé la consommation intérieure. La Chine, en contrôlant son taux de change via sa banque centrale, empêche cette appréciation pour préserver ses excédents commerciaux. Cela maintient les revenus des Chinois à un niveau faible, limitant la consommation intérieure, qui représente moins des deux tiers de l’économie, contrairement à un pays développé. Cette contradiction crée une impasse économique. Sur le plan démographique, la Chine fait face à un défi majeur. Son essor économique des années 1980 reposait sur une population active massive, issue des cohortes nées sous Mao. Ces travailleurs partent aujourd’hui à la retraite, et la Chine s’apprête à vivre une contraction démographique brutale, l’inverse de son décollage il y a quarante ans. Ajoutons à cela un leadership moins brillant que sous Deng Xiaoping, avec des erreurs comme la politique du « zéro Covid » ou des campagnes anticorruption maladroites. Xi Jinping n’a pas les mêmes qualités de gestion que ses prédécesseurs.
En somme, l’empire du Milieu cherche-t-il vraiment à prendre le leadership mondial ?
Je ne crois pas que la Chine aspire à devenir le « maître du monde » au sens occidental, c’est-à-dire à dominer par une projection militaire globale, une monnaie mondiale ou le contrôle des institutions internationales. La Chine se voit comme l’empire du Milieu, convaincue de sa supériorité intrinsèque, sans besoin de conquêtes territoriales. Son objectif est de sécuriser son environnement – la mer de Chine, Taïwan, les routes de la soie – et ses approvisionnements en matières premières. Une anecdote révélatrice : au XVe siècle, l’amiral Zheng He, après avoir exploré le monde, a conclu que les « barbares » n’avaient rien à offrir. Cette mentalité perdure : la Chine ne cherche pas à conquérir le monde, mais à ne plus subir la loi des autres, notamment des Américains. Cela pourrait mener à des confrontations, mais pas à une domination globale.
Vous consacrez un chapitre aux errances de l’industrie automobile européenne. En quoi ce secteur est-il symptomatique de notre incapacité à sortir d’une vision post-nationale ?
L’automobile est emblématique des erreurs européennes. Trois facteurs expliquent sa crise. Premièrement, la Commission européenne joue contre les États, imposant des réglementations qui affaiblissent les industries nationales plutôt que de les soutenir. À l’origine, l’idée était noble : moderniser les pays en les forçant à dépasser leurs particularismes. Cela a fonctionné pour la France dans le passé, mais aujourd’hui, dans un monde de confrontation géopolitique, c’est dramatique. La Commission doit être aux côtés des États, pas contre eux.
Deuxièmement, une bureaucratie excessive impose des objectifs irréalistes, comme l’interdiction des moteurs thermiques en 2035, au lieu d’adopter une neutralité technologique qui laisserait place à des solutions comme les carburants verts ou des moteurs plus efficaces. Cette approche bureaucratique pense avoir raison contre les industriels, ce qui est une erreur.
Il y a quarante ans, nous protégions nos technologies des exigences chinoises ; aujourd’hui, c’est nous qui sollicitons leur expertise, y compris, demain peut-être, pour des projets comme les réacteurs EPR
Troisièmement, l’idéologie verte, portée notamment par les Verts allemands, sacrifie l’industrie au nom d’un impératif climatique mal calibré. À l’époque de la crise des euromissiles dans les années 1980, la gauche allemande disait « plutôt rouge que mort ». Aujourd’hui, la Commission semble dire « plutôt vert quitte à être mort », préférant zéro émission à tout prix, même au détriment du premier secteur industriel européen. Résultat : des usines ferment, comme possiblement à Poissy, au chômage technique, et des milliers d’emplois sont supprimés chez Ford (5000) ou Bosch (13.000). Les surcapacités, conjuguées à des coûts élevés, fragilisent les constructeurs européens, qui ont leur part de responsabilité en produisant des véhicules trop chers. Pendant ce temps, la Chine domine la production de batteries, un domaine où l’Europe s’est laissée distancer. Il y a quarante ans, nous protégions nos technologies des exigences chinoises ; aujourd’hui, c’est nous qui sollicitons leur expertise, y compris, demain peut-être, pour des projets comme les réacteurs EPR. L’automobile, qui représentait une barrière à l’entrée pour les Allemands, risque de devenir marginale. Ce secteur, qui pèse environ 10 % de l’emploi avec les sous-traitants, subit un choc terrible, et certains acteurs ne s’en relèveront pas.
Il est temps que l’Europe abandonne l’illusion post-nationale pour reconnaître que nous sommes dans un monde de confrontation. Les armées, les frontières et la souveraineté sont redevenues des priorités. Elle doit aligner ses politiques industrielles sur ces réalités géopolitiques et cesser de se saboter par des réglementations contre-productives. L’Europe dispose d’un atout majeur : son marché intérieur, qui reste attractif pour les géants technologiques, notamment face à une Chine qui développe ses propres champions et impose des barrières technologiques. Mais pour tirer parti de cet avantage, l’Europe doit investir dans ses industries stratégiques et accepter que l’économie est subordonnée à la géopolitique. Sans cette prise de conscience, elle risque de rester marginalisée dans un monde où la Chine, les États-Unis et d’autres puissances redéfinissent les rapports de force. ■
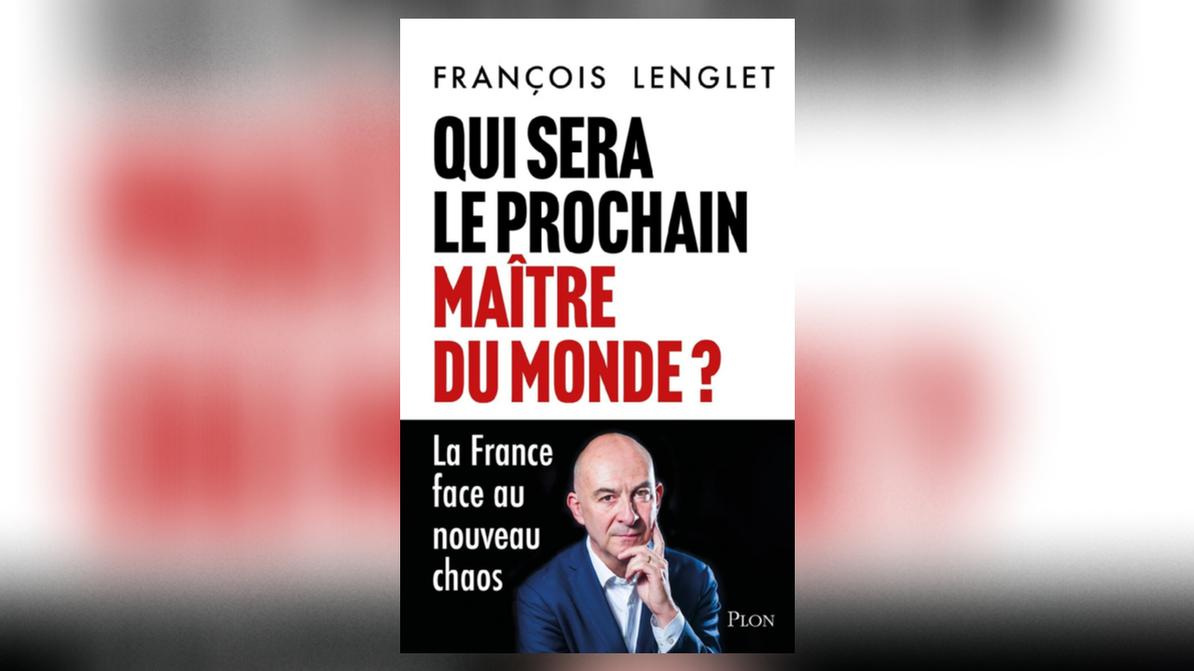
Qui sera le prochain maître du monde ? par François Lenglet. Plon












En France nous aurons « la chance » offerte par le dérèglement climatique, nous pourrons planter des bananiers, donc nous aurons les qualités requises pour être ……..une République bananière
à moins que les Français se réveillent et demandent le retour …. du ROI et de leurs libertés réelles