
« Élever des enfants, avec tout ce que le verbe « élever » comporte, est une entreprise de grande envergure. Depuis ses origines jusqu’à une date récente, les hommes ont vécu au sein de communautés, qui sont le cadre naturel à l’accueil des enfants. «
Entretien Par Eugénie Boilait.
Cet entretien paraît aujourd’hui dans Le Figaro et venant d’Olivier Rey nous en savons d’avance l’importance. C’est évidemment une pensée de la Tradition qu’il y développe. Faute d’y revenir vraiment, quelles que puissent être la vigueur et même la violence des réactions qui pourraient se dresser comme on le voit à nombre de signes, contre la modernité finissante, il n’y aura pas de renaissance et de retour à un ordre légitime. Un article à lire avec attention. A commenter sans-doute. A partager, aussi. JSF
ENTRETIEN – Dans un « tract » intitulé Défécondité publié ce jeudi chez Gallimard, le philosophe analyse les causes profondes de la chute de la natalité au point que, dans les pays développés, le nombre de naissance se situe désormais largement au-dessous de ce qui serait nécessaire au renouvellement des générations.

LE FIGARO. – L’épigraphe de votre «tract» est une citation d’Émile Zola qui constate qu’une femme suivie par de nombreux enfants, dans la rue, n’inspire plus le respect mais suscite le rire, voire la répulsion : «Cela semble comique, presque inconvenant. Il n’y a que les animaux pour se reproduire de la sorte !» Pourquoi faire entrer le lecteur dans votre texte par ces mots ?
Olivier REY. – Depuis les origines, les humains ont eu beaucoup d’enfants, dont beaucoup mouraient en bas âge. Avec la modernisation, la mortalité des femmes en couches et des jeunes enfants est devenue très faible, nombre d’épidémies mortelles ont disparu, l’alimentation est devenue plus abondante, ce qui a entraîné une explosion démographique, le temps que le taux de natalité diminue à son tour. La phrase de Zola est extraite d’un article du Figaro de 1896 intitulé « Dépopulation ». Zola était un fervent nataliste (son roman Fécondité, publié en 1899, en témoigne), et il se désolait de voir les Français avoir de moins en moins d’enfants. À l’époque, le taux de fécondité était encore de 2,8 enfants par femme, mais la baisse était rapide. La situation actuelle, où, dans la plupart des pays développés, la natalité est tombée très en dessous de ce qui serait nécessaire pour le renouvellement des générations, n’est donc pas un phénomène subit, mais le prolongement d’une tendance de fond.
L’emballement du système consumériste et sa dimension déraisonnable pourraient être à l’origine de la dénatalité dans les pays «avancés». Cette dernière «exprimerait, faute de mieux, une forme de défection intérieure». Le fait de ne pas avoir d’enfant répond-il au dérèglement du monde et à son déploiement perçu comme «mortifère» ?
Nietzsche remarquait que l’homme moderne est essentiellement contradictoire. Les exemples abondent de ces « en même temps » oxymoriques qui nous travaillent. L’un d’entre eux est particulièrement répandu : il s’agit de fustiger la société de consommation, tout en réclamant des hausses de pouvoir d’achat afin de davantage consommer. Nous sommes tous, à des degrés divers, en proie à des contradictions de ce genre, et en sommes tous réduits à composer, plus ou moins bien, avec elles. Mon sentiment est que, chez un nombre croissant de personnes, la façon de conjuguer condamnation théorique de ce monde et soumission pratique aux modes de vie en cours est, d’un côté adhérer au monde par sa façon de vivre, d’un autre côté le rejeter en refusant de transmettre la vie. On invoque les « sombres perspectives », qui dissuaderaient d’avoir un enfant. Mais, comme le disait Bainville, dans l’histoire, tout s’est toujours très mal passé, et si les anticipations funestes avaient dissuadé nos ancêtres de procréer, il y a longtemps que l’aventure humaine serait terminée. La chute de la natalité a des causes d’un autre ordre.
Parmi les raisons de la dénatalité, vous évoquez «la destruction du cadre approprié à l’accueil des enfants», qui, par le passé, comprenait les parents, mais aussi la famille élargie et le voisinage. Pourquoi ce rétrécissement autour de la famille nucléaire ?
Élever des enfants, avec tout ce que le verbe « élever » comporte, est une entreprise de grande envergure. Depuis ses origines jusqu’à une date récente, les hommes ont vécu au sein de communautés, qui sont le cadre naturel à l’accueil des enfants. Le premier rôle revient aux parents, mais la famille entière est impliquée, et le voisinage. Encore faut-il, pour cela, que la famille au sens large habite en des lieux proches, qu’un véritable voisinage existe. Or l’ancrage local des familles, un voisinage auquel on puisse s’en remettre, ce sont précisément ce que les modes de vie modernes ont désintégrés. Les grands-parents, par exemple, si précieux, n’habitent plus que très rarement la porte à côté. Réduite à elle-même, la famille nucléaire se voit investie d’une responsabilité exorbitante.
D’autant plus que, de même qu’en physique on a découvert que l’atome, désigné comme tel en raison de son indivisibilité, était en fait divisible jusque dans son noyau, le noyau de la famille se révèle lui aussi de moins en moins stable. À quoi il faut ajouter la généralisation du travail salarié, qui éloigne généralement les parents du foyer. Des structures ont été mises en place, afin d’aider les parents à élever leurs enfants dans un contexte aussi peu adapté à leur présence – au premier rang desquelles les crèches et le système scolaire. Cela étant, ledit système ne fait pas qu’aider les parents. Il les dépossède aussi en prétendant non plus seulement enseigner, mais éduquer, en s’immisçant toujours davantage dans des domaines autrefois réservés à la famille, réduite de plus en plus à assurer l’intendance. Autrement dit, tout ce qui est déployé pour permettre aux parents de concilier leur vie professionnelle avec le fait d’avoir des enfants tend aussi à rendre moins enviable le fait d’en avoir.
Un renversement du soupçon d’égoïsme s’est en effet opéré : il ne pèse plus sur ceux qui ne veulent pas se charger d’enfants, mais sur ceux qui cèdent à leur désir d’enfants en projetant de nouveaux êtres dans un monde où ceux-ci risquent d’être malheureux
De manière plus prosaïque, et surtout franche, vous constatez que les nouveaux principes ont rendu beaucoup d’enfants «insupportables». Ces nouvelles méthodes ont-elles in fine éloigné les nouvelles générations de la parentalité, qui y voient un véritable sacerdoce ?
Le fait que la plupart des enfants, aujourd’hui, viennent au monde suite à un arrêt de la contraception, autrement dit parce que leur naissance est souhaitée et décidée, a profondément modifié les rapports entre parents et enfants. La position des parents, une fois l’enfant là, se trouve fragilisée : au nom de quoi s’opposeraient-ils aux désirs de leur enfant, alors qu’ils ont suivi leur propre désir pour l’avoir ? De là une perte d’autorité, et l’efflorescence de doctrines éducatives qui proposent de s’en passer tout à fait. L’éducation dite « positive », par exemple, recommande aux parents d’accueillir les émotions de leur enfant et de ne jamais s’opposer à lui.
Je voyais récemment, dans la rue, un petit garçon qui hurlait dans sa poussette et sa mère, à genoux à côté de lui sur le trottoir, qui l’interrogeait d’une voix suppliante : « Qu’est-ce que tu veux ? Qu’est-ce que tu veux ? » Je ne vois pas pourquoi un jeune enfant renoncerait de lui-même à un comportement qui met ses parents à genoux. Les tenants d’une éducation de ce genre (en fait, une anti-éducation) semblent inaccessibles à l’idée que les enfants puissent avoir besoin d’une autorité contre laquelle ils regimbent. L’absence de toute autorité les plonge dans l’angoisse, et les incite à chercher toujours plus loin une résistance introuvable. Plutôt que des enfants libérés, on engendre des enfants insupportables. Dans la résolution à ne pas avoir d’enfants entre, chez certains au moins, la détermination à ne pas avoir ces enfants insupportables que leurs principes anti-éducatifs feraient advenir.
La société, dans son ensemble, glorifie la jeunesse. Elle constitue aujourd’hui le temps de la vie où l’individu s’offre sans limite aux possibilités du marché : l’enfant, dès lors, prive-t-il de liberté ?
Nous nous trouvons assujettis à des modes de vie qui font du libre choix du consommateur, parmi ce que le marché lui propose, le modèle dominant de la liberté. Choix limité par les moyens dont on dispose, bien sûr, d’où l’équivalence implicite qui s’est établie entre accroissement de la liberté et augmentation du pouvoir d’achat. D’où, également, l’arbitrage que les potentiels parents ont à effectuer, entre d’une part leur désir de profiter au mieux des biens disponibles, d’autre part leur désir d’enfant – avec la réduction de la liberté de consommer qui en résultera par amenuisement du temps disponible et augmentation conséquente des dépenses contraintes.
D’autres facteurs entrent en ligne de compte, il est vrai. Il s’agit aussi de ne pas être entravé dans ses activités favorites par le souci d’une progéniture, qui nuirait à l’épanouissement personnel. Ici, on devrait se rappeler que le vocabulaire de l’épanouissement s’applique d’abord aux fleurs, et que les fleurs ne fleurissent pas à la seule fin de fleurir, mais en vue de la fructification. Les êtres humains ont certes d’innombrables façons de fructifier. Mais l’engendrement en fait partie, comme pour tout vivant. Il y a un temps pour tout, et la persévérance dans ce mode de vie « jeune », qui dissuade d’avoir des enfants, est moins un signe de vitalité qu’une fixation morbide.
Être humain, c’est dépendre de ce que nous lèguent nos prédécesseurs, sans quoi nous ne saurions vivre, mais aussi ne pas en être écrasé, pour frayer notre propre chemin
Si le célibataire était auparavant accusé d’égoïsme par son refus de propager l’espèce humaine sur la terre, les individus «qui donnent la vie à des enfants sans être en mesure de leur procurer (…) une vie heureuse» sont aujourd’hui pointés du doigt. Qu’est-ce que cela nous dit de la vision moderne du «bonheur» ?
Un renversement du soupçon d’égoïsme s’est en effet opéré : il ne pèse plus sur ceux qui ne veulent pas se charger d’enfants, mais sur ceux qui cèdent à leur désir d’enfants en projetant de nouveaux êtres dans un monde où ceux-ci risquent d’être malheureux. Condorcet le disait déjà : les obligations des hommes à l’égard de ceux qui ne sont pas encore « ne consistent pas à leur donner l’existence, mais le bonheur ». Responsabilité démesurée : comment serait-il possible de répondre du bonheur d’êtres libres ? On peut souhaiter le bonheur de ses enfants, faire son possible pour y contribuer, mais quant à l’assurer, ce qui se donne comme dévouement dissimule une volonté d’emprise perpétuelle, une ambition insensée d’être pour d’autres une providence. Réclamer de ses enfants qu’ils soient heureux est moins généreux qu’écrasant. J’ajouterai ceci. Notre œil est ainsi conformé que dans la quasi-obscurité, la meilleure façon de distinguer une chose est de ne pas la fixer, de la maintenir en périphérie du champ visuel. Il en va de même pour le bonheur. Le viser pour lui-même n’est pas la meilleure façon de l’atteindre.
L’humanité s’accomplit dans la succession des générations, mais cette dernière n’est jamais allée de soi. Elle est même la difficulté «essentielle et de toujours», au-delà de nos difficultés contingentes, affirmez-vous. C’est-à-dire ?
L’humanité ne se limite pas à l’ensemble des êtres humains actuellement sur terre, elle est un être historique qui se déploie à travers le temps et la succession des générations, chaque génération différente de celles qui l’ont précédée, en raison de l’héritage qu’elle en reçoit. Être humain, c’est dépendre de ce que nous lèguent nos prédécesseurs, sans quoi nous ne saurions vivre, mais aussi ne pas en être écrasé, pour frayer notre propre chemin. Cette tension est de toujours. Dans la Bible, l’Ancien Testament se termine sur une promesse : « Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères » (Malachie 3, 24) – manière de signifier la difficulté de l’entreprise. Il est vrai qu’aujourd’hui, aux difficultés inhérentes à la condition humaine, s’ajoutent des difficultés spécifiques à notre temps. Mais, tout bien considéré, ces dernières me semblent de second ordre par rapport à ce qui est indépendant de l’époque. Invoquer ces difficultés spécifiques pour refuser d’enfanter se donne comme un acte de sagesse, face aux irresponsables qui osent lancer des innocents dans un monde malade. Il se peut aussi que ce soit un prétexte commode pour esquiver l’aventure humaine essentielle.
La modernité prise tant l’originalité qu’elle célèbre n’importe quelle performance, serait-elle absurde, pour autant qu’elle soit unique et exige des capacités hors du commun, et néglige des œuvres qui, pour être banales, n’en sont pas moins beaucoup plus importantes, et beaucoup plus admirables. Péguy l’a dit à sa manière : « Il n’y a qu’un aventurier au monde, et cela se voit très notamment dans le monde moderne : c’est le père de famille. Les autres, les pires aventuriers ne sont rien, ne le sont aucunement en comparaison de lui. Ils ne courent absolument aucun danger en comparaison de lui. (…) Lui seul expose, il est contraint d’exposer aux tempêtes de mer un énorme appareil, un corps plein, toute la toile ; et quelle que soit la force du vent il est forcé de naviguer au plein de ses voiles. » Si Péguy a ici un tort, c’est d’avoir oublié la mère de famille, qui, par petit temps comme dans les tourmentes, est souvent celle qui continue à tenir la barre. ■
Historien et philosophe des sciences et des techniques (CNRS/Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Olivier Rey est l’auteur de « Défécondité. Ses raisons, sa déraison » publié chez Gallimard, « Tracts », le 30 octobre.
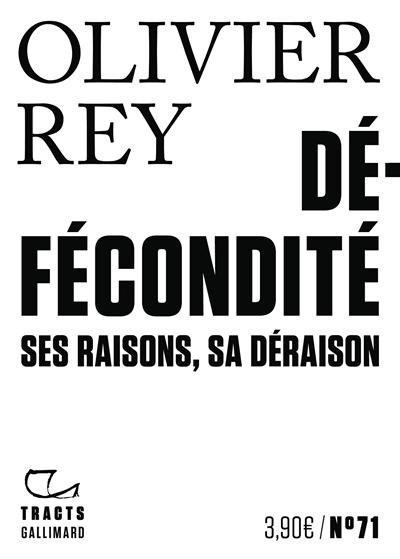
Défécondité. Ses raisons, sa déraison, d’Olivier Rey, Gallimard, « Tracts », 64 pages, 3,90€. Tracts Gallimard












Superbe analyse. Sans savoir tout ce que le livre ajoute à cette présentation, je me risque à rappeler le rôle délétère des media audio-visuels. Ce rôle n’échappe certainement pas à Olivier Rey.
Dominés par la propagande des marchands de camelote. Largement sevrés des talents littéraires et philosophiques. Gangrenés par l’immoralité et la facilité. Miroirs des médiocrités plus que sources d’exemples. Foutoir, brocantes, boutiques, illusionnistes, toujours plus nombreux, plus envahissants et aliénants ( des chaînes !), s’appropriant la place que la tradition donnait aux parents, à la famille, à l’école, au voisinage, à la nature pour s’adresser directement aux enfants. Un interminable carnaval de kitsch, et de déguisements mis en scène par des faux amis; des faux derches, des faux connaisseurs, des imposteurs, complices d’autres imposteurs..
L’animal se reproduit quand le milieu est bénéfique et nous sommes des animaux ….C’est à dire des êtres vivants comme tous les autres êtres vivants même si nous nous plaisons à nous croire supérieurs. Dans une société violente et déboussolée avec un avenir inquiétant au plus haut point , avec des structures inexistantes et des familles en constants bouleversements, rien n’engage à construire un foyer dans le calme et à préparer des enfants à une vie qui menace plus que jamais d’être un combat difficile et sans espoir. Libre à chacun de préférer ne pas donner la vie dans ce qu’on nous promet et qui sera un monde de robots privés de liberté où chaque. individu répertorié sera un numéro sans autonomie et sans âme.
Non, non et encore non ! nous ne sommes pas des animaux, que diable ! Et, d’ailleurs, vous l’admettez tout à fait puisque, par ailleurs, vous déclarer que chacun est LIBRE «de préférer ne pas donner la vie», liberté particulière qui tient à ce que, justement, nous ne relevons d’aucune zoologie. Quand les animaux cessent de se reproduire en raison du «milieu», c’est tout à fait indépendant d’une décision qu’ils auraient prises, c’est, en somme «instinctif». Si vous ou moi décidons ne pas avoir d’enfant, cela tient à un raisonnement, bon ou mauvais, qu’importe, mais c’est une «liberté» vis-à-vis de nous-même et d’autrui que nous nous autorisons – cela n’a rigoureusement rien d’«animal», c’est une des exclusivités de l’existence HUMAINE – «Objets inanimés avez-vous donc une âme ?», s’était interrogé le quarante-huitard Lamartine, sans que sa conscience littéraire fût incommodée par l’antiphraséologie de sa question : en effet, lexicologiquement, “inanimé” signifie expressément «sans âme», comme par un fait exprès…
Comme un sot, je ne me suis relu qu’après expédition, et c’est alors que j’avise la mauvaise orthographe d’une conjugaison et la confusion pluriel-singulier – pas glorieux, l’gars…
La quasi totalité des dirigeants européens n’ont pas d’enfant et cela ne date pas d’aujourd’hui, de plus certains sont engagés dans des relations sans postérité! Quel exemple!
Les femmes dans l’ensemble n’ont plus envie d’être enfermées dans ce rôle de mère souvent ingrat.
Et celles qui font carrière avec 4 enfants, elles gagnent plus que le père qui se met retrait et assume l’élevage des enfants.